Cocuzza A., Une psychiatrie, un infirmier, une histoire
Une psychiatrie, un infirmier, une histoire
Alfred Cocuzza
Les mémoires d'un infirmier de St-Egrève (38) qui exerça entre l'âge d'or de la psychiatrie des années 70 et les premières années de sa désagrégation en 2000-2005. On y lit de jolis moments de soins mais également la reprise en main institutionnelle, la force d'inertie incroyable de ce qui était encore l'asile, la complicité passive de ceux qui étaient chargés de la faire vivre.
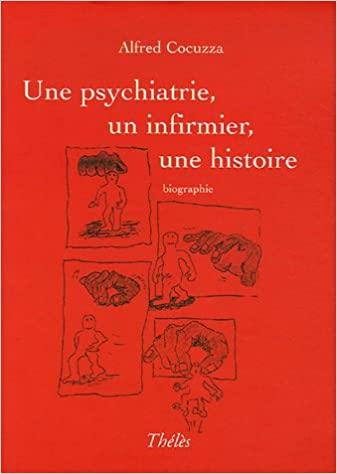
« Le souffle du phénoménal mouvement de contestation des années soixante-dix, n’est pas retombé, notre institution, encore sous l’emprise du fameux slogan « il est interdit d’interdire », donne les moyens, le droit devrais-je dire, aux patients, d’organiser la contestation. Avec le soutien de quelques infirmiers, ils publient un opuscule bimestriel, quelque peu subversif, diffusé largement dans les services. Les hospitalisés y dénoncent pêle-mêle : les hospitalisations arbitraires, les médications excessives, la contention … et font du prosélytisme en appelant au regroupement et à l’organisation d’une riposte. J’avoue le lire avec un réel plaisir, à travers les articles, les poèmes et les dessins, on observe que le besoin de considération et de justice est patent, la négation des troubles mentaux un sujet aigu et récurrent. On ne peut que saluer ces initiatives dont les objectifs primordiaux sont de rapprocher les patients, les mobiliser autour de leur condition d’hospitalisés, et de trouver grâce à nos yeux, par les valeurs créative et intellectuelle de leur démarche. »
L’auteur
Alfred Cocuzza a été infirmier de secteur psychiatrique à Grenoble, à St-Egrève. Il n’a pas fait d’études universitaires, n’a pas fréquenté l’IFCS même s’il lui est arrivé, au bénéfice de l’âge, de faire fonction de cadre à l’occasion. Cadre, lui ? Vous plaisantez ? Son dossier l’affirme : il est inapte à la fonction. Il est vrai qu’il ne porte pas les cadres dans son cœur.
Il n’en a pas moins été membre de la Commission du Service de Soins Infirmiers qu’il a représentée au Conseil d’administration. Il n’a évidemment jamais écrit d’articles même s’il lui est arrivé de participer à une recherche médicale.
Un infirmier « psy » banal comme des dizaines de milliers d’autres qui n’ont guère de titres à passer à la postérité. Qui en dehors de ses collègues et des patients qu’il a soignés se souviendra de lui une fois que l’heure de la retraite aura sonné ? Personne sûrement. Personne assurément. Et pourtant. Alfred a écrit sa biographie. Pas l’histoire de sa vie mais celle de sa vie d’infirmier à l’hôpital. Il l’a publiée en 2005, moment où nous nous sommes brièvement rencontrés. J’ai lu son ouvrage rapidement. Sûrement trop. J’y ai trouvé des qualités mais il me semblait à l’époque manquer d’un regard clinique sur les situations qu’il racontait. Le regard affiné par mon travail sur l’épistémologie du soin, je me suis décidé à le relire.
« A propos du jeune T. qui a commis un homicide dans un moment de grande perturbation psychologique. L’autocritique de ses actes est amorcée, les liens avec sa compagne, enceinte, sont maintenus malgré l’opposition de la virtuelle belle-famille, élément non négligeable pour lui qui fut abandonné enfant, dans des conditions dramatiques et élevé par une famille pathologique. Je lui accorde de fréquents entretiens qui se terminent par l’écoute de la musique et nous échangeons ensuite nos impressions, nos émotions. Il est temps d’envisager une prise en charge plus formelle. Les activités de plein air sont évitées par mes collègues du fait de la responsabilité personnelle en cas de fugue. Je propose de mettre en place et d’assurer, puisqu’il n’y a pas de candidats, des séances de gymnastique afin d’observer l’évolution du comportement. »
L’ouvrage
Alfred Cocuzza dresse un bilan sans concession des pratiques psychiatriques à St-Egrève (38) et surtout de ce qui empêche les infirmiers d’être soignants : encadrement servile ou mû par le développement d’une carrière qui se limitera au mieux à devenir cadre supérieur de santé, médecins qui laissent faire et ne se mêlent pas de ce qui concerne les infirmiers, direction des soins soucieuse que surtout rien ne fasse de vagues, direction générale soucieuse d’économies et de paix sociale, syndicats davantage mobilisés par le maintien de leurs privilèges que par la qualité des soins, infirmières elles-mêmes soucieuses de leur petit confort, hygiénistes qui ne mettent jamais les pieds dans les unités de soins, etc. Chacun en prend pour son grade. Une première lecture rapide pourrait donner à penser qu’il règle ses comptes avec tout ce qui lui semble avoir nui au soin. Alfred aurait été un infirmier empêché. Son réquisitoire interdit de penser que ces années-là (1975-2005), à St-Egrève, constituaient l’âge d’or de la psychiatrie.
Une lecture plus fine montre que cette biographie fait entendre les échos assourdis des combats menés par la psychiatrie de l’époque. En ce sens, son ouvrage regarde du côté de l’histoire de la discipline : heurs et malheurs du secteur dans un département qui associe une métropole, la montagne et des villes au dynamisme érodé par la désindustrialisation avec le chômage qu’elle sous-entend, montée en puissance des pratiques coercitives (isolement et contention) qui n’ont jamais totalement disparu à St-Egrève, création du service de soins infirmiers, formations continues dédiées à la musicothérapie puis à l’ethnopsychiatrie lorsque le nombre de patients issus de l’immigration a explosé, etc.
Que gardons-nous de notre carrière quand l’heure de la retraite sonne ? Quels évènements, petits ou grands, ont marqué nos mémoires ? Lesquels souhaitons-nous mettre en avant ? La réponse dépend de chaque un. Alfred a choisi de garder ce qui l’a empêché. Il montre peu de moments de soins réussis, à l’exception notable des fêtes de la musique, des séjours thérapeutiques proposés aux patients. Nul doute que sa carrière a été riche de beaucoup plus de moments que ceux qu’il décrit dans son ouvrage.
Arrêtons-nous sur certains de ces moments.
D’abord lorsqu’Alfred est élève (rappelons qu’alors les stages duraient plus de dix semaines) :
« En substance, nous proposons de sortir de la chambre où elle végète depuis au moins cinq ans, une jeune femme qui fut une grande délirante. Cette chambre commune de six lits, comporte quelques vasistas qui ne permettent qu’un petit aperçu du ciel, mais ça l’indiffère. Notre entreprise consiste à lui redonner dans un premier temps, le goût des choses simples, la prise de repas en salle à manger, tout ce qui peut être observé à travers les baies vitrées, communiquer … puis pourquoi pas la remettre sur pieds, au propre comme au figuré. Nous observons que toutes ces années d’alitement ont réduit à néant la masse musculaire des membres inférieurs, le poids continuel des éléments de couverture du lit a complètement distendu les articulations des chevilles, orientant les pieds dans le prolongement parfait des tibias (de quoi faire rêver un petit rat de l’opéra). Malgré le scepticisme de la patiente et la perplexité amusée des collègues, qui témoignent la main sur le cœur, de leurs nombreuses et audacieuses tentatives pour mettre fin au processus d’isolement de Mademoiselle R, nous sommes résolus à poursuivre notre but.
Comptant sur l’évolution de tout le système, du volontarisme de chacun, soutenu par une forte cohésion, nous élaborons une démarche, sorte de cheminement assorti d’objectifs simples non assujettis au temps, puisque nous sommes en début de stage et les relais sont toujours possibles.
Je me sens bien dans ce groupe motivé, tenace, utopique à ses heures, dont je partage les valeurs et la sensibilité. Après présentation du projet, une discussion s’ensuit avec l’intéressée qui s’avoue touchée et semble incrédule, mais donne néanmoins des gages de coopération, le validant de fait.
Lorsque notre roulement de travail coïncide, et que nous sommes au moins deux, nous la transportons jusqu’à la baignoire pour lui redonner le goût du bain et lui prodiguons des soins à caractère esthétique, qui sont censés contribuer à une restauration narcissique. Son plaisir non dissimulé nous galvanise et les étapes s’enchaînent.
Les collègues et l’encadrement nous observent du coin de l’œil, quasi indifférents. Les semaines passent, la patiente, toujours alitée, passe désormais ses journées en compagnie des autres pensionnaires dans la salle commune, s’intéressant à ce qui s’y passe, et partant de là au monde extérieur, par l’entremise de la télévision. L’étape suivante est une véritable gageure. Il s’agit de passer du lit au fauteuil sans lui faire courir de risques physiques ni physiologiques car son système cardio-vasculaire va soudain être soumis à une gravité inhabituelle. Les médecins nous font confiance et c’est en conjuguant nos efforts que l’objectif sera atteint, devant les vieux patients médusés.
Depuis, le lever prend une apparence de cérémonie, avec les différents transferts, l’habillage, le maquillage et la préparation de la trousse contenant ses objets fétiches. L’accueil des patients les plus attentionnés, prêts à l’aider pour la prise du petit-déjeuner est sans faille. Nous savourerons seuls le plaisir d’avoir mené à bien cette tâche, le bonheur de regarder le visage rayonnant relativise les déceptions. »
Le but d’Alfred n’est pas de rédiger des vignettes cliniques mais au fil des pages apparaissent d’autres moments de soin qui la plupart du temps ne font que suggérer mais montrent aussi comment du soin, une rencontre parfois était possible.
« Ce grand adolescent, conduit autoritairement par ses parents chez nous, il y a quelques jours, pour une surexcitation psychomotrice doublée d’un état d’exaltation, que les moindres conseils et tentatives de limitation des débordements, aussi minimes soient-ils, provoquent une agressivité démesurée et inquiétante, devient conciliant, presque docile et semble rechercher le contact. Avec l’apaisement, son ennui deviendra perceptible.
Le fait qu’il n’aille pas spontanément vers les infirmières, par méfiance ou crainte, peut s’expliquer par son vécu familial. La mère très possessive, autoritaire, entretient des liens ambigus avec ce fils qu’elle surprotège tout en ne supportant pas cette extrême dépendance qui produit des sentiments de rejet. Sa récente tentative d’émancipation la déstabilise, mais elle se dit prête à l’aider moyennant une certaine soumission à ses principes de bourgeoise coincée.
M’ayant écouté lors de petites animations, avec mes instruments, il viendra assez naturellement me parler de musique. Ce descendant d’un grand compositeur du département, universellement connu pour ses monumentales symphonies et tragiques opéras, en est à sa quinzième année de piano, cependant l’envie de jouer a disparu.
Je me souviens que dans un pavillon tout proche se trouvait un piano, j’y vois une opportunité et lui en fais part. Le patient demande à réfléchir, c’est déjà beaucoup, car il n’a pas décliné avec force l’offre. Les cadres trouvent l’idée singulière et ne voient pas pourquoi le service propriétaire de l’instrument, avec qui effectivement nous n’avons pas de relations privilégiées, le mettrait à notre disposition. Les risques de créer des « nuisances » sonores et d’occuper une pièce commune sans pouvoir faire une planification précise, semblent constituer des difficultés insurmontables.
Finalement, deux ou trois collègues de promotion de la dite unité convaincront l’équipe de l’utilité voire de la nécessité de favoriser cette démarche. Répétant sans cesse qu’il a perdu sa technique, mon discours l’amène à envisager une visite, que nous ferons après mûres réflexions.
Nous voilà devant le piano, très ancien, merveilleusement patiné, avec ses chandeliers incorporés et poignées de laiton, installé dans une salle à manger de style vaguement Louis XV. Le réflexe du musicien consiste à tester la justesse des sons, un accord de chaque main suffira à le déclarer complètement faux, mais ce contact a provoqué un changement d’attitude intéressant. Le lendemain il se laissera conduire jusqu’à destination sans sourciller et se mettra à jouer devant quelques patients médusés, des exercices d’échauffement suivis de morceaux techniques et mélodieux tirés des recueils apportés par ses parents, à sa demande. Je suis heureux de lui tourner les pages que je n’arrive pas à lire en détail mais que je peux suivre grâce à mes modestes notions théoriques. L’expérience aura été courte grâce à une atténuation rapide des troubles mais intense et appréciée du patient et de sa famille qui m’assurera de sa sincère gratitude. »
Alfred a également travaillé ponctuellement à la sociothérapie de l’hôpital, ce qui lui donne l’occasion de définir ce qu’il entend par art-thérapie, qui est « Plus qu’une activité occupationnelle. Le patient, soutenu, guidé par le thérapeute dans un acte authentique de création, quel qu’il soit, peut par ce biais, amorcer un travail d’introspection, le verbal n’étant pas primordial dans ce contexte. Il prend temporairement de la distance avec sa problématique, et peut à la faveur d’une communication restaurée, échanger, savourer pleinement ces instants. Cette forme de thérapie peut représenter une aide au diagnostic et par là même, guider, reconsidérer une prise en charge ou un cadre thérapeutique. » On peut (et on doit) évidemment discuter cette définition minimale, elle n’en est pas moins plus riche que celle mise en œuvre par nombre d’infirmières exerçant aujourd'hui en psychiatrie, dont les projets et les évaluations ne s’intéressent qu’au faire, au produit fini, sans prendre en compte le travail d’introspection suscité par la création. Il est vrai, comme l'écrivait déjà Alfred, que nul ne s'intéresse vraiment à ce qui se passe dans ces ateliiers ou lors des séjours thérapeutiques.
Ces quelques chapitres font le bonheur de l’épistémologue ou du philosophe des soins qui y voit en creux des concepts théoriques digérés et mis en application sur le terrain.
Alfred travaille à St-Egrève au moment où Madeleine Monceau, dont nous présenterons l’ouvrage prochainement, mène son enquête sur la violence[1]. Un chapitre semble y faire allusion, mais de tellement loin et dans des termes tellement vagues qu’il est permis de se demander si c’est bien de cette recherche dont l’auteur parle. Madeleine Monceau soutient que la violence augmente ainsi que l’isolement quand les soignants passent de la régulation de l’agressivité et de la violence à la pacification des unités. Il me semble que l’on retrouve ce mouvement dans la carrière de Cocuzza.
Apport de cette lecture aux soignants
Les infirmiers se présentent de plus en plus souvent comme des soignants empêchés. Ils voudraient bien mais les cadres, les effectifs, le médecin, la direction, leurs collègues trop-ci ou pas assez ça les en empêchent. Souvent à raison. Alfred ne dit pas forcément autre chose mais il ne s’y arrête pas, il saisit toutes les occasions. Souvent, comme dans l’exemple du piano on lui oppose des raisons de planning, de risque à courir, d’habitudes à modifier (On a toujours fait comme ça), etc. Il passe outre et a continué à passer outre jusqu’au jour de sa retraite. Des fois ça passe et de jolis moments de soins apparaissent, des fois ça ne passe qu’en partie et ça nourrit des regrets, l’on se dit et si … que serait devenu ce patient ? Parfois aussi, ça ne passe pas, ça échoue, ce n’était pas la bonne approche. Ce n’est pas grave on peut recommencer autrement. Pour savoir qu’une approche n’était pas la bonne, il n’y a qu’une façon de faire : la réfléchir collectivement, la proposer au patient, l’essayer, la tester, l’évaluer.
Dominique Friard
[1] MONCEAU (M), Soigner en psychiatrie. Entre violence et vulnérabilité. Coll. Des pensées et des actes en santé Mentale. Gaëtan Morin Editeur. Paris, 1999.
Date de dernière mise à jour : 29/05/2021
Ajouter un commentaire