De la daube institutionnelle à la soupe au caillou : comment mitonner un espace de parole ?
« De la daube institutionnelle à la soupe au caillou : comment mitonner un espace de parole ? »
Face aux contraintes générées par les certifications en tous genres, il n’y a parfois pas d’autre solution, pour le superviseur désireux de mitonner des séances aux petits oignons avec les équipes qu’il rencontre, que de s’abstenir. Il ne faut pas céder sur la place d’exception.
Texte présenté à Montpellier, le 12 octobre 2024, lors du colloque : « Supervision, régulation d'équipe, analyse de la pratique, analyse institutionnelle... Une extension de la psychanalyse ? »
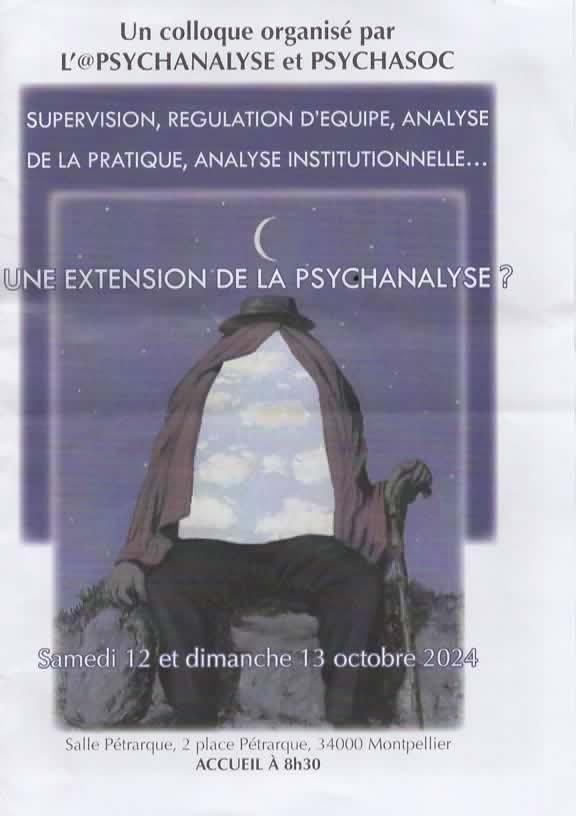
Quand en février, Joseph Rouzel m’a demandé un titre pour cette intervention, je lui ai répondu ce qui me passait par la tête à ce moment-là : « De la daube institutionnelle à la soupe au caillou : comment mitonner un espace de parole ? » J’étais alors percuté par l’arrivée de la certification Qualiopi et des normes qui en découlent dans une institution où j’intervenais depuis six ans. La question qui m’agitait à ce moment-là pourrait se résumer à celle-ci : la supervision d’équipe est-elle compatible avec les tests, pré-tests, post-tests, objectifs, évaluation et toute la paperasserie générée par cette nouvelle excroissance du néo-libéralisme ?
J’ai écrit « daube » mais ce n’est pas exactement le mot auquel je pensais. La daube en Provence évoque un ragoût de viande longuement mariné dans du vin rouge, traditionnellement cuite à l’étouffée braisée au coin du feu, dans une daubière en terre cuite. Ce pourrait être une image du soin en psychiatrie. Le mot « daube » auquel je pensais, alors, a une origine lyonnaise, il signifie « gâté » quand il s’applique à des fruits ou des viandes : « C’est de la daube ! ». C’est gâté, immangeable parce qu’on l’a laissé pourrir, qu’on ne s’en est pas occupé, qu’on n’en a pas pris soin. Les institutions, aujourd’hui, laissent de plus en plus pourrir les situations, les personnes (usagers ou professionnels), leur parole. Daube provençale et daube lyonnaise s’opposent.
La perspective de devoir obéir à des contraintes administratives qui seraient de plus en plus impératives m’incitait à mettre un terme à cette supervision même si je savais que celles-ci étaient davantage induites par l’établissement que par l’institution.
Aux protocoles qui ne manqueraient pas de s’imposer progressivement, j’opposais la soupe au caillou longuement mitonnée et enrichie des apports légumiers des « intervenants de contact » décrits par Claude Allione dans son Vocabulaire raisonné de la supervision d’équipe.[1] Mes métaphores étaient culinaires même si la supervision est davantage une histoire de tour de mains, de goût, d’épices que de recettes à respecter. De toute façon, il manque toujours un ingrédient ou deux.
Neuf mois plus tard, je n’en suis plus là. J’ai quitté cette institution et n’y interviens plus. J’ai trouvé d’autres façons de mitonner un espace de parole, probablement plus satisfaisantes.
Me revient en mémoire une question articulée par Claude Allione : « Pourquoi continuons-nous à engager une dépense coûteuse en énergie humaine pour maintenir dans un semblant de vie des institutions mortes de longue date, plutôt que d’en constater le décès afin de se tourner vers de nouvelles aventures institutionnelles ? »[2] La question est sévère, radicale. Qu’est-ce qui nous permet de soutenir qu’une institution est morte ? Peut-il encore exister des institutions vivantes dans une psychiatrie qui agonise sous les coups conjugués des T.C.C, des neurosciences, des néomanagers et qui érodent les moyens humains ? Faut-il réserver nos interventions aux ilots de résistance, mobiliser notre énergie à entretenir la flamme fragile qui continue à éclairer soignants et soignés, s’acharner à préserver la fonction α2 ?
Quelques traces d’une première séance
Je suis intervenu quelques années dans un pôle de soins dits au long cours. Ecoutons ce qu’en disaient les intervenants lors de la première séance, je reprends mes notes : « Stéphanie, la cadre, prend la parole. Elle a fait toute sa carrière dans le pôle. Avant même qu’il soit identifié et promu comme pôle de soins prolongés. Je pointe qu’elle en est une sorte de mémoire. Je note que ce qui caractérise ce pôle c’est la longueur des soins. Elle précise qu’au départ, il n’était fait référence qu’à la longueur du séjour, quelque chose d’administratif mais que l’équipe avait préféré mettre en avant les soins plus que la durée de séjour. Elle énonce que le pôle est en péril, qu’il est question de le relier à un pôle sectorisé, qu’il en est régulièrement question mais que c’est sans cesse reporté, que ça véhicule une sorte d’inquiétude aujourd’hui apaisée, mais ils sont vigilants, ils participent à un maximum d’instances pour se tenir au courant. Elle ne pense que du bien de la supervision même si elle n’en a guère l’expérience. … » Dès cette première séance, quasi-préliminaire, le risque de disparition du pôle est énoncé. Aux cases étroites de l’administratif s’oppose le soin qui prend le temps qu’il faut.
« Christine, une jeune infirmière, récemment arrivée (six mois), n’a pas d’idées particulières à propos de la supervision mais sous-entend que si cette démarche est proposée c’est que quelqu’un estime que l’équipe a des problèmes, des difficultés, qu’elle ne perçoit pas. On se pose autour de ça. Je parle des patients, des effets qu’ils produisent sur nous, comment nous sommes parfois aspirés par leur fonctionnement psychique. L’analyse des pratiques, par la présence de quelqu’un d’extérieur qui ne partage pas le quotidien des patients, ni de l’équipe permet de rendre un peu plus visible ce latent, cet invisible. Toutes les équipes y sont confrontées, qu’elles aient des problèmes ou non. » Je n’en suis pas sûr mais quelque chose de l’ordre d’un « Qui veut noyer son chat l’accuse de la rage » est présent dans ses propos.
« C’est autour de l’intervention de Brigitte, une IDE, que la réticence s’exprime le plus nettement. Elle commence par une demande de spécification technique sur la différence entre supervision, analyse des pratiques et régulation. Je réponds mais botte en touche que tout ça finalement c’est très technique. L’analyse des pratiques est ce que la formation continue prend en charge et reconnait. » J’énonce un écart entre la commande administrative (APP) et ce que nous en ferons (supervision).
« Sylvie, la psychologue, précise un peu plus. Je la laisse faire. Bien m’en prend. Elle rappelle au groupe (et à moi donc) qu’elle a animé une sorte de groupe d’analyse de la pratique autour des prises en charge des patients qui a bien fonctionné un temps mais qu’elle a dû interrompre à cause de ce qui s’exprimait de conflits lors de ces réunions. Elle s’est rendu compte qu’elle n’était pas extérieure mais qu’elle faisait partie de l’équipe et ne pouvait donc réguler ses conflits, vu qu’elle était en quelque sorte partie prenante de son fonctionnement. Un premier moment de bascule se produit alors. La question des conflits d’équipe. La supervision pourrait faire apparaître des conflits absents ou qui ne semblent pas se manifester. On s’arrête là-dessus. Il apparaît en creux qu’il y a eu des conflits au sein de l’équipe et qu’ils ont laissé des traces encore actives. »
« Nicole, une aide-soignante, trouve bien que les ASH participent à la supervision mais l’exprime d’une façon telle que l’on pourrait penser qu’elle dit le contraire, ce que lui pointe Anne-Marie dont c’est le tour de parole. En tant qu’ASH qui travaille depuis plus de trente ans à l’hôpital, elle est informée de ce qui se passe par les soignants autour du café, lors de temps informels. Elle ne venait pas à la supervision parce qu’elle ne voyait pas ce que ça pouvait lui apporter. Et au fait, c’est quoi la supervision ? » Le conflit au sein de l’équipe commence à dessiner ses contours : qu’est-ce que la supervision peut m’apporter plus que qu’est-ce que je peux apporter à la supervision d’équipe. Être informée autour de temps informels qui donnent une vraie place, reconnue, ou se diluer, anonyme dans l’équipe ? Ces réunions informelles autour du café et de l’ASH faisaient-elles contrepoids à celles organisées par Sylvie, la psychologue ?
« Je ne reprends pas l’histoire des chameaux chère à Joseph.[3] Je ne suis pas certain que dans cette équipe qui évoque d’anciens conflits, il soit judicieux de poser le superviseur comme « un opérateur de division ».
« Un soir d’hiver, au moment où la nuit s’apprête à tomber, un vieux loup fatigué arrive dans un village où demeure une communauté d’animaux. Il frappe à la porte de la première maison du village. Une poule y habite.
« Bonjour, pourrais-je préparer ma soupe au caillou, sur votre réchaud ? La recette est simple : dans une marmite, mettre un gros caillou, ajouter de l’eau et attendre que ça bouille. »
La poule, un peu surprise, n’y voit pas d’inconvénient. Le loup remplit une marmite d’eau et y dépose le gros caillou qu’il a dans son sac.
« C’est tout ? demande la poule
– Oui, répond le loup.
– Et si on rajoutait du céleri ?
– On peut, dit le loup, ça donne du goût. »
Le cochon qui vient rendre visite à sa commère, propose d’y mettre des navets, le canard qui arrive à sa suite suggère des poireaux. Chaque nouvel arrivant y rajoute un élément. Et quand la soupe est prête, tous s’assoient en cercle autour de la cheminée pour savourer une soupe délicieuse des apports de chacun. On se raconte des blagues, on discute, on déconniatre.
« Comme c’est agréable d’être tous ensemble ! dit la poule. On devrait faire des dîners plus souvent. »
Tous opinent.
« Oui, dit le cochon, même si au début, j’ai cru qu’on mangerait de la soupe à la poule. »
À la fin de la soirée, le loup reprend son gros caillou et part, seul, dans la nuit. »
La métaphore chemine. Ce sont les légumes apportés par chacun qui donnent du goût à la soupe, la cuisson, la conversation et les associations d’idées qui la soutiennent. Le caillou n’est qu’un prétexte, la soupe aura le goût des légumes qu’ils apporteront. Un goût de flotte ou un fumet avec des arômes d’unité. Je rajoute que chacun possède un morceau du patient. Ce morceau est fait de moments partagés, de rencontres, d’affrontements parfois, de paroles prononcées, de comportements perçus par chacun de sa place singulière. Poule, cochon, canard, lapin, vache chacun possède un morceau plus ou moins important. Si chacun garde son morceau dans son étable ou son poulailler, on ne peut pas soigner. Il manque plein de morceaux. La supervision c’est une sorte de puzzle où chacun place son morceau, sa pièce pour permettre de voir le tableau plus ou moins complet, le paysage, bref ce que le patient représente, ce qu’il suscite en nous. Il peut y avoir des gros trous ou pas. Plus il y a de trous, plus les conflits dans l’équipe sont probables. Mais il manquera toujours une pièce parce qu’un patient ce n’est pas en deux dimensions mais en trois ou en quatre. Comme nous.
Je perçois comme un relâchement dans le groupe. Les corps se détendent. »
Nous avons pu ainsi mitonner, pendant trois ans, quelques délicieuses soupes au caillou.
Une longue agonie
Le pôle a été dissous, trois ans plus tard, principalement pour récupérer des lits « actifs » et récupérer quelques postes de soignants. La fermeture de lits, la redéfinition des missions des unités (de soins au long cours à unité d’accueil et de crise avec un turn-over rapide de patients, par exemple), l‘absence de prise en compte des membres de l’équipe lors de la préparation de ces nouveaux projets vaut manque de considération et tend à rendre caduque le travail d’élaboration réalisé par l’équipe lors des séances de supervision. La soupe est progressivement devenue de la daube.
Ces changements imposés se traduisent régulièrement par de l’absentéisme, des arrêts maladie de longue durée qui ne sont pas remplacés. Ainsi l’équipe fut-elle progressivement privée de médecin, de psychologue puis de cadre de santé. La supervision devint le seul espace de réflexion qui subsistait, ce qui, un temps, aida l’équipe à tenir. Mais, une équipe qui se sent abandonnée par tous les responsables de l’institution, une équipe au sein de laquelle des patients hospitalisés parfois depuis des années apprennent la veille qu’ils devront changer d’unité le lendemain, n’élabore plus cliniquement mais se complaît progressivement dans une plainte perpétuelle, adressant au superviseur une demande de renarcissisation impossible à combler. Il ne fut bientôt plus possible d’évoquer les patients, les soignants ne parlaient plus que de leur souffrance, des catastrophes innombrables qui leur tombaient dessus, des patients qui s’agitaient, devenaient violents. Les éléments bêta ne pouvaient plus être retraités. Ils commencèrent à attaquer le cadre en quittant le service avant la séance. Ne restait plus que les soignants d’après-midi qui n’avaient pas le choix. Ils me faisaient vivre leur enfer quotidien. Gagné par le climat, j’étais moi-même atteint par cette déliquescence. Mes interventions n’avaient pas plus de sens que les leurs. Je m’acharnais. Je résistais psychiquement grâce à l’apport d’une intervision. Mais à quoi bon ? P. Chavaroche s’interroge sur ce point : « Dans la mesure où l’analyse des pratiques ne remplit cette fonction d’espace de pensée complémentaire des instances cliniques institutionnelles, faut-il pour autant la rejeter sous prétexte que son principe semble avoir été dévoyé ? »[4] L’unité ferma. Est-ce suffisant de se dire qu’on les a accompagnés jusqu’au bout ? N’aurais-je pas dû tirer les conséquences de ces changements et partir ? Faire le constat que ce qui avait présidé au début des séances de supervision avait disparu, avec la destruction du pôle, et clore ce chapitre ?
J’étais alors un jeune superviseur, sûrement encore trop marqué par son passé d’infirmier. Il me fallait tenir.[5] Maintenir coûte que coûte un espace de parole qui, en réalité, n’existait plus. Si j’avais pris en compte les conditions objectives de la disparition programmée de ce pôle, si je m’étais réellement ouvert à la réalité vécue par les soignants, je me serais rendu compte beaucoup plus vite que la supervision n’y avait plus sa place, que je maintenais l’illusion d’un retour possible. Que je m’illusionne passait encore mais que je contribue à entretenir un espoir auquel, plus fins connaisseurs que moi de leur réalité institutionnelle, les soignants avaient renoncé, c’était une faute. Le cadre des séances n’avait, en apparence, pas bougé. Même heure, même chaîne, presque les mêmes acteurs soignants, mêmes règles du jeu et pourtant tout avait changé. L’esprit du soin s’était évaporé. Il ne s’agissait plus de prendre le temps d’accompagner, pas à pas, des patients lourdement institutionnalisés vers une vie possible dans la cité mais de vider des lits le plus rapidement sans se soucier des potentialités des patients ni même de leur consentement au projet. Il n’était plus question de soins, qu’ils soient au long court ou au cours court. Et pour cela la supervision ne sert à rien. J’aimerai être sûr d’avoir maintenu, un peu, en vie cette unité moribonde mais je n’ai peut-être proposé que des soins palliatifs.
J’étais loin d’être le seul à vivre ce type de situation. Les collègues superviseurs avec lesquels j’échangeais en intervision étaient nombreux à se retrouver ainsi piégés. Le même dilemme se posait à nous : stop ou encore ? Avec qui et pourquoi ? A quoi bon ? Chacun y réagissait selon sa pente naturelle, son expérience et ses conceptions théoriques.[6]
Les objectifs opérationnels ont-ils été atteints ?
Lorsque Joseph Rouzel me demande un titre, j’ai aussi en tête la traversée de cette expérience et les traces qu’elle a laissées en moi.
Décembre 2023, je reçois un courriel de l’administration d’un établissement où j’interviens comme superviseur d’équipes depuis six ans. L’émetteur du message me remercie de lui retourner un formulaire de bilan de session pour chaque groupe d’A.P.P. que j’ai animé cette année-là. Il souligne que sa demande intervient dans le cadre de la certification « Qualiopi ». Je dois préciser en sus le numéro de l‘action ou format (4, 6 ou 10 séances par an), le numéro du groupe, le lieu ou service concerné, le cadre ou référent du secteur.
Je tombe des nues. Je connais bien la certification Qualiopi, ses sept critères et ses 37 indicateurs. Je m’y soumets quasiment chaque année avec mes collègues de l’association Serpsy qui propose quelques actions de formations. Les APP sont a priori exclues de la certification. Par ailleurs, ce sont les organismes qui sont certifiés pas les formations. Excès de zèle d’un bureaucrate ? Application en routine de procédures un peu à côté ? Je n’en sais rien. J’interviens dans différents autres lieux et aucun ne m’a jamais demandé de bilan de session. Est-ce une préfiguration de ce qui attend toutes les supervisions d’équipe ? Encore une fois, je n’en sais rien.
J’ouvre la pièce jointe. Elle a pour intitulé : Formation « Analyse des pratiques professionnelles ». Il est demandé de décrire les besoins et attentes des stagiaires. Une autre case aborde la question du programme. Le programme annoncé a-t-il été respecté : Oui ou Non. Si non pourquoi ? Une adaptation a-t-elle été réalisée ? Il est demandé d’apprécier les acquis des stagiaires. Le « formateur » doit ensuite évaluer si les objectifs opérationnels ont été atteints ou non, en termes d’écoute et d’intérêt du groupe et au niveau des locaux et des lieux de pratique. Il est enfin invité à commenter et à proposer des améliorations pour les prochaines sessions.
Ai-je été soudainement précipité dans un univers parallèle ? Quel rapport existe-t-il entre nos séances mensuelles et ce que me demande d’évaluer l’administration ? Pour le dire autrement, comment les procédures Qualiopi pourraient-elles permettre d’évaluer la supervision définie comme un outil collectif qui s’adresse « avant toute chose à la subjectivité des participants, bien au-delà de ce que mettent en jeu leurs pratiques ».[7] Si la supervision est destinée à mettre au jour, à dévoiler le transfert établi entre un patient et un soignant au sein d’un groupe, si le but de la supervision est de produire « un déplacement du et dans le transfert »[8] comment le superviseur/formateur pourrait-il apprécier les acquis des stagiaires autrement qu’au cas par cas ? Ainsi que l’écrit Joseph Rouzel : « La supervision fait sortir le praticien du registre de l’amour et de la haine, dont évidemment il n’a pas la maîtrise dans la relation, pour l’engager sur le chemin du savoir. Un certain savoir-faire en découle en situation. Le savoir qu’il n’a pas mais que l’usager, du fait du transfert, lui suppose. Cette supposition de savoir induite dans le transfert, il s’agit de s’en dégager, de faire un pas de côté, pour, dans ce qui lui arrive au cœur de la relation avec l’usager, en extraire le point de vérité. »[9]
La formation continue doit transmettre des savoirs nous dit-on. « Ceux-ci sont d’ailleurs évalué préalablement dans un questionnaire qui a le plus souvent la forme d’un QCM et réévalué en fin de formation afin de vérifier qu’il y a bien eu des acquis. On mesure aisément le caractère relativement artificiel de ces contrôles de connaissances, qui plaquent des modèles « scolaires » sur un dispositif de formation qui, justement, devrait s’en distinguer par un accès différent aux savoirs. »[10] Je rajouterai aux propos de P. Chavaroche que le savoir dont il est question en supervision est d’un autre ordre.
Les Groupes d’Analyse des Pratiques à la sauce HAS
Comment ne pas faire de lien avec un texte de 2017 émis par la HAS (Haute Autorité de Santé) qui énonce que « Les staffs d’une équipe médico-soignante et groupes d’analyse des pratiques sont des méthodes d’évaluation et d’amélioration des pratiques ».[11] L’équipe est définie comme médico-soignante. Les staffs, eux, sont décrits comme suit :
« Un staff d’une équipe médico-soignante ou un groupe d’analyse des pratiques (GAP) est un petit groupe de professionnels qui se réunissent régulièrement pour analyser des situations cliniques rencontrées dans leur pratique. À partir des problèmes soulevés ou de questions identifiées, les données de la littérature scientifique et professionnelle sont prises en compte. »[12]
Le texte poursuit :
« Une posture réflexive est alors adoptée, permettant d’établir une liaison entre savoirs et actions afin d’intégrer les savoirs dans la pratique professionnelle. La « pratique réflexive » amène le professionnel à réfléchir sur sa pratique de manière critique et constructive tout en créant des liens avec les connaissances (scientifiques ou autres) pour analyser l’action pendant qu’elle se déroule ou après qu’elle s’est déroulée »[13]
La demande s’adresse donc d’abord au savoir. Les difficultés rencontrées seraient liées à un manque de connaissances, de réflexion collective, mais en aucun cas à la difficulté du soin lui-même, aux affects suscités par la rencontre avec le patient et encore moins aux types de relations nouées entre les membres de l’équipe « médico-soignante ».
Les participants présentent à tour de rôle une situation clinique, ce qui, dit le texte permet d’analyser collectivement la prise en charge et les problèmes rencontrés. Les réponses à apporter par le groupe sont issues des données de la littérature scientifique et professionnelle sélectionnées. Un professionnel, participant volontaire (chaque participant peut, à tour de rôle, remplir la fonction d’animateur) ou professionnel extérieur au groupe, anime la réunion […].
Nous sommes ici très loin de la place d’exception. La personne qui anime la réunion est censée faciliter :
– la dynamique du groupe en gardant à l’esprit les objectifs du projet et en répartissant le temps de parole ;
– l’identification par les participants des problèmes posés par le dossier présenté, les déterminants de leurs décisions, les savoirs mobilisés, les données de la science, et les obstacles à l’intégration de ces données ;
– les échanges et les confrontations de pratiques ;
– l’identification de questions non résolues nécessitant un approfondissement de recherche bibliographique […] ;
– le choix d’actions d’amélioration des pratiques et le suivi de leur mise en place (évaluation de leur appropriation voire mesure d’impact, retour d’expérience, nouvelles actions à mettre en œuvre) »[14]
La démarche est volontariste, inscrite dans le cadre de la démarche qualité, avec un accent particulier mis sur les actions d’amélioration et les modalités de suivi. La confidentialité des informations et des données personnelles est garantie, mais la traçabilité des actions est assurée par un compte-rendu écrit de chaque réunion avec liste de présence des participants, fiche de suivi d’action d’amélioration, évaluations, suivi d’indicateurs, etc.
Ces Gaps peuvent évidemment être évaluables avec les 7 critères et 37 indicateurs de Qualiopi. Est-ce une nouvelle étape de la guerre menée contre la psychanalyse dont la Haute Autorité de Santé constitue un des fers de lance ?
Et je suis reparti seul
Il est bien sûr possible de soigner sans supervision, mais c’est de la daube. « Le soin est traversé d’incohérences, d’incohésions, de clivages. L’angoisse, notamment psychotique, n’étant plus contenue, déborde de partout et contamine l’ensemble de l’équipe et des usagers voire l’institution tout entière. On ne sait plus que répondre au coup par coup, raisonner en en action/réaction, en action/répulsion. Des équipes clivées répondent en miroir à des patients qui déposent leurs angoisse dans la psyché de soignants mis hors d’état d’élaborer. »[15] Faut-il s’acharner à maintenir coûte que coûte le dispositif quitte à faire semblant de se couler dans le moule Qualiopi ? J’ai choisi.
J’ai cliqué sur « Répondre à tous » et signifié qu’il m’était impossible de répondre à la demande. « L'APP n'est une formation que par la forme administrative qui lui ai donné, c'est d'abord et avant tout un outil de traitement (régulation) des affects, des conflits au sein du collectif soignant, une façon de tisser/retisser du lien entre les membres d'une équipe, de mettre en travail psychique ce que les patients suscitent en chacun et dans le groupe. Sa "réussite" s'évalue avec d'autres outils que ceux proposés par Qualiopi : présence, qualité des échanges, modification du regard porté sur un patient, ambiance dans l'équipe, qualité des échanges avec le superviseur, transfert et contre-transferts, etc., etc.
Dans une équipe qui travaille en douze heures, il n'existe pas suffisamment de continuité de présence pour que le type de travail auquel renvoie Qualiopi puisse être entrepris. Un soignant peut passer quatre mois sans être présent à l'APP, puis participer à trois séances d'affilée. La démarche s’accommode également mal du recours à des soignants intérimaires.
J'ai bien conscience que ce que je propose aujourd'hui en termes d'APP ne correspond pas aux attentes de l'institution. Je me propose donc d'interrompre ces séances dès que vous aurez trouvé un superviseur pour me remplacer et au plus tard en juin. J'ai apprécié travailler avec l'équipe mais ne peux plus lui garantir une qualité d'écoute suffisante pour poursuivre ce travail. »
J’aurais pu me dire que j’avais surréagi mais entre décembre et juin, mois de mon départ, le nombre de séances fut arbitrairement divisé par deux, d’une séance tous les quinze jours à une par mois.
Face au dilemme posé par Qualiopi et au risque de multiplication de procédures absurdes, je n’ai pu trouver d’autre chemin pour soutenir la place d’exception et assumer la mise en place du registre symbolique.
Et je suis reparti seul, avec mon vieux chameau tout pelé, et le caillou qui alourdissait mon sac.
Dominique Friard
Bibliographie
Allione C., Vocabulaire raisonné de la supervision d’équipe, Toulouse, érès, 2018.
Chavaroche P., Que sont devenus les savoirs professionnels en médico-social ? Toulouse, érès, 2024.
Friard D., Supervision d’équipes en psychiatrie. Dispositifs d’analyse de pratiques professionnelles, Ed Seli Arslan, Paris, 2023.
HAS, « Staffs d’équipe médico-soignante, groupe d’analyse des pratiques (GAP) », juin 2017, http://has-sante.fr/jcms/c_2807236/fr/staffs-d-une-equipe-medico-soignante-groupes-d-analyse-de-pratiques.
Rouzel J., La supervision d’équipe en travail social, Paris, Dunod, 2007.
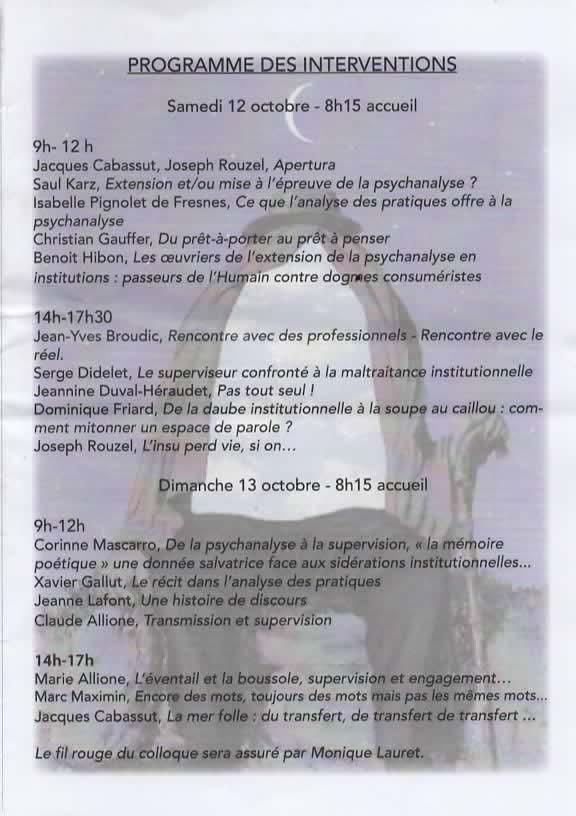
[1] Allione C., Vocabulaire raisonné de la supervision d’équipe, Toulouse, érès, 2018.
[2] Ibid.
[3] Rouzel J., La supervision d’équipe en travail social, Paris, Dunod, 2007. Rouzel y raconte l’histoire d’un partage impossible de 17 chameaux en moitié, tiers, et neuvième dans un village marocain. L’homme le plus sage du village, appelé en désespoir de cause amène un chameau supplémentaire qui rend le partage possible : 17 + 1 = 18, ce qui donne 9 chameaux pour l’un, six pour l’autre et deux pour le troisième, soit 17. Le sage-homme peut repartir avec son chameau. Dans cette métaphore de la supervision, Rouzel énonce que le superviseur est un « opérateur de division ».
[4] Chavaroche P., Que sont devenus les savoirs professionnels en médico-social ? Toulouse, érès, 2024.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Rouzel J., La supervision d’équipe en travail social, op.cit.
[8] Ibid.
[9] Ibid.
[10] Chavaroche P., Que sont devenus les savoirs professionnels en médico-social ? op. cit.
[11] HAS, « Staffs d’équipe médico-soignante, groupe d’analyse des pratiques (GAP) », juin 2017, http://has-sante.fr/jcms/c_2807236/fr/staffs-d-une-equipe-medico-soignante-groupes-d-analyse-de-pratiques.
[12] Ibid.
[13] Ibid.
[14] Ibid.
[15] Friard D., Supervision d’équipes en psychiatrie. Dispositifs d’analyse de pratiques professionnelles, Ed Seli Arslan, Paris, 2023.
Date de dernière mise à jour : 02/11/2024
Ajouter un commentaire