Epistémologie du soin infirmier en psychiatrie
Epistémologie du soin infirmier en psychiatrie
Ce vendredi 18 juin, avait lieu à l’Astronef, au Centre Hospitalier Edouard-Toulouse, la première journée dédiée à la recherche en soins en psychiatrie. Un timing très serré m’a empêché de présenter l’intervention que j’avais préparée, j’ai dû improviser sur l’histoire de la recherche en soins en psychiatrie. Voici le texte original.
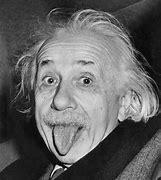
Quand Olivier Esnault m’a demandé de lui donner un titre pour cette intervention, j’étais en pleine relecture de mon ouvrage sur l’épistémologie du soin[1]. Je n’ai pas pris le temps de sortir de mon bain d’épistémologie, je ne me suis pas séché les neurones. Il en va souvent ainsi pour le chercheur. Il est tellement immergé dans son travail qu’il lui est difficile d’en sortir. Sa première pensée avant de se lever concerne son champ de réflexion. Il en a d’ailleurs parfois rêvé. Il trempe ses tartines de recherche dans son bol de café ou de thé ou de n’importe quoi qui aura de toute façon le goût de ce travail qui l’aspire, certains diront même qu’il le vampirise. C’est une des conditions pour mener à bien son entreprise. Tout ce qu’il lit, tout ce qu’il voit est susceptible de le nourrir. Quand Olivier m’a appelé j’étais donc en pleine grossesse. Aujourd’hui l’ouvrage est sorti, je suis plus à distance.
Une première journée au programme riche
Dans une journée dédiée à la recherche, il m’apparaissait pertinent de parler d’épistémologie, c’est-à-dire d’une branche de la philosophie des sciences qui prône une étude critique des sciences et de la connaissance scientifique. Les intervenants à cette journée ont tous, peu ou prou, quelque chose à voir avec ce mode particulier de connaissance que ce soit par leurs travaux, leurs choix méthodologiques ou l’ampleur de leur réflexion sur le champ. Il en va ainsi notamment de Jean-Paul Lanquetin dont les travaux sur l’informel dans le travail infirmier en psychiatrie ne devraient plus avoir à être présentés tant ils font partie de notre patrimoine commun. Sa réflexion va bien au-delà des fonctions décrites, ce que Jean-Paul nomme ce sont les concepts qui organisent la pratique soignante. Son compère Loïc Rohr a illustré comment ces concepts peuvent irriguer la pratique soignante et contribuer à diminuer fortement le recours à l’isolement et à la contention. Nadia Lippler, Infirmière en pratiques avancées au CHU de Nîmes, a présenté la revue de littérature, indispensable à tout chercheur qui veut déblayer son terrain de recherche et s’inscrire dans la continuité d’une réflexion pluridisciplinaire. Non, les infirmières n’ont pas tout inventé. Stéphane Moriconi, infirmier spécialiste clinique au Centre Hospitalier de Sevrey (71) s’est intéressé au vécu des infirmières et des infirmiers en psychiatrie et conséquences sur leurs relations de soins lors de la 1ère crise Covid en avril 2020. La méthodologie utilisée était tout aussi intéressante que les résultats qui montrent que débarrassés des tâches administratives, avec la possibilité de prendre les initiatives qu’il leur convenait de prendre les soignants ont retrouvé leurs valeurs et leur cœur de métier. Baptiste Gaudelus, Infirmier en pratiques avancées au Vinatier à Lyon, poursuit un travail commencé maintenant depuis quelques années. Il creuse, avec constance et rigueur, dans le cadre du programme Gaïa, la question des troubles du traitement des émotions faciales. Un très beau travail inscrit dans le fil de la pensée du rétablissement et de la psychoéducation. Yvonne Quenum, infirmière au CHU de Saint-Etienne, a retracé son parcours de chercheure : d’une unité en déshérence à l’obtention d’un PHRIP qui a contribué à redynamiser l’ensemble du pôle. Elle a centré son propos sur le plan de crise conjoint qui permet de travailler la rechute et contribue à prévenir isolement et contention. Du solide donc.
Sciences infirmières ou sciences du soin ?
L’épistémologie étudiant la construction des sciences, leur origine, leur contenu, la façon dont les savoirs s’organisent, se structurent, se développent et s’articulent, je n’étais pas hors sujet. Restent quelques questions qui méritent d’être posées : la soignologie, pour reprendre une expression ironique de Josiane Bonnet, l’infirmière clinicienne qui a dirigé la traduction du caring de Jean Watson[2], la soignologie, disais-je, constitue-t-elle une science ? Rien n’est moins sûr. En soins somatiques comme en psychiatrie. On m’objectera, sûrement à raison, que depuis le 30 octobre 2019, le soin est reconnu comme une discipline universitaire, c’est-à-dire comme un champ de connaissance légitime. Le soin ? Non. Les sciences infirmières. L’objet de cette nouvelle science n’est curieusement pas le soin mais l’infirmière, comme si l’on confondait celle qui pratique le soin et l’objet même de la science. La sociologie n’est pas la science des sociologues, ni la médecine la science des médecins. La sociologie traite des faits sociaux et la médecine des maladies. Nommer sciences infirmières l’objet de cette discipline en diminue la portée et l’intérêt. S’y glisse comme une ironie, comme si au fond, cette discipline n’était reconnue que sous la pression des féminismes et que ses contenus scientifiques n’étaient qu’anecdotiques, que relatifs à la vocation et au dévouement de ces femmes qui soignent. Revendiquer de faire l’épistémologie du soin plutôt que celle des sciences infirmières est un premier pas de côté. Qui n’est pas sans conséquences. Il nous éloigne de la plupart des chercheurs issus des soins somatiques qui faute de conception du soin ne peuvent penser la discipline que dans un registre professionnel. Les travaux présentés lors de cette première journée sont l’œuvre d’infirmières et d’infirmiers de terrain. Ils ne sont pas issus d’un laboratoire dédié.
Ce n’est pas parce que les responsables du projet d’universitarisation des formations paramédicales et de maïeutique affirment qu’une pratique est une science qu’il faut les croire. La HAS, et avec elle des cohortes de psychiatres et de soignants, a bien prétendu que l’isolement et le soin étaient thérapeutiques. Donc ce n’est pas parce qu’une autorité quelconque affirme quelque chose que ce quelque chose est juste. Nous l’avons bien vu avec la covid 19 et les masques. On pourrait dire que la recherche commence en ce point : ce n’est pas parce qu’on nous dit que quelque chose est vrai que ça l’est forcément. Il faut aller y voir pour être sûr. Avec méthode.
Si le soin n’est pas une science on ne peut pas en faire l’épistémologie. Aux Etats-Unis et au Canada le nursing est considéré comme une science. « Aux États-Unis, on trouvait 4 programmes de doctorat en 1960, 30 en 1984, 48 en 1989 et 75 en 2000[3].»[4] Au Canada, les deux premiers programmes de doctorat ont été inaugurés en 1991 (Alberta et Colombie Britannique) suivis par le doctorat conjoint de l’Université McGill et de l’université de Montréal en 1993. Dans les années 70, en stage à San Francisco pour un master of science, Rosette Poletti témoignait que tous les cadres étaient formés à l’Université, soit directement en obtenant un bachelor of science in nursing (quatre ans d’études), soit après une formation de trois ans proche du diplôme d’Etat français. « Après cela, enseignants, administrateurs et spécialistes cliniques, continuent et obtiennent après deux années d’études, un « Master of science » qui correspond à la « maîtrise » française. Puis les infirmières qui se destinent à l’enseignement universitaire ou à la recherche en soins infirmiers, poursuivent leurs études en vue d’obtenir un doctorat (en soins infirmiers ou en enseignement des soins infirmiers). »[5] Vous avez dit retard ?
Pas de recherche sans rôle propre
Peut-on affirmer qu’à Edouard-Toulouse le soin est une science ? Quelles connaissances scientifiques a-t-il produit ? Comment ces savoirs s’organisent, se structurent et s’articulent-ils ? Bien malin qui pourrait répondre. Il faudrait commencer par définir ce que l’on entend par soin. Le soin dont je parle n’a rien à voir avec le champ médical. Distribuer le traitement prescrit par le médecin, ne relève du soin que si se glisse dans cet acte une dimension qui appartienne en propre à l’initiative de l’infirmière et qui prenne en compte la singularité du patient, le contexte dans lequel s’effectue cette distribution, la qualité de la relation entre l’infirmière et le patient, et un ou des objectifs qui ne se résument pas à l’effet physico-chimique des molécules ingérées. Pour faire simple, il n’est de science du soin pour ce qui nous concerne qu’à l’intérieur du rôle propre infirmier qui ne rassemble que 2 % des observations infirmières, selon l’étude menée par Jean-Louis Gérard[6]. Moins les infirmières investissent cette dimension et moins ce qu’elles font relèvent des sciences du soin. En faire l’épistémologie ne présente alors aucun intérêt. Autant ouvrir nos services aux sociologues qui étudieront les rapports de pouvoir qui structurent l’hôpital, les représentations sociales de la folie chez les soignants ou tout autre fait social remarquable qui appartient à leur champ. Qu’entends-je par soin ?
« Tout dispositif, simple ou complexe, profane, sacré ou savant qui vise à prévenir, accompagner, soulager, intégrer voire dépasser la souffrance physique, psychique ou sociale d’un individu ou d’un collectif. Ce dispositif se définit par le contexte dans lequel un (ou des) opérateur(s) suffisamment engagé(s) et reconnu(s) en use(nt) (voire en abuse[nt]), par la nature des interactions qui le(s) relient à un sujet ou à un groupe de sujets en souffrance, par l’objectif poursuivi par cet opérateur, par le contenu de ces interactions et par la lecture théorico-clinique même minimale qu’ils en font. Ce dispositif admet quatre dimensions : technique, relationnelle, éducative et sociale. Je nomme sciences du soin la discipline qui explore et théorise les phénomènes ainsi décrits. »[7]
Mon projet d’intervention était donc à côté, quasiment hors-sujet. Il l’était parce qu’il surplombait le soin et les soignants. On y aurait retrouvé le discours tenu aux infirmières de base par les chercheures canadiennes, un discours décalé du terrain qui se préoccupe de paradigmes et même de métaparadigmes qui n’ont jamais soigné qui que ce soit. Un discours au fond méprisant, celui que j’ai entendu, dans les années 2000 quand je faisais partie du Groupe européen de recherche sur la violence dans les soins. Seul français, d’un groupe qui regroupait des chercheurs en soins de quinze pays européens, j’étais également le seul à avoir un exercice clinique. « Quoi ! Tu vois encore des patients ! » J’avais bien senti que voir des patients pour ces chercheurs, c’était un sale boulot, un « dirty work » comme l’a théorisé le sociologue E. Hughes[8].
Un discours en première personne
J’ai été infirmier de secteur psychiatrique pendant près de 40 ans et j’ai fait de la recherche. Au fond, aujourd’hui c’est probablement la chose la plus intéressante que j’ai à vous transmettre. Un discours en première personne. Un discours inscrit dans les sciences humaines plus que dans ces sciences dures qui font l’impasse sur celui qui rédige le rapport de recherche, qui pourrait être aussi interchangeable qu’un infirmier qui doit remplacer un collègue au groupe piscine alors qu’il déteste l’eau.
Comment faire de la recherche quand on est cantonné à des tâches de surveillance, quand notre principal geste clinique est de repérer le moment où un patient peut sortir de la chambre d’isolement ou cesser d’être attaché à son lit ? Sans autonomie de pensée, sans exercice d’un rôle propre et sans la prise de décision qu’il autorise, comment peut-on s’investir dans la recherche ? Comment envisager que ces pratiques souvent coercitives puissent nourrir un savoir disciplinaire ? Comment passer son temps à nourrir un ordinateur glouton et se poser des questions sur ce que nous pourrions faire et ne faisons pas parce que la chose réelle aujourd’hui c’est le temps que l’on passe à entrer des données ?
Et s’il s’agissait justement de partir de ces impasses pour penser ? S’il suffisait de se demander à quelles conditions puis-je, là où je travaille, contenir l’angoisse, écouter les propos délirants, canaliser l’agressivité voire la violence ? Non pas de tous les patients mais d’un, puis d’un autre et d’un autre encore ?
Les infirmières qui font des prises de sang à la chaîne, qui appliquent en routine des protocoles imposés, qui sont engluées dans des tâches administratives qui les éloignent du soin et des patients sont-elles mieux loties en termes de réflexion sur leur praxis ? Je ne le pense pas. Quand ce qu’on fait ne semble pas avoir de sens, quand on ne peut pas le penser avec des outils disciplinaires, le burn-out n’est pas loin. La recherche, ça sert aussi à fabriquer du sens.
Comment suis-je devenu chercheur ?
Le secteur où, jeune infirmier, je travaillais se préoccupait de formation. Deux jeudis par mois, c’était jour de fête. Le séminaire du secteur ! Léon Dreyfuss, le médecin-chef, organisait ce séminaire autant pour la formation des internes du service que pour celle des infirmiers. Toute l’équipe pluriprofessionnelle y participait. Nous regardions ensemble l’entretien magnétoscopé d’un patient reçu par le patron ; un psychiatre à la retraite, nous en expliquait les subtilités sémiologiques. Chacun y allait de ses commentaires, de ses hypothèses. Comme il s’agissait de patients hospitalisés dans les unités où nous travaillions, nous les connaissions et participions à la discussion en apportant nos remarques, nos observations. Il y avait là tout un secteur à l’œuvre, un travail de pensée en commun. En sortant de ces séminaires, nous pouvions vérifier nos propres hypothèses de soins et les mettre en œuvre collectivement. Le soin quotidien était porté par la clinique. Nous parlions un langage commun compris par chacun et par tous. Si la psychopathologie servait de prétexte, la dynamique psychique n’était pas oubliée, bien au contraire. Nous nous imprégnions des « nouvelles théories » (Lacan, les théories systémiques, l’ethnopsychiatrie, la phénoménologie, etc.) qui arrivaient petit à petit. Ainsi, pour un même phénomène, avions-nous parfois plusieurs explications qui se contredisaient. À nous de nous y repérer.
J’ai donc pu baigner dans une atmosphère qui favorisait la réflexion et qui encourageait chacun à s’exprimer. J’ai ensuite travaillé dans un hôpital de jour dans lequel nous faisions chaque semaine l’étude clinique d’un patient. Chaque soignant référent préparait, à tour de rôle, l’histoire biographique du patient, son anamnèse, décrivait son parcours dans la structure et faisait des hypothèses sur les mouvements psychiques que traversait le patient dans les séquences de soins (le plus souvent des médiations) dont le soignant était responsable. La pluridisciplinarité était une grande richesse. Je dis « je », mais ce que je décris valait pour tous mes collègues. Ainsi fûmes-nous nombreux à reprendre des études universitaires.
Comment ce bain de clinique infusait-il sur le terrain ? Nous nous étions rendu compte, dès 1985, que de nombreux patients souffrant de schizophrénie, du fait de troubles négatifs, n’arrivaient pas à rester durablement dans leur appartement. Les contraintes de la vie sociale parisienne leur pesaient tant qu’ils étaient souvent réhospitalisés en raison des conséquences de leur apragmatisme. Nous avions donc cherché un moyen de travailler les habiletés de la vie quotidienne touchées, d’abord en adaptant le jeu nommé Trivial Pursuit® qui venait d’arriver en France, avec des rubriques liées au quotidien (connaissance de la maladie, du traitement, bases de cuisine, entretien du logement, relations avec le monde extérieur, communication avec les proches). Ce jeu que nous avions rebaptisé « Déjerine Pursuit », du nom de notre unité, nous permettait à la fois de mettre en travail les habiletés perdues, d’en initier parfois de nouvelles et surtout d’avoir un espace pour aborder, sur un mode ludique, les difficultés rencontrées par ces patients dans leur vie quotidienne.
Dans le même esprit, nous utilisions des jeux socio-éducatifs tels que le Jeu de Paris® (pour s’orienter dans le métro et dépasser la peur des transports), le jeu de Scrupule® (pour confronter le groupe de patients à des choix de vie, et leur permettre de les argumenter), le Monopoly® et la Bonne Paye® (pour la gestion d’un budget), etc. En procédant par essai/erreur, nous avions ainsi mis au point une technique de travail efficace et ludique sur ces troubles négatifs. L’utilisation et la création de ces jeux psycho-socio-thérapeutiques ne répond pas à une prescription médicale, elle s’inscrit pleinement dans le rôle propre infirmier même si ces jeux n’apparaissent pas dans le décret de compétence infirmier.
À la même période, l’infirmier suisse Jérôme Favrod, après un stage chez le Pr R.P. Liberman, à Los Angeles, en 1986, mettait au point et développait le Jeu Compétences[9] qu’il réussit à faire fabriquer et distribuer par le laboratoire Lundbeck. Les théories de référence diffèrent mais le souci était commun. Nombreux sont aujourd’hui les soignants qui investissent cet espace socio-éducatif et proposent des jeux ou des applications ludiques destinés à mobiliser des patients habituellement réfractaires aux discours scientifiques, surtout lorsque ceux-ci parlent d’une maladie qu’ils dénient.
Face aux difficultés rencontrées par les patients, nous tentions d’inventer des solutions parfois ingénieuses, parfois saugrenues, en tout cas souvent efficaces. L’absence de chambre d’isolement et de moyens mécaniques de contenir l’agressivité voire la violence dans l’unité nous contraignait à être inventifs. Les travaux que nous avons menés plus tard autour de l’information sur le traitement sont nés dès l’année 1985, voire dès 1978, avec Pourquoi pas ?, le premier journal créé par un groupe de patients et d’étudiants en soins infirmiers. C’est sur le terrain que nous avons commencé la recherche, et son développement est le fruit de vingt années de réflexion collective. Certains écrivent, d’autres pas, mais pour peu qu’existe une ambiance qui favorise la créativité des soignants, c’est une pensée à plusieurs qui nourrit les recherches.
Quelques années plus tard, j’avais mûri autour d’une maitrise et d’un diplôme d’études approfondies (DEA), j’étais inscrit comme doctorant pour une thèse en épistémologie clinique comparative, avec un mi-temps spécifiquement dédié à la recherche. Je pouvais légitimement me dire chercheur.
Pas de soin sans recherche clinique
La recherche infirmière s’inscrit dans un mouvement de réflexion national et international. La notion d’évaluation, utilisée dans les pays anglo-saxons dès les années 1960, apparaît en France dans les années 1970. Elle est liée à ce qui est décrit comme une augmentation exponentielle des dépenses de santé. Les 9e (1984-1988) et 10e plans (1989-1992) se fixent comme objectifs (entre autres) la modernisation du système de soins qui doit répondre à la diversité des besoins et aux aspirations de la population tout en maîtrisant l’évolution des dépenses. « Il s’agit de rechercher si les moyens juridiques, administratifs et financiers mis en œuvre permettent de produire les effets attendus d’une politique et d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés. »[10]
Cette gestion voulue plus efficace suppose des instruments d’évaluation et de contrôle nouveaux. Et patati et patata. Langue de bois. Je technocrate. Je vais tous vous endormir si je poursuis sur ce ton. Non, si je fais dans la recherche, malgré ses motivations économiques et politiques, c’est que je ne supporte pas le réel de la maladie mentale et surtout ce que l’on met en place pour la contrôler, la gérer plus que pour soigner les personnes et les communautés qui en sont touchées. J’aime par-dessus tout aller à la rencontre de cet autre-là et tenter d’établir un lien, une communication avec lui, même si je sais qu’au fond, il y a là une part d’impossible.
Pour pouvoir être pleinement soignant, j’ai besoin de prendre de la distance avec ce que je vis avec un patient ou un groupe de patients. La recherche clinique est un des moyens à ma disposition pour être suffisamment à distance, c’est-à-dire suffisamment proche, suffisamment présent. Je ne peux concevoir le soin sans la recherche clinique. Il s’agit des deux faces d’une même pièce. J’aime ce mouvement mental qui fait aller du particulier au général et du général au particulier. J’aime ces univers mentaux dont je découvre la richesse avec la joie et les précautions d’un explorateur en quête des sources du Nil. Je suis un explorateur, un ethnologue du quotidien des soins. J’aime ces hommes et ces femmes qui acceptent un instant, un instant seulement peut-être, de me laisser entrer dans leur monde intérieur. J’aime cet effort que cela implique en moi. J’aime cette sensation d’être parfois comme un funambule sur un fil, qu’un souffle de vent suffirait à faire chuter. J’aime l’angoisse qu’il m’arrive parfois de ressentir. J’aime et je respecte ces femmes et ces hommes qui combattent simplement pour que le monde puisse continuer à exister, à être habitable.
La recherche me colle à la peau. C’est comme une seconde nature. C’est presqu’une question d’équilibre interne. J’aime cette frénésie qui s’empare de nous à certains moments lorsque les hypothèses se vérifient ou sont infirmées. J’aime aligner mes petits bâtons et voir aux décours des questionnaires se dessiner des tendances. J’aime voir apparaître progressivement une certaine réalité, parfois étonnante, au cours d’une enquête. Je sais que les programmes informatiques sont beaucoup plus rapides, que les données qu’ils permettent de recueillir sont souvent plus fines, plus justes que celles que je recueille à la main, mais ce qui me plaît dans la recherche, c’est cet aspect artisanal qui nourrit ma pensée, stimule mon préconscient et me prédispose à associer. J’aime que la recherche me surprenne, qu’elle me fasse voyager, explorer des terres pas encore connues. J’aime quand des chiffres secs me permettent de faire un saut de côté, de mieux comprendre celui qui est à côté de moi. La recherche au fond, ne sert qu’à cela : à faire des sauts de côté, à se rapprocher de l’autre. Sans autre, pas de recherche clinique, ni de soins.
Ainsi que l’écrit Françoise Martel, une science, c’est avant tout : « une attitude : celle de l’aventure, et cela ne se fait ni sans défi, ni sans lutte et parfois même combat. Une science est une quête, une démarche pour habiller le vrai ; d’ailleurs le propre de la scientificité n’est pas de refléter le réel, mais de le traduire en théories changeantes et irréfutables »[11].
Le chercheur n’est pas un installé, c’est un secoueur de cocotier. Il y faut de la hardiesse, comme le développe Philippe Delmas[12] ; savoir désobéir aux injonctions, qu’elles viennent du terrain ou d’instances supérieures, comme l’énonce Amélie Perron[13] ; être avec ceux pour qui « ça ne va pas de soi », comme le théorise le psychiatre-psychanalyste Jean Oury, fondateur de la clinique de La Borde, et figure marquante de la psychothérapie institutionnelle[14]. Le chercheur n’est pas un « gentil » qui vise à ne vexer personne. Il est par nature critique. Comment la pensée de la discipline pourrait-elle progresser si les chercheurs disent amen à tout ce qui vient des États-Unis ou du monde médical ?
L’esprit scientifique contribue à éclairer : c’est l’art de découvrir, de comprendre et de savoir utiliser. Son domaine est celui des vérités complexes, jamais démontrées, postulées, valables jusqu’à leur réfutation. Ainsi la science consiste à découvrir constamment des problèmes nouveaux et à soumettre les réponses à des tests renouvelés de plus en plus affinés[15]. Il ne s’agit pas de chercher des évidences, des réponses qui seraient vraies une fois pour toutes et sur lesquelles il ne serait plus nécessaire de revenir. L’evidence based nursing c’est bon pour la faculté des sciences infirmières de Marseille. Nous sommes quelques-uns à chercher des questions plus que des réponses.
La recherche clinique est une exigence. Elle procède tout autant de la curiosité que d’un sentiment d’insatisfaction face à la réalité. Comment ne pas être insatisfait face à la maladie, qui fait pourtant partie intrinsèque de notre humaine nature, face à la souffrance de cet autre isolé dans un monde disloqué, dont le corps est morcelé, plongé quotidiennement dans un film d’horreur qu’il ne peut pas partager et qui pourtant lui rend l’existence habitable ? Comment être satisfait, aussi longtemps que nos soins, de plus en plus souvent coercitifs, ne sont que cataplasme sur une jambe de bois ? Et sans recherche clinique, sans recherche en soin, ils ne sont que cela. La recherche, c’est de la passion, mais sans passion pourquoi être soignant ?
Ma posture, n’est pas celle du scientifique qui, impavide, regarde s’agiter un organisme au microscope. Je suis l’observateur et l’observé, le microscope et le bouillon de culture qui permet à l’organisme de se développer. Il est impossible à un chercheur en soin de s’extraire des phénomènes qu’il décrit. Je m’exprime en première personne chaque fois que cela me semble nécessaire. Les sciences du soin ne sont pas des sciences dures mais des sciences humaines ; la posture du chercheur s’y questionne donc en première personne. C’est une question de méthodologie.
Fureter
Le verbe « rechercher » vient du bas latin circare (aller autour) qui a donné « chercher ». Rechercher signifierait étymologiquement « parcourir en cherchant », soit parcourir en allant autour, en tournant autour d’un objet, soit fureter. Le Petit Robert propose différents sens au mot « recherche » : « Effort de l’esprit pour trouver une connaissance, la vérité », c’est aussi « le travail, les travaux faits pour trouver des connaissances nouvelles, pour étudier une question » et enfin « l’ensemble des travaux, des activités intellectuelles qui tendent à la découverte de connaissances et de lois nouvelles ». Il s’agit « d’un effort conscient, méthodique et insistant[16] ». Un exemple d’effort méthodique et insistant : le travail que Jean-Paul Lanquetin vous a présenté. Nous nous connaissons depuis presque trente ans. Je me souviens encore du premier texte de Jean-Paul que j’ai lu, il y a plus de 25 ans. Il y était déjà question des fonctions et de l’informel. L’article[17] n’avait pas la richesse de la théorisation actuelle des effets de l’informel sur le soin mais d’une certaine façon les grandes lignes y étaient déjà présentes. Ça m’a frappé la dernière fois que je l’ai relu. Jean-Paul a creusé. Longuement. Autour d’une intuition. Il a tracé son sillon, labouré tant et plus, semé et récolté, vérifié cette intuition première avant de moissonner ses résultats de recherche. Jean-Paul et moi sommes différents. Je suis un explorateur sans esprit de système. Je suis passé de l’information sur le traitement à la chambre d’isolement puis à l’Electroconvulsivothérapie avant de m’intéresser aux écrits professionnels infirmiers. Il existe plus d’une façon d’être infirmier-chercheur. A chacun de trouver la sienne.
Là où la médecine ne va pas
Un chercheur-infirmier, c’est un fureteur. Il est en mouvement autour d’une question qui le titille, qui part de la rencontre avec un patient et de ce qu’elle produit pour chercher une généralisation. La recherche est une dynamique. C’est d’abord prendre en compte ce que la réalité, ce que la rencontre avec cet autre souffrant provoquent en soi. Le chercheur-infirmier n’est pas à distance de ce qu’il observe. On ne le dira jamais suffisamment. Dans ce sens, la recherche en soin appartient aux sciences humaines qui impliquent l’observateur et où l’observateur s’implique. Elle a peu à voir avec la recherche médicale. Les futures universités dédiées au soin ont plus leur place au sein des sciences humaines que dans le giron des sciences médicales. L’hébergement des infirmiers en pratiques avancées (IPA) dans les facultés de médecine signe le manque de place laissé aux soins dans leur exercice futur. La recherche en soins suppose des méthodologies particulières et spécifiques qui n’ont rien à voir avec celles des sciences exactes qui séduisent pourtant tant de chercheur(e)s soignant(e)s.
Les premiers moteurs du chercheur sont le désir, la curiosité, la volonté de savoir. On n’est pas loin de : « Comment on fait les bébés ? » Nos théories sexuelles infantiles nourrissent ce qui deviendra, un jour, de la recherche. Comment faire de la recherche quand on travaille à Edouard-Toulouse ? Sur qui ou sur quoi s’appuyer ? Sur les médecins ? Pourquoi pas ? Sont-ils en mesure de proposer des séminaires de réflexion ? Le turn-over médical permet-il à un(e) psychiatre de s’investir suffisamment longtemps dans une clinique partagée, décortiquée, critiquée ? Les infirmières et aides-soignantes peuvent-elles y être écoutées sans se sentir jugées ? On m’objectera qu’il s’agit-là d’une clinique médicale et non-infirmière. Certes, mais la connaissance fine de la psychopathologie est nécessaire au chercheur-infirmier. Dans un séminaire suffisamment ouvert, la psychanalyse a évidemment sa place, tout comme la sociologie dès qu’il s’agit d’interroger le fonctionnement institutionnel ou l’ethnologie ou l’approche systémique. Il faut des outils pour penser et cheminer, trouver sa voie (« e » et « x »). La recherche en soins ne s’oppose pas au savoir médical, elle le complète, elle s’aventure dans des endroits où la médecine ne va pas ou peu.
On s’appuie aussi sur ses pairs. Nul ne fait de la recherche en solitaire. Quelle place donne à la recherche la direction des soins ? Comment la favorise-t-elle ? Est-ce l’apanage des cadres ? Des futurs IPA ? Dans certains établissements, la recherche est préemptée par les cadres. Les petites mains ne sauraient être autorisées à penser, penser c’est déjà contester. Et l’on ne veut pas de soignants qui contestent, remettent en cause la gestion financière des flux de patients. Cette idéologie tue la recherche en soins. Elle produit de la routine.
Chercher c’est résister à cet air du temps qui ferme les lits et déshabille le secteur dans le même mouvement. On résiste mieux à plusieurs que tout seul. Il faut se regrouper en collectif de chercheurs. C’est ce que nous avons fait il y a trente ans dans ce qui allait devenir l’association serpsy (Soin Etude et Recherche en psychiatrie). Résister c’est se faire stratège, utiliser toutes les failles d’un système qui n’en manque pas, d‘où l’utilité du collectif. S’il le faut : créer un groupe d’EPP sur le thème à propos duquel il nous importe de chercher. Une EPP sur les alternatives à l’isolement et la contention, sur les pratiques d’entretien clinique infirmier, sur le cadre thérapeutique des médiations, sur les savoirs que les patients peuvent mobiliser pour améliorer la qualité de l’ambiance au sein des unités (dans ce cas il serait de bonne politique de parler de savoir expérientiel), etc., etc. Le temps compté du quotidien se libère miraculeusement pour améliorer la note finale de l’établissement lors de la visite de certification. Il existe ainsi plein de ruses, de fils à tirer. Fureter encore et toujours. Avec méthode.
Je vous souhaite d’avoir beaucoup de fils à tirer.
Dominique Friard
[1] FRIARD (D), Epistémologie du soin infirmier. De la blouse blanche à la toge universitaire, Editions Seli Arslan, 2021.
[2] WATSON (J), Le caring : philosophie et sciences des soins infirmiers, trad ; Josiane Bonnet (dir), Editions Seli Arslan, Paris, 1998.
[3] McEWEN (M), BECHTEL ‚(GA). Characteristics of Nursing Doctoral Programs in the United States, in J Prof Nurs. 2000 Sep-Oct ;16(5) :282-92.
[4] DALLAIRE (C), La difficile relation des soins infirmiers avec le savoir, in Recherche en soins infirmiers, n° 121, 2015/2, pp. 18-27.
[5] POLETTI (R), « Témoignage », in H. Zilliox, On les appelait « gardiens de fous », Privat, Toulouse, 1976, p. 154-157.
[6] GERARD (J.-L.), Infirmiers en psychiatrie : nouvelle génération. Une formation en question, Paris, Lamarre, 1993.
[7] FRIARD (D), L’objet « introuvable » de la science dite infirmière, in Perspective soignante, n° 67, Avril 2020.
[8] HUGHES (E), Les honnêtes gens et le sale boulot, in Travailler, 2010/2, n° 24, p. 21-34.
[9]. RANGARAJ (J), BURTIN (J-M), « L’Entraînement aux habiletés sociales (jeu de compétence selon Favrod) chez des patients schizophrènes », Journal de Thérapie Comportementale et Cognitive, vol. 16, n° 4, décembre 2006, p. 146-150.
[10] Décret n° 90-82 du 22 janvier 1990 relatif à l’évaluation des politiques publiques
[11].MARTEL (F), « La Recherche en soins infirmiers, stratégie scientifique et politique de l’infirmière générale », Recherche en Soins Infirmiers, n° 33, 1993, p. 5-29.
[12].DELMAS (P),« Hardiesse : une caractéristique de la personnalité protectrice du stress », EMC Savoirs et Soins infirmiers, n °60-470-U-10, vol. 2, 2011, p. 1-9.
[13].PERRON (A), « Les Pratiques alternatives en santé mentale comme formes de désobéissance au service des usagers », Conférence d’ouverture, Actes de Forum États des Droits en Santé Mentale, Regards critiques et Nouvelles pratiques, 10-11 mai 2018, Université du Québec en Outaouais.
[14].OURY (J), Le Collectif. Le Séminaire de Sainte-Anne, Paris, Champs Social, 2005.
[15].MARTEL (F), « La Recherche en soins infirmiers… », art. cité.
[16].Grand Dictionnaire de psychologie, Paris, Larousse, 1990.
[17] ANSELME (G), LANQUETIN J-P, QUINET (P), Spécificité des soins infirmiers en hôpital psychiatrique, in Soins Psychiatrie, n° 194, février 1998.
Ajouter un commentaire