Durkheim Emile, Le suicide
Le suicide
Emile Durkheim
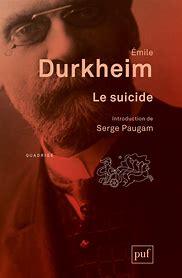
Le suicide ne se lit pas seulement du côté de la clinique, il peut être analysé comme un fait social. E. Durkheim fonde la méthode sociologique sur cette rupture épistémologique qui enrichit notre perception des suicides.
Introduction
Le but de Durkheim est de constituer la sociologie en une discipline autonome qui étudie les lois qui président à l’évolution des sociétés et transposent les principes de la morale pour en faire une science positive. Il est essentiellement l’auteur de quatre livres : " De la division du travail " (1894), "Les règles de la méthode sociologique " (1895), " Le suicide " (1897), " Les formes élémentaires de la vie religieuse " (1912).
Avant d’étudier " Le suicide ", nous ferons un détour par " Les règles de la méthode sociologique ", ouvrage dans lequel Durkheim explicite sa méthode.
Les règles doivent affranchir la sociologie des suggestions du sens commun. Durkheim se veut rationaliste. Son objectif est de montrer que les conduites humaines sont réductibles à des rapports de cause à effet qu’une opération rationnelle peut transformer en règles d’action pour l’avenir.
La première règle, la plus célèbre est que " Les faits sociaux doivent être considérés comme des choses ". Il ne s’agit pas, pour Durkheim de prétendre qu’ils seraient du même ordre que les faits naturels, mais d’affirmer qu’ils ne nous sont en général pas directement compréhensibles, parce qu’ils sont d’une autre nature que les comportements individuels. " Est chose tout objet de connaissance dont nous ne pouvons nous faire une idée adéquate par un simple procédé d’analyse mentale, tout ce que l’esprit ne peut arriver à comprendre qu’à condition de sortir de lui-même, par voie d’observation et d’expérimentation. " Traiter objectivement les faits sociaux c’est les considérer comme des objets de science, d’une autre nature que la subjectivité du sociologue.
Une autre règle est que l’explication ne peut consister qu’en l’établissement d’une relation causale, qui ne peut relier que deux phénomènes de même nature. Un fait social ne peut donc être expliqué que par un autre fait social. L’analyse doit aboutir à une transparence pour l’intelligence. Mais ce qui apparaît comme tel dans la phase d’exposition des résultats doit d’abord être conquis par l’argumentation, l’expérimentation, dans la phase d’investigation préalable.
Durkheim va chercher les règles relatives à la distinction entre phénomènes normaux et pathologiques. Cette distinction constituant le fil conducteur de ce séminaire, nous nous y arrêterons un peu.
Pour Durkheim, les faits sociaux (comme les faits biologiques) sont susceptibles de revêtir deux formes : la première générale ne connaît que des variations minimes et correspond à la normalité, la seconde est exceptionnelle dans le temps comme dans l’espace et caractérise la pathologique. Dans l’ordre biologique, la maladie est du premier ordre et la monstruosité du second.
Mais cette distinction reste extérieure aux faits en question : elle constitue une première approche qu’il faut dépasser en expliquant cette généralité par des phénomènes normaux. Par cette explication, " on érige cette normalité de fait en normalité de droit ". Cette preuve est surtout utile " pour éclairer la pratique ". Car " pour agir en connaissance de cause, il ne suffit pas de savoir ce que nous devons vouloir mais pourquoi nous le devons. "
Pour cela le sociologue " après avoir établi par l’observation que le fait est général, remontera aux conditions qui ont déterminé cette généralité dans le passé et cherchera ensuite si elles sont encore données dans le présent, ou si elles ont changé ".
Durkheim prend l’exemple du crime qui " est un fait dont le caractère pathologique paraît incontestable ". Pourtant, il s’observe dans toutes les sociétés de tous les types, même si la criminalité change de forme. Le phénomène présente donc " tous les symptômes de la normalité, puisqu’il apparaît comme étroitement lié aux conditions de toute vie collective ".
Et en effet " le crime est normal parce qu’une société qui en serait exempte est tout à fait impossible ". Car pour que, dans une société donnée, les actes réputés criminels cessent d’être commis, il faudrait que les sentiments collectifs que protègent son droit pénal acquièrent une intensité supérieure et pénètrent alors dans les consciences qui leur étaient jusqu’alors fermées. Mais alors, si ces états forts de la conscience commune étaient renforcés, les états faibles le seraient aussi " dont la violation ne donnait précédemment naissance qu’à des fautes purement morales ". Les lésions de l’ordre social jusque là considérées comme bénigne " seront l’objet d’une réprobation plus énergique qui fera passer certaines d’entre elles, de simples fautes morales qu’elles étaient, à l’état de crimes. Par exemple les contrats indélicats ou indélicatement exécutés, qui n’entraînent qu’un blâme public ou des réparations civiles, deviendront des délits ".
Ainsi les crimes existent toujours, mais c’est leur définition pénale qui évolue traduisant l’évolution de la conscience collective.
On pourrait se demander pourquoi même les individus " les plus faibles ne prendraient pas assez d’énergie pour prévenir toute dissidence ". C’est parce qu’il ne peut pas exister de société où les individus ne divergent pas plus ou moins du type collectif. Dès lors, il est inévitable aussi, que, parmi ces divergences, il y en ait qui présentent un caractère criminel. Car ce qui leur confère ce caractère, ce n’est pas leur importance intrinsèque, mais celle que leur prête la conscience commune.
" Le crime est donc nécessaire, il est lié aux conditions fondamentales de toute vie sociale; mais par cela même, il est utile; car ces conditions dont il est solidaire sont-elles mêmes indispensables à l’évolution normale de la morale et du droit ".
Ces dernières se modifient avec les conditions de l’existence collective. Or pour que ces transformations soient possibles, " il faut que l’autorité dont jouit la conscience morale ne soit pas excessive; autrement, nul n’oserait y porter la main et elle se figerait trop facilement sous une forme immuable ". " S’il n’y avait pas de crime, cette condition ne serait pas remplie ".
Outre cette utilité indirecte, " il arrive que le crime joue lui-même un rôle utile dans cette évolution ". Ainsi " la liberté de pensée dont nous jouissons actuellement n’aurait jamais pu être proclamée si les règles qui la prohibaient n’avaient été violées, avant d’être solennellement abrogées ". C’est pourquoi " contrairement aux idées courantes, le criminel n’apparaît plus comme un être radicalement insociable, comme une sorte d’élément parasitaire ". " C’est un agent régulier de la vie sociale ".
Si le crime est une maladie, la peine doit en être le remède et ne peut être conçue autrement ... " Mais si le crime n’a rien de morbide, la peine ne saurait avoir pour objet de la guérir et sa vraie fonction doit être cherchée ailleurs ".
Si le crime est normal, il n’en est pas moins normal que les crimes soient punis. " L’institution d’un système répressif n’est pas un fait moins universel que l’existence d’une criminalité, ni moins indispensable à la santé collective ".
Le sens commun ne pourrait admettre qu’une chose détestable puisse être en même temps utile. " Et pourtant, est-ce que nous ne détestons pas la souffrance ? Et cependant un être qui ne la connaîtrait pas serait un monstre. Le caractère normal d’une chose et les sentiments d’éloignement qu’elle inspire peuvent même être solidaires. Si la douleur est un fait normal c’est à condition de n’être pas aimée; si le crime est normal, c’est à condition d’être haï ".
Si le fait social exerce sur les individus une contrainte extérieure, c’est parce qu’il est d’une autre nature que le fait psychologique. Et c’est pourquoi, pour le comprendre, il faut le traiter comme une chose, c’est-à-dire objectivement. Ce qui empêche une compréhension vraie des faits sociaux c’est qu’avant de devenir objets des sciences, ou objets de pensée, c’est-à-dire des concepts (pour prendre une formulation plus contemporaine) " ils se trouvent déjà représentes dans l’esprit " par des prénotions. Car " la réflexion est antérieure à la science qui ne fait que s’en servir avec plus de méthode. L’homme ne peut pas vivre au milieu des choses sans s’en faire des idées d’après lesquelles il règle sa conduite. Seulement parce que ces notions sont plus près de nous, et plus à notre portée que les réalités auxquelles elles correspondent, nous tendons naturellement à les substituer à ces dernières et à en faire la matière de nos spéculations. Au lieu d’une science de réalité, nous ne faisons plus qu’une analyse idéologique ".
" Les hommes n’ont pas attendu l’avènement de la science sociale pour se faire des idées sur le droit, la morale, la famille, l’Etat, la société même. Car ils ne pouvaient s’en passer pour vivre ". " Tout contribue à nous faire voir dans ces prénotions la vraie réalité sociale ".
Autrement dit, pour vivre, les hommes ont besoin de repérer ce qui est normal et ce qui est pathologique, notions qui sont formées par la pratique et pour elle. Le sociologue doit donc chercher à se débarrasser de ces prénotions, de ces idées reçues.
Si le crime apparaît pathologique, le crime contre soi, le suicide l’est tout autant sinon plus. Après avoir montré les règles que Durkheim s’est fixées, nous allons voir comment il constitue le suicide en fait social et comment il dépasse les prénotions, les idées reçues sur le suicide, notamment sous l’angle du normal et du pathologique.
Le suicide
Durkheim définit le suicide, fait social, objet de son étude, comme " tout cas de mort qui résulte directement ou indirectement d’un acte positif ou négatif, accompli par la victime elle-même et qu’elle savait devoir produire de résultat ".
La définition de Durkheim est curieusement très large. Peuvent être appelés l’acte héroïque d’un soldat qui tente de sauver un camarade sous une grêle de balles, l’acte chevaleresque d’un passant qui se jette dans une mer agitée pour tenter de sauver quelqu’un qui se noie, la mort de l’amant abandonné par sa maîtresse, celle du conducteur ivre qui prend le volant. Au lieu de restreindre l’objet d’étude, Durkheim l’élargit.
Il ne peut " prendre pour objet de ses recherches les groupes de faits tout constitués auxquels correspondent les mots de la langue courante. Mais il est obligé de constituer lui-même les groupes qu’il veut étudier, afin de leur donner l’homogénéité et la spécificité qui leur sont nécessaires pour pouvoir être traités scientifiquement ".
Le point commun entre toutes ces morts, qu’elles soient héroïques ou qu’elles soient la conséquence de l’intention de se tuer est que le sujet renonce à l’existence, " et les différentes manières d’y renoncer ne peuvent être que des variétés d’une même classe ".
" D’ordinaire, écrit Durkheim, on commence par une certaine conception de l’idéal moral et on cherche ensuite si le suicide y est ou non logiquement contraire ... Une déduction sans contrôle est toujours suspecte, et, de plus ... elle a pour point de départ, un pur postulat de la sensibilité individuelle; car chacun conçoit à sa façon cet idéal moral qu’on pose comme un axiome ".
Le suicide, ainsi défini, ne pourra simplement correspondre aux catégories du normal et du pathologique, si chacun est prêt à considérer que le suicide du désespéré est pathologique, il n’en va pas de même pour le martyr qui meurt pour sa foi.
Nous allons voir que la psychologie, que l’aliénisme ne peuvent rendre compte du suicide. Aucun facteur individuel ne peut fournir de clés permettant d’expliquer le suicide. Si l’individu se suicide, c’est qu’il est mené à l’autolyse par une force plus grande que lui qui le dépasse.
Comme pour le crime, on peut considérer l’ensemble des suicides commis dans une société donnée pendant une unité de temps donnée. On constate alors que le total ainsi obtenu n’est pas une simple somme d’unités indépendantes " mais qu’il constitue par lui-même un fait nouveau et sui generis, qui a son utilité et son individualité, sa nature propre par conséquent, et que, de plus, cette nature est éminemment sociale ". Pour une même société ce chiffre est à peu près invariable. Chaque société a donc, à chaque moment de son histoire, " une aptitude définie pour le suicide " qui se mesure en prenant le rapport entre le chiffre global des mots volontaires et la population de tout âge et de tout sexe. Cette donnée est nommée " taux de la mortalité-suicide propre à la société considérée ".
Pour montrer que ce taux social est un état sui generis de l’âme collective et non pas seulement la somme des suicides individuels, il faut rechercher les conditions dont il dépend. Parmi les conditions individuelles, il y en a certainement beaucoup qui ne sont pas assez générales " pour affecter le rapport entre le nombre total des morts volontaires et la population ". " Elles peuvent faire, peut-être, que tel ou tel individu isolé se tue, non que la société in globo ait pour le suicide un penchant plus ou moins intense ". Le sociologue, au contraire du psychologue, recherche les causes par l’intermédiaire desquelles il est possible d’agir, non sur les individus, mais sur le groupe. Les seuls suicides qui l’intéressent sont donc ceux qui font sentir leur action sur l’ensemble de la société. Avant de s’intéresser aux causes sociales proprement dites, il faut examiner l’influence des causes extra-sociales sur le taux de suicide.
Le taux de suicide ne s’explique pas par des facteurs individuels
Si le suicide est un acte positif ou négatif accompli par la victime elle-même et qu’elle savait devoir produire ce résultat, comment classer le suicide de l’aliéné, c’est-à-dire le suicide de celui qui est autre à lui-même ? Faut-il classer de la même façon le suicide de l’halluciné et celui de l’homme censé savoir ce qu’il fait ?
Pour les aliénistes, " l’homme n’attente à ses jours que lorsqu’il est dans le délire et les suicidés sont aliénés ". Le suicide serait donc soit une folie spécifique, une monomanie, soit la conséquence d’une ou de plusieurs sortes de folies.
La monomanie serait une folie suicide, c’est-à-dire un délire très restreint qui aurait pour cible un homme sain sauf en un point particulier de sa personnalité. Seules son intelligence ou son affectivité seraient atteintes. Le passage à l’acte se ferait ainsi sous l’influence d’une passion anormale. En fait, a science a abandonné cette croyance. Suivant en cela Falret, Durkheim énonce que " les troubles en apparence locaux résultent toujours d’une perturbation plus étendue ... Ils sont ... des accidents particuliers et secondaires de maladies plus générales ".
Si les aliénistes rapportent que tous les suicidés sont des aliénés, c’est que les seuls suicides qu’ils ont pu connaître sont ceux d’aliénés, rien ne prouve que cela soit vrai, ils méconnaissent tous les autres cas qui sont, selon Durkheim, les plus nombreux.
Durkheim classe les suicides d’aliénés en quatre catégories, qui sont celles de Jousset et Moreau de Tours. Il distingue le suicide maniaque, le suicide mélancolique, le suicide obsessif et le suicide impulsif.
Le suicide maniaque est dû à des hallucinations (danger imaginaire, obéissance à un ordre reçu, etc.). C’est un état mobile dans lequel alternent souvent conscience et inconscience.
Le suicide mélancolique est lié à un état d’extrême tristesse. C’est un état constant.
Le suicide obsessif est causé par une idée fixe et constante de la mort sans qu’il y ait motif réel ou imaginaire.
Le suicide impulsif n’est motivé par aucune raison dans la réalité ou dans l’imagination. Il résulte d’une impulsion irrésistible et immédiate (ce serait celui qui se rapprocherait le plus de la monomanie.
Tous ces suicides vésaniques sont soit déterminés par des motifs purement imaginaires ou soit dénués de tout motif objectivables.
Et pourtant, dans la réalité, nombreux sont les suicides qui ont des raisons objectivables et non imaginaires.
Il existe entre l’aliénation mentale et le parfait équilibre un état intermédiaire qu’on appelle " la neurasthénie ". C’est un état dépressif chronique très répandu auquel s’ajoute une asthénie physique. Il est très vraisemblable que ce type psychologique soit celui qui se rencontre le plus souvent chez les suicidés. " Reste à savoir quelle part cette condition tout individuelle a dans la production des morts volontaires. Suffit-elle à les susciter pour peu qu’elle y soit aidée par les circonstances, ou bien n’a-t-elle d’autre effet que de rendre les individus plus accessibles à l’action de force qui leur sont extérieures et qui seules constituent les causes déterminantes du phénomène ? "
Comme il n’est pas possible de comparer les variations du suicide à celles de la neurasthénie, on peut trouver un biais en partant de l’idée que la folie n’étant que la forme amplifiée de la dégénérescence nerveuse, on peut admettre que le nombre des dégénérés varie comme celui des fous et substituer, la considération des seconds à celle des premiers.
En déterminant si le taux de suicide varie comme celui de la vésanie, on aura une idée de la façon dont la neurasthénie influe sur le taux de suicide. Le taux social de suicide ne soutient aucune relation définie avec la tendance à la folie, ni par voie d’induction avec les différentes tendances à la neurasthénie que l’on prenne les sexes, les cultes, les âges, les pays et les degrés de civilisation comme variables.
Cet absence de lien repérable tient à l’ambiguïté des effets de la neurasthénie. La dégénérescence implique une constitution plus faible, une sensibilité accrue à la douleur, une résistance moindre à la frustration. Elle implique également par le besoin qu’a le névropathe de prendre de la distance, une capacité à la méditation, un développement des fonctions intellectuelles. Ainsi, le neurasthénique étouffe dans une société trop figée, trop traditionnelle, trop immuable, mais que la société qu’il contribue à dynamiser s’engage résolument sur la voie du progrès et ses capacités de représentation indispensables lui permettront de jouer son rôle social et d’ensemencer la société par son idéalisme ardent, son dévouement actif.
Il n’y a pas non plus de rapport entre le taux de suicide et la distribution géographique des délits d’alcoolisme, des folies alcooliques, de la consommation d’alcool.
Ainsi, même si nous pouvons admettre qu’en des circonstances identiques, le dégénéré se tue plus facilement que l’homme sain, il ne se tue pas nécessairement à cause de son état. D’autres causes déterminent son acte.
L’homme pourrait se tuer non pas à cause de tares psychologiques mais à cause d’éléments organiques qui pourraient être transmis génétiquement. Il y aurait ainsi des races qui se tueraient davantage que d’autres. Que l’on considère la race comme une collection d’individus qui présentent un certain nombre de points communs dus à une souche identique, ou comme une variation qui distingue des individus provenant d’une même génération sexuelle, héréditairement transmissible on butera sur le fait que le suicide n’a pas de caractère héréditaire.
On pourrait également se demander pourquoi le suicide touche moins de femmes et d’enfants alors que le vieillard y est particulièrement sujet. " La façon dont le suicide varie selon les âges prouve que, de toute manière, un état organico-psychique n’en saurait être la cause déterminante. "
Le suicide n’est possible que si la constitution des individus ne s’y refuse pas, mais l’état individuel qui le lui est le plus favorable consiste en une aptitude générale et vague qui permet le suicide mais ne l’implique pas nécessairement et n’en donne donc pas l’explication.
Les facteurs cosmiques pourraient fournir à la personnalité fragile un élément déclenchant.
Si selon Morselli, c’est au Nord et au Sud de l’Europe qu’on se suicide le moins et au centre que le taux de suicide apparaît être le plus élevé, le climat ne se modifie pas parallèlement à l’augmentation du taux de suicide.
Il est cependant incontestable que le maximum de suicides se produit en été, et par ordre, décroissant au printemps, en automne et en hiver. Les chaleurs anormales n’y sont pour rien, pas plus que les froids anormaux. On peut noter un rapport plus convaincant entre les variations mensuelles du suicide et la longueur des jours. Ce parallèle est confirmé par le fait que les suicides ont surtout lieu le jour, c’est-à-dire au moment où la vie sociale est le plus intense. Le taux de suicide est maximum aux jours et heures où l’activité sociale est maxima. Il baisse la nuit et pendant le week-end.
Le suicide varie donc selon des critères sociaux.
Avant de conclure définitivement, il reste à examiner le rôle de l’imitation dans le taux social des suicides.
" Il y a imitation quand un acte a pour antécédent immédiat la représentation d’un acte semblable, antérieurement accompli par autrui, sans que, entre cette représentation et l’exécution s’intercale aucune opération intellectuelle, explicite ou implicite, portant sur les caractères intrinsèques de l’acte reproduit. "
Il semble bien que l’idée du suicide se communique comme contagieusement d’individu à individu. L’influence de l’imitation peut être étudiée à travers la distribution géographique des suicides. En fait aucune trace visible de contagion n’apparaît. Si l’imitation peut-être un facteur important au niveau individuel, elle ne l’est pas au niveau social, car elle ne modifie pas les taux de suicide.
Il existe bien pour chaque groupe social une tendance spécifique au suicide indépendante des facteurs extra-sociaux.
Les causes sociales du suicide
Avant de pouvoir classer les différents types de suicide, en prenant leurs causes comme critère, il faut montrer l’évolution du taux de suicide en fonction de différents facteurs sociaux.
Les statistiques fournissent des renseignements peu fiables. Elles se bornent à répertorier des événements de vie qui s’ils semblent fragiliser l’individu n’expliquent pas les facteurs sociaux responsables de l’importance du taux de suicide dans les différentes sociétés.
Si on examine l’influence des différentes religions sur le taux de suicide, on se rend compte que les protestants se suicident davantage que juifs et catholiques. On pourrait penser que cette immunité relative des catholiques tient à la position dominante de l’église catholique en Europe. En fait, même minoritaires, comme en Allemagne, les catholiques restent préservés. La raison en est que le catholicisme est très structuré, très hiérarchisé, très dogmatique. L’individu n’a qu’une part très restreinte d’autonomie. Chez les protestants, à l’inverse, le rapport direct à Dieu implique une absence totale de hiérarchie, une absence de dogme. C’est ainsi que l’église anglicane, plus hiérarchisée, préserve relativement plus du suicide que les autres églises protestantes.
L’appétence au savoir varie comme l’individualisme religieux. Ainsi ce goût plus prononcé chez les protestants que chez les catholiques varie parallèlement au taux de suicide toutes les fois qu’il correspond à un progrès de l’individualisme religieux.
En conséquence, la science serait le remède au mal que symptomatise le progrès des suicides, mais n’en pas la cause. La société religieuse préserve du suicide mais uniquement dans la mesure où elle n’assigne à l’individu qu’une place réduite, et, où l’individu intègre la place qui lui est dévolue dans ce système de valeur.
La famille préserve du suicide. Les mariage trop précoces ont une influence aggravante sur le suicide, surtout chez les hommes. A partir de l’âge de vingt ans, les mariés bénéficie d’un coefficient de préservation vis-à-vis des célibataires.
Le coefficient de préservation des époux par rapport aux célibataires varie avec les sexes. Le veuvage diminue le coefficient des époux des deux sexes mais ne le supprime pas complètement.
Ce n’est pas l’action du mariage qui immunise les époux du suicide mais celle de la famille. Plus la famille compte de membres, plus le nombre de suicides recule. Le degré d’intégration familial préserve bien du suicide.
Si nous nous intéressons maintenant aux crises politiques et nationales, nous nous rendons compte que les crises préservent du suicide, ce qui confirme bien cette notion d’intégration au groupe social.
" Si comme on l’a souvent dit l’homme est double, c’est qu’à l’homme physique se surajoute l’homme social. Or ce dernier suppose nécessairement une société qu’il exprime et qu’il serve. Qu’elle vienne au contraire à se désagréger, que nous la sentions plus vivante et agissante autour de nous et au dessus de nous, et ce qu’il y a de plus social en nous se trouve dépourvu de tout fondement objectif ".
L’homme se trouve donc fragilisé par la désagrégation des groupes sociaux.
" Si donc on convient d’appeler égoïsme cet état où le moi individuel s’affirme avec excès en face du moi social et aux dépens de ce dernier, nous pourrons donner le nom d’égoïste au type particulier de suicide qui résulte d’une individuation démesurée. "
Si l’individuation démesurée conduit au suicide, l’individuation trop faible y conduit également.
On remarque essentiellement ce phénomène dans les sociétés inférieures qui prescrivent le suicide dans certaines circonstances. Ces sociétés dans lesquelles l’homme social prend le pas sur l’homme physique nous permettent d’introduire la notion de suicide altruiste qui comprend trois variété : le suicide altruiste obligatoire (l’individu doit se tuer), le suicide altruiste facultatif (il serait mieux que l’individu se tuât), le suicide altruiste aigu (l’individu se tue pour le " plaisir ").
Remarquons, dans le même ordre d’idée, que les armées européennes ont un taux de suicide très important. Cette aggravation due au service militaire ne dépend ni du célibat, ni de l’alcoolisme, ni d’un quelconque dégoût du service (elle croît avec la durée de l’engagement). Les plus touchés sont les volontaires et rengagés et surtout officiers et sous-officiers. Cette aggravation est liée à l’altruisme qu’implique l’esprit militaire. Le soldat se doit à son corps d’armée. La preuve en est que le taux de suicide augmente d’autant plus que la population se détourne du suicide et inversement.
Pour survivre, tout être vivant doit trouver un équilibre satisfaisant entre ses besoins et ses moyens de les satisfaire.
Pour l’homme, cet équilibre est plus délicat à trouver. Les besoins de l’homme, être social, sont limités par la société. Elle est la seule instance modératrice que l’homme reconnaisse. Elle limite les passions de l’homme qui peut grâce à elle échapper à un destin de perpétuel insatisfait. La société a le pouvoir moral d’édicter des lois, de poser des interdits, de distribuer des rémunérations. Chacun peut ainsi déterminer jusqu’où son ambition peut aller. Il existe bien sûr, un certain espace de liberté, voire même de conquête, mais cet espace est limité.
Qu’une perturbation de l’ordre collectif, qu’une rupture d’équilibre détruisent cette harmonie et il n’existe plus de limite. Tout devient permis ou plus rien ne l’est. Toute ambition devient au choix légitime ou illégitime sans que rien ne vienne la borner. L’échelle selon laquelle les besoins de chacun, de chaque classe sociale se réglaient devient inopérante. Il faut du temps avant que tout se réglemente à nouveau. On ne sait plus ce qui est juste ou injuste, ce qui est possible ou non. On ne sait plus si l’on doit se battre et contre qui ou quoi se battre. Pour un temps donc, tout est sans dessus dessous. Le suicide auquel correspond cet état de la société est le suicide anomique.
Il est confirmé par la croissance du taux de suicide lors des crises économiques, mais également par le maintien de cette aggravation lors des périodes de croissance.
L’anomie économique n’est pas seule responsable du suicide anomique. L’anomie conjugale a elle aussi sa part de responsabilité dans cette croissance. On peut ainsi établir un parallélisme entre divorces et suicide. L’affaiblissement de la discipline matrimoniale qu’implique le divorce aggrave la tendance au suicide chez les hommes et diminue celle des femmes.
Durkheim a ainsi pu établir trois types de suicides étroitement dépendants des facteurs sociaux et des relations que la société établit avec les individus qui la composent.
Revenant à la question posée, il peut affirmer que si chaque suicidé donne à son acte une touche personnelle qui retrace son tempérament, les conditions où il se trouve, etc. son acte ne saurait être pathologique puisqu’étroitement lié à la société dans laquelle cet homme a vécu.
Ainsi, en exceptant la vésanie, est-il possible de considérer que dans certaines sociétés et surtout selon la période qu’elle traverse il serait normal de se suicider. L’individu y serait contraint par le mode particulier d’organisation de la société dans laquelle il vit. Pourrait-on dire qu’il y est contraint en raison d’une pathologie de la société ? Les individus participant étroitement à la vie sociale, la société ne pourrait être malade sans que les individus qui la composent ne le soient à leur tour. La souffrance de la société serait leur souffrance.
Poser le problème de cette façon revient à partir d’une certaine conception des rapports individus/société, c’est affirmer que la société est première, c’est affirmer qu’en " s’unissant les individus forment un être psychique d’une espèce différente, qui a sa propre manière de penser et de sentir ", c’est affirmer que les états collectifs existent dans le groupe avant d’affecter l’individu en tant que tel et de s’organiser en lui sous une forme nouvelle, une existence purement intérieure.
" La vie sociale suppose à la fois que l’individu ait une certaine personnalité, qu’il soit prêt si la communauté l’exige à en faire l’abandon, enfin qu’il soit ouvert dans une certaine mesure aux idées de progrès. Pas de sociétés où ne coexistent ces trois courants d’opinions qui inclinent l’homme dans trois directions divergentes et même contradictoires. Là où ils se tempèrent mutuellement, l’agent moral est dans un état d’équilibre qui le met à l’abri de toute idée de suicide. Mais qu’un domine, il deviendra suicidogène en s’individualisant ".
Faut-il en déduire qu’il pourrait exister des sociétés au sein desquelles le suicide n’existerait pas ?
L’histoire montre que le suicide existe dans toutes les sociétés et qu’il est unanimement condamné sauf dans les périodes de décadence. Durkheim en infère qu’une " imperfection nécessaire n’est pas une maladie ... Il est impossible que ce qui est nécessaire n’ait pas en soi une perfection. Ce qui est une condition indispensable à la vie ne peut pas n’être pas utile, à moins que la vie ne soit pas utile ".
Quelle est donc la fonction sociale du suicide ?
L’étroite subordination de l’individu au groupe étant le principe sur lequel repose la société altruiste, le suicide y est un procédé indispensable de la discipline collective. Pour des raisons contraires, dans les sociétés et dans les milieux où la dignité de la personne est la fin suprême des conduites, l’homme/dieu s’érigeant lui-même en objet de son propre culte n’a plus qu’à se tuer incapable qu’il est de percevoir des idéaux qui le dépassent et l’amènent à lutter. Chez les peuples où le progrès est et doit être rapide, les règles qui contiennent les individus doivent demeurer suffisamment flexibles et malléables. La rigidité entraverait leur marche en avant. L’idéal de progrès implique que les hommes ne se résignent pas, ils sont donc davantage exigeants, et donc, mécontents et inquiets.
Tel un homme qui ne pourrait que travailler que moyennement, la société a besoin de gérer l’exceptionnel. Il lui faut des intellectuels individualistes pour secouer le joug des traditions et renouveler ses croyances, des soldats à l’esprit de sacrifice pour mener ses guerres. Il est indispensable que ceux qui incarnent ces valeurs aient une place dans la société, mais il est non moins indispensable que ceux-ci restent localisés, à leur place, en réserve.
Les neurasthéniques sont des vecteurs du progrès social, ils payent cette capacité créative par une plus grande fragilité. Cette fragilité, elle-même est nécessaire, car s’ils étaient plus résistants, leurs idées mélancoliques finiraient par déprimer l’ensemble de la société qui courrait alors à sa perte. Ces courants ne sont fondés que s’ils ne dépassent pas certaines limites.
Si comme l’affirme Durkheim " nous appelons normaux les faits qui présentent les formes les plus générales ", si nous considérons qu’un " fait social est normal pour un type social déterminé, considéré à une phase déterminée de son développement, quand il se produit dans la moyenne des sociétés de son espèce, considérées à la phase correspondante de leur évolution ... " nous pouvons dire qu’il est normal de se suicider.
Le taux de suicide est-il dans les moyennes des sociétés correspondantes à celle de Durkheim ?
Le taux de suicide a en fait connu une aggravation énorme, 385 % d’augmentation en France de 1826 à 1888. Cet accroissement est tel qu’il faudrait que l’organisation sociale se soit très profondément altérée dans le cours du siècle pour pouvoir l’expliquer. Il est impossible qu’une altération, à la fois aussi grave et aussi rapide ne soit pas morbide, car une société ne peut changer avec une telle soudaineté. Il s’agit d’un ébranlement maladif qui a déraciné les institutions du passé mais sans rien mettre à leur place. Ainsi ce qu’atteste cette augmentation du taux de suicide, c’est un état de crise et de perturbation qui ne peut se prolonger sans danger.
Ce qui est pathologique pour Durkheim, ce n’est pas l’acte suicidaire mais l’augmentation " exponentielle " de son taux. C’est en sortant des normes que le suicide, fait social, devient pathologique.
Peut-on considérer qu’il soit normal qu’un individu particulier se suicide ? Faut-il autoriser le suicide ? Non, répond Durkheim. Les sociétés ont toujours condamné certaines formes de suicide même si parfois, elles en ont tolérées certaines autres.
En se tuant l’homme dénoue et tranche le lien qui l’unit à la société, et aux autres hommes. L’homme étant devenu un dieu pour les autres hommes, tout attentat dirigé contre lui-même fait l’effet d’un sacrilège, l’homme fut-il lui même l’auteur de cet attentat. A partir du moment où l’on considère que la personne humaine est et doit être sacrée, à partir du moment où chacun est subordonné aux intérêts généraux de l’humanité, le suicide doit être proscrit. Cet intérêt supérieur de l’humanité ne peut être conçu que comme supérieur au réel et le dominant. Cette fin domine même les sociétés puisqu’elle est le but auquel est suspendu toute l’activité sociale. En aucun cas, il ne peut être possible d’autoriser l’homme à se tuer. Notre dignité d’homme moral a cessé d’être la chose de la cité, mais n’est pas pour cela devenue notre chose et nous n’avons pas acquis le droit d’en faire ce que nous voulons. Il est donc nécessaire de classer le suicide parmi les actes immoraux. Tout autre façon de considérer le suicide par la permissivité qu’elle impliquerait serait cause d’une élévation du taux de suicide.
Eléments de réflexion
Après avoir suivi Durkheim pas à pas, il est possible de faire rebondir notre réflexion sur les concepts de normal et de pathologique.
Nous pourrions définir la normalité comme l’ensemble de faits sociaux, de comportements individuels ou collectifs, de représentations, de critères objectifs ou subjectifs valables à un moment donné de l’évolution d’un goupe social qui décrit ce qui se fait habituellement dans ce groupe sans provoquer de remise en cause de ce groupe, et plus particulièrement de ce qui fonde ce groupe (mythes fondateurs, violence fondamentale, etc.). La notion de normalité suppose/ a pour corollaire celle d’anormalité ou de pathologie qui décrit ce qui est inhabituel, menaçant, inquiétant pour l’équilibre de ce groupe.
Ces deux concepts permettent d’assigner à chaque événement, à chaque comportement, une place qu’il soit habituel ou non.
Lorsqu’un comportement, un événement ne rentre pas ou plus dans ces normes, il est nécessaire de les réévaluer, et de faire évoluer les critères de normalité ou de pathologie.
En ce sens, il est possible de dire que ce qui est premier, c’est le pathologique, la normalité ne se créant que dans un second temps, d’une façon défensive.
Nous savons grâce à Durkheim que ces critères, ce qu’il appelle des prénotions, sont nécessaires à l’homme : " l’homme ne peut pas vivre au milieu des choses sans s’en faire des idées d’après lesquelles il règle sa conduite. "
Ces notions ne sont pas des substituts légitimes des choses mais sont " formés par la pratique et pour elle ". Pour penser, pour faire oeuvre scientifique il faut chercher à se débarrasser de ces prénotions, de ces idées reçues qui occultent la réalité. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire de développer une méthode, que ce soit " Les règles de la méthode sociologique " ou la dialectique hégélienne.
Les normes sociales prescrivent aux individus un certain nombre de comportements. Du respect total des normes à la désobéissance totale, l’un comme l’autre intenables, l’individu développe une variété quasi infinie de comportements. Pas un individu ne se situe de la même façon dans ce continuum, chacun se situant, lui-même, au centre d’une ligne allant du normal au pathologique, ni écrasé par les normes, ni libéré de ces normes.
L’individu a-t-il le choix de respecter on non ces normes, ou ses choix les plus intimes sont-ils dictés par une instance supérieure ?
" Les hommes, en tant qu’individus, et même des peuples entiers, ne se doutent guère qu’à la poursuite de leurs desseins personnels, chacun selon ses vues et souvent les uns contre les autres, ils suivent, comme un fil directeur, sans s’en apercevoir, le dessein de la nature qui leur est inconnu, et qu’ils travaillent à favoriser la réalisation de ce projet, qui ne leur importerait pas davantage s’ils le connaissaient ". Ces lignes de Kant, extraites de l’ " Idée d’une histoire universelle " pourraient avoir été écrites par Durkheim. A une nuance près. A la nature décrite par Kant a succédé la société objet d’étude de Durkheim.
Chez l’un comme chez l’autre, les manifestations du vouloir, les actions humaines sont déterminées par un plus grand que lui qui le dépasse.
Cette prédétermination de l’individu ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur les concepts de normal et de pathologique.
Si " derrière le cour insensé des choses humaines " il est possible de découvrir un dessein de la nature, il sera difficile de définir ce qui chez l’homme est normal et ce qui est pathologique. Si tout ce qui est humain découle de la folie, de la vanité puérile, de la méchanceté et si tout cela s’inscrit dans un plan naturel, on ne pourra considérer cette méchanceté, cette puérilité, cette folie comme pathologiques.
Toutes les dispositions naturelles d’une créature sont destinées à se développer un jour complètement et conformément à une fin. Il en va de même des dispositions naturelles de l’homme qui se rapportent à l’usage de sa raison. Mais celles-ci ne se développeront complètement que dans l’espèce, mais non dans l’individu. " La raison, dans une créature, est un pouvoir d’étendre les règles et les desseins qui commandent l’usage de toutes ses forces, bien au-delà de l’instinct naturel, et elle ne connait aucune limite à ses projets. "
La nature reprend Kant, " a voulu que l’homme tire entièrement de lui-même tout ce qui dépasse l’agencement mécanique de son existence animale et qu’il ne participe à aucun autre bonheur ou à aucune autre perfection que ceux qu’il s’est créés lui-même, libre de l’instinct, par sa propre raison ".
Le moyen dont se sert la nature pour mener à son terme le développement de toutes les dispositions des hommes est leur antagonisme dans la société, dans la mesure où cet antagonisme finira pourtant par être la cause d’un ordre réglé par la loi.
L’antagonisme décrit par Kant est l’insociable sociabilité des hommes. L’homme est un être double, divisé entre son penchant à entrer en société et une opposition générale qui menace sans cesse de dissoudre cette société.
Cette insociabilité, qui pousse l’homme à tendre toujours ses forces et à développer davantage ses dispositions naturelles dévoile selon Kant l’ordonnance d’un sage créateur.
De cette guerre de tous contre tous, de cet affrontement constant naîtrait le progrès. Kant pense que cet accord pathologiquement extorqué pour l’établissement d’une société va se transformer en un tout moral.
Si comme Kant, Freud pense que l’homme est un être divisé, il ne partage pas sa croyance en l’avènement d’un tout moral. La douloureuse expérience de la première guerre mondiale le conduit à penser qu’il s’agit là d’une illusion. De quelque point de vue que l’on se place, si les hommes se conduisent d’une façon cruelle et mauvaise, c’est qu’ils ne se sont pas élevés moralement aussi haut qu’on le pense. L’homme n’est pas mû que par la raison. Il est également mû par des désirs, des instincts, des pulsions de destruction qui s’opposent à sa raison. Chaque victoire de la raison est en réalité provisoire, si la raison est appelée à se développer, n’en est-il pas de même pour l’insrtinct animal ?
Comme Kant, Freud pense que l’accord pour l’établissement d’une société est pathologiquement extorqué. Pour Freud cet accord repose sur le meurtre et sur l’ingestion par tous ses fils du père de la horde primitive. Il s’agit là encore d’un pacte pathologiquement extorqué, d’un équilibre de la terreur.
Avec Durkheim, nous accomplissons un saut de côté important, ce n’est pas le comportement individuel qui est pathologique, quel que soit le rejet moral qu’il implique, mais le groupe social lorsque certains marqueurs sociaux (tels que le taux de suicide) connaissent des variations monstrueuses.
Durkheim se positionne, d’une façon assez proche, pour lui aussi l’homme est un être divisé. " Si comme on l’a souvent dit l’homme est double, c’est qu’à l’homme physique se surajoute l’homme social. Or ce dernier suppose nécessairement une société qu’il exprime et qu’il serve. Qu’elle vienne au contraire à se désagréger, que nous ne la sentions plus vivante et agissante autour de nous et au dessus de nous, et ce qu’il y a de social en nous se trouve dépour vu de tout fondement objectif ".
Nous comprenons aisément pourquoi l’homme est fragilisé par la désagrégation du groupe social. L’équilibre se trouve alors rompu. L’insociable sociabilité, les pulsions transformées en or par la pression sociale n’ont plus ce ferment, cette condition nécessaire pour aller vers le tout moral. Plus rien ne vient limiter la cruauté, la méchanceté humaine.
De ce point de vue Kant et Durkheim, se rejoignent, la société est la seule instance modératrice que l’homme reconnaisse. Elle limite les passions de l’homme qui peut grâce à elle échapper à un destin de perpétuel insatisfait (chez Kant et chez Freud, cet insatisfaction humaine serait contenu dans les termes). La société a le pouvoir moral d’énoncer des lois, de poser des interdits, de distribuer des rémunérations. Durkheim décrit comment l’anomie, la rupture d’équilibre viennent détruire la relative harmonie. Plus de limites, il devient légitime d’écraser son voisin. Il faut reconstruire un nouveau contrat social, retrouver un nouvel équilibre entre normal et pathologique. A ce moment, nous sommes bien, même chez Durkheim, dans le pathologique, le taux de suicide a explosé. Il faut d’une certaine façon soigner une société malade. On pourrait considérer qu’il faudra une guerre pour soigner la société contemporaine de Durkheim, guerre qui fondera un nouvel ordre, tout aussi pathologiquement extorqué, tout aussi axé sur une violence fondamentale. Il faudra que meurent des millions d’individus pour fonder ce nouveau pacte social.
Durkheim nous propose un nouveau concept, celui de neurasthénique, qui n’a pas vraiment une existence nosographique très précise, même à son époque. Dans quelle mesure, ne sommes nous pas tous des neurasthéniques, en attente d’une utilité sociale ?
Broyés par ce monstre froid qu’est la société durkheimienne, ne sommes nous pas condamnés au chômage, à la mort par suicide dès que notre utilité sociale diminue ? Tout cela évoque furieusement les minotaures, les monstres qui exigeaient leur tribu de jeunes filles vierges pour laisser en paix les cités grecques.
Le suicide nous rappellerait sur quoi s’origine la société. Plus la société serait malade, moins les mécanismes destinés à masquer la violence fondamentale seraient efficaces. En attente d’un nouveau pacte, de nouvelles violences se prépareraient tapies dans l’ombre.
Au secours !
Dominique Friard
Ajouter un commentaire