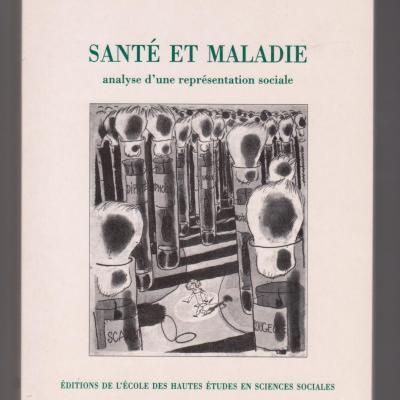Herzlich Claudine, Santé et maladie.
Santé et maladie.
Analyse d’une représentation sociale
Claudine Herzlich
Un ouvrage passionnant qui illustre l’apport de la sociologie aux soins. Le chaînon manquant entre le soin « à la française » et les diagnostics infirmiers. Il annonce les pairs-aidant et les médiateurs de santé avec quelques décennies d’avance. C'est également un ouvrage qui pose les fondements de l'éducation thérapeutique du patient.
" La relation qui s'établit entre l'individu et la maladie peut se formuler en termes de pouvoir : que peut-on face à la maladie ? On peut, certes, se soigner et tenter de la vaincre. Face à la "maladie destructrice", là n'est pas l'essentiel. Plus frappante nous paraît l'ambivalence entre la possibilité de "nier" la maladie, donc la toute-puissance à son égard, et une impuissance totale. Cette opposition en recouvre une autre : entre état organique et comportement. On peut nier, croit-on souvent, l'état organique, par la persistance du comportement de bonne santé. [...]"
L’auteur
C. Herzlich (née en 1932), psychosociologue de formation, dans la mouvance de Serge Moscovici, a commencé par étudier les représentations sociales de la maladie. Elle a ensuite mêlé la psychologie sociale et une perspective anthropologique qui étudie les conceptions de la maladie dans les sociétés traditionnelles. Il lui est apparu alors qu’on ne pouvait s’en tenir au niveau des représentations et qu’il fallait également aborder les pratiques et notamment la façon dont on gère la maladie chronique. En 1986, elle crée le CERMES) (Centre de Recherche Médecine, Science, Santé et Société) qu’elle dirige jusqu’en 1998. Elle a également été vice-présidente du Conseil National du sida.
" C'est dans la "maladie-métier" que l'on accorde le plus d'attention aux comportements du malade, que l'on en détaille chaque aspect. Le recours au médecin dans un triple but : diagnostic, thérapeutique et préventif, est l'essentiel; il définit sans doute le "rôle du malade". mais il est complémentaire avec la lutte personnelle et avant tout psychologique du malade : c'est grâce au "moral", à la volonté, pense-ton que les soins, l'action du médecin seront efficaces."
L’ouvrage
Santé et maladie sont vécues et pensées par l’individu en référence à ses rapports avec la société ; par la santé et la maladie, l’individu s’insère dans la société ou en est exclu. Le “ rôle ” du malade, c’est-à-dire les normes de conduite que la société, en l’occurrence l’entourage du malade, et en premier lieu, son médecin valorisent, les “ anticipations institutionnalisées ”, quant à sa conduite sont un mécanisme qui canalise la “ déviance ” de la maladie.
C’est à travers l’activité du bien-portant et l’inactivité du malade que s’exprime la relation de l’individu à la société : participation ou exclusion, éventuellement conformité ou déviance. Le sens que prend l’inactivité pour l’individu différencie trois modes d’organisation de la représentation, trois conceptions de la maladie –où s’insèrent modèles de comportement vis-à-vis de la maladie, des soins, des malades- corrélatifs des conceptions de la relation à la société. Ces trois conceptions sont la maladie destructrice, la maladie libératrice et la maladie métier.
Dans la maladie destructrice le sujet qui se reconnaît malade ressent l’inactivité, l’abandon de son rôle comme une violence qui lui est faite. L’inactivité signifie la destruction des liens avec les autres, l’exclusion, la solitude. Même malade, la personne persiste dans une conduite de santé. Il s’agit d’assurer pour l’individu la permanence de sa fonction sociale. On déclare l’inactivité insupportable mais on déprécie les quelques activités permises au malade ; elles ne peuvent constituer un palliatif. Presque toujours lié à l’inactivité apparaît le thème de la dépendance à autrui. De même que l’inactivité est insupportable pour ces personnes, la dépendance leur est pénible. L’aide est malaisément acceptée. On comprend donc aisément l’apparition sous diverses formes de sentiments d’angoisse qui culminent dans l’expression de thèmes d’anéantissement. La maladie, c’est le néant, c’est un terme, c’est la mort. La destruction, l’anéantissement, la mort ne sont pas la conséquence de la maladie, un danger pour l’avenir, mais sa réalité immédiate. C’est dans sa vie même que le malade est anéanti et sans avenir, c’est dans sa vie même qu’il est comme mort. La mort est alors psychologique et sociale avant d’être organique. La destruction menace la personnalité encore plus que le corps.
Pour certaines personnes, la maladie est libération. Comme pour la maladie destructrice, tout commence par l’inactivité. Mais, le sujet la ressent cette fois comme l’allégement des charges qui pèsent sur lui. Tel est le sens qu’il donne au repos. On insiste sur la rupture d’avec les contraintes sociales, sur “ l’effacement du quotidien ”, voire de la réalité elle-même. La maladie, c’est le monde de l’exceptionnel. On en souligne la douceur. L’exceptionnel peut prendre un caractère fantastique. On trouve le même balancement dans l’appréciation qui est faite du temps : tantôt on le ressent comme une “ halte ” dans la vie quotidienne ou l’on pense que la maladie donne du temps. Tantôt, on découvre une expérience du temps exceptionnelle et infiniment plus signifiante que le temps de la vie courante.
La désocialisation du malade est également présente mais elle prend dans cette conception un sens opposé : l’exclusion de la société est assumée non comme destruction, mais comme libération et enrichissement de la personne. Le malade, loin d’être anéanti, retrouve des possibilités de vie et de liberté.
La maladie peut apparaître enfin comme un métier. La fonction reconnue au malade est de lutter contre la maladie. Elle possède certains caractères d'un métier ; elle se prépare et s’apprend. La maladie apparaît comme la situation où l'on a recours au médecin et où l'on se soigne. L'accent est donc mis d'emblée sur la lutte active du malade. C'est grâce à la libération des charges de la vie quotidienne que l'individu trouve l'énergie nécessaire à la lutte contre la maladie. Comblée par cette lutte, l'inactivité devient acceptable.
La conception de la « maladie-métier » comporte deux points essentiels qui sont en quelque sorte les deux fondements de la lutte contre la maladie :
- le malade certes redoute la maladie mais il l'accepte toujours. Il ne se sent -au contraire du malade confronté à la maladie destructrice aucune possibilité de la nier, elle est là.
- contraint d'accepter la maladie -elle manifeste ainsi sa puissance- le malade a pourtant sur elle un pouvoir qui prend sa source dans la nécessité même d'accepter. Ce « pouvoir » comporte des degrés, des formes de plus en plus actives. D'abord, on « supporte » et l'on croit même qu'il n'existe ni maladie, ni douleur insupportable. Supporter est presque déjà synonyme de « surmonter ». On affirme que l'on peut s'adapter à la maladie, vivre avec les limitations qu'elle impose. Le malade peut par sa lutte participer à la guérison. Il la hâte ou la facilite. L'orientation vers la guérison est un des traits distinctifs de cette conception.
Dans la maladie-métier, on s'attache plus particulièrement à certaines caractéristiques des états et on envisage de manière spécifique les notions même de santé et de maladie.
C'est dans cette conception que la perception et donc l'intégration dans le concept de maladie, des phénomènes organiques est la plus complète. La douleur, la fatigue, voire même la température font partie de l'image de la maladie et servent à la définir. L'action, la lutte supposent la connaissance : l'atteinte est donc davantage perçue à son niveau corporel. La perception de la maladie est donc parallèlement plus différenciée : loin de l'envisager comme phénomène global (comme dans la maladie destructrice) ou de se limiter à quelques types de maladies (maladie libératrice), les malades utilisent maintes qualifications, opèrent de plus nombreuses distinctions, apprécient avec nuances, caractéristiques et types de maladies.
Une « forme » de santé est ici prépondérante : celle du fond de santé. Elle est d'abord le signe d'une « participation plus grande » de l'individu à son état, elle atteste qu'il se sent concerné dans son corps. Il est surtout le facteur principal de résistance à la maladie. Nous retrouvons sur ce plan le thème fondamental de la conception : d'une part l'acceptation se double d'une perception plus fine de l'atteinte corporelle, d'autre part la lutte de l'individu, son pouvoir se manifestent sur un double plan : psychologique, par le « moral », la « volonté », par le « fond de santé ».
C'est dans la maladie-métier qu'on accorde le plus d'attention aux comportements du malade. Le recours au médecin dans un triple but : diagnostique, thérapeutique et préventif est l'essentiel ; il définit sans doute le rôle du malade. Mais il est complémentaire avec la lutte personnelle et avant tout psychologique du malade. Les rapports avec le médecin sont alors conçus comme coopération, échange. A la limite, le « rôle du malade » semble aussi actif que celui du médecin, presqu'égal. On rejette l'obéissance stricte et passive au profit d'une relation plus symétrique. Cette volonté d'échange apparaît aussi sur le plan de l'information ; « savoir » pour le malade, c'est posséder une des conditions nécessaires au moral, à la lutte. C'est aussi exiger quelque chose du médecin, en retour de l'obéissance, de la confiance qu'il exige de vous.
L'image du malade fondée sur l'activité, sur la participation à la situation de malade perd alors son caractère dramatique.
L'expérience de la maladie perd aussi le caractère exceptionnel et la valeur bénéfique qu'on lui accordait dans la maladie libératrice. La personne en sort renforcée.
Dans la bouche des sujets, être « un malade » devient alors une catégorie sociale à l'égal des autres. Le monde des malades est un monde socialisé.
La maladie-métier se caractérise par :
- la conservation des valeurs sociales de la santé au sein de la maladie : activité, énergie, volonté définissent le malade et la maladie comme elles définissent le bien-portant et la santé.
- La maladie est une situation d'apprentissage : le malade apprend à lutter, devient « plus fort » et cet apprentissage semble réutilisable dans la santé.
- La guérison est l'issue normale de la maladie : le malade est « occupé à guérir ». La maladie représente essentiellement l'étape et la conduite par lesquelles, à partir de l'atteinte organique, on guérit. Elle est un « moment à passer » et s'insère donc au sein du temps socialisé de la santé.
- Dans le cas de la maladie chronique, l'adaptation est possible. L'individu se crée un nouveau mode de vie avec, certes, des limitations, mais aussi des compensations et de nouveaux intérêts.
Maladie et santé ne sont pas hétérogènes : elles s'incluent dans un même ensemble. La conduite du malade est le processus par lequel non seulement on répond à l'atteinte organique mais encore, on affirme la permanence de son appartenance à la société.
Du côté de la pratique
Les soignants conçoivent mal que les patients dénient être malades, surtout lorsqu'ils souffrent de schizophrénie. Les soignants disent qu'ils sont "dans" le déni. Ils pourraient tout aussi bien dire que ces patients adhèrent à une conception destructrice de la maladie. Nous passerions ainsi d'une approche psychopathologique à une approche sociologique. Beaucoup a été fait dans le registre de la maladie-métier, peut-on pour cela considérer que les malades mentaux et en particulier les schizophrénes sont mieux acceptés socialement ? Difficile de l'affirmer quand on lit une certaine presse et écoute le discours de certains hommes politiques. La conception destructrice de la schizophrénie doit beaucoup aux représentations sociales qui lui sont liées. Suffirait-il d'en changer le nom pour changer les représentations ? Probablement pas. Le "trouble de l'intégration", suggéré pour remplacer l'appelation honnie, deviendrait très rapidement un synonyme de folie. Dans notre société. Tous les termes désignant la folie à différents moments de l'histoire sont devenus péjoratifs.
L’intérêt pour les soins
Après avoir lu ce livre, on ne peut plus soigner comme avant. La conception technicienne du soin renforce la conception destructrice de la maladie. Il n’est qu’en insistant sur l’aspect relationnel que l’on peut aider le patient à passer de la maladie destructrice à la maladie métier. Dans ce sens-là, les diagnostics infirmiers peuvent prendre toute leur place. La pair-aidance repose sur la conception de la maladie métier. Qu'est-ce au fond que la démarche de soins ? C'est permettre au patient de passer de la conception de la maladie destructrice, à celle de maladie métier. C'est travailler au plus près du patient pour lui permettre d'énoncer la façon qu'il a de se représenter sa maladie et le soin qui lui est proposé. Les entretiens infirmiers permettent ainsi au patient de décrire le réseau sémantique de sa maladie et c'est à partir de ses différentes conceptions que l'on va lui proposer une démarche de soins et des objectifs à atteindre grâce à des actions infirmières choisies ensemble. Nous retrouvons-là la démarche propre à l'éducation thérapeutique du patient : repérer à quelle conception de la maladie adhère le patient, ce qu'il sait ou accepte de savoir à propos de sa maladie, comment il peut passer d'une conception à une autre.
Dominique Friard
Notes :
HERZLICH (C), SANTE ET MALADIE. Analyse d’une représentation sociale, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 1969.
Date de dernière mise à jour : 25/11/2023
Ajouter un commentaire