Visentini G., L'efficacité de la psychanalyse
L’efficacité de la psychanalyse
Un siècle de controverses
Guénaël Visentini
L'efficacité de la psychanalyse est l'enjeu d'une lutte idéologique à laquelle la science est relativement étrangère. De nombreuses évaluations, à haut standard scientifique (ECRs), montrent que les thérapies psychanalytiques sont parmi les plus efficaces des traitements testés.
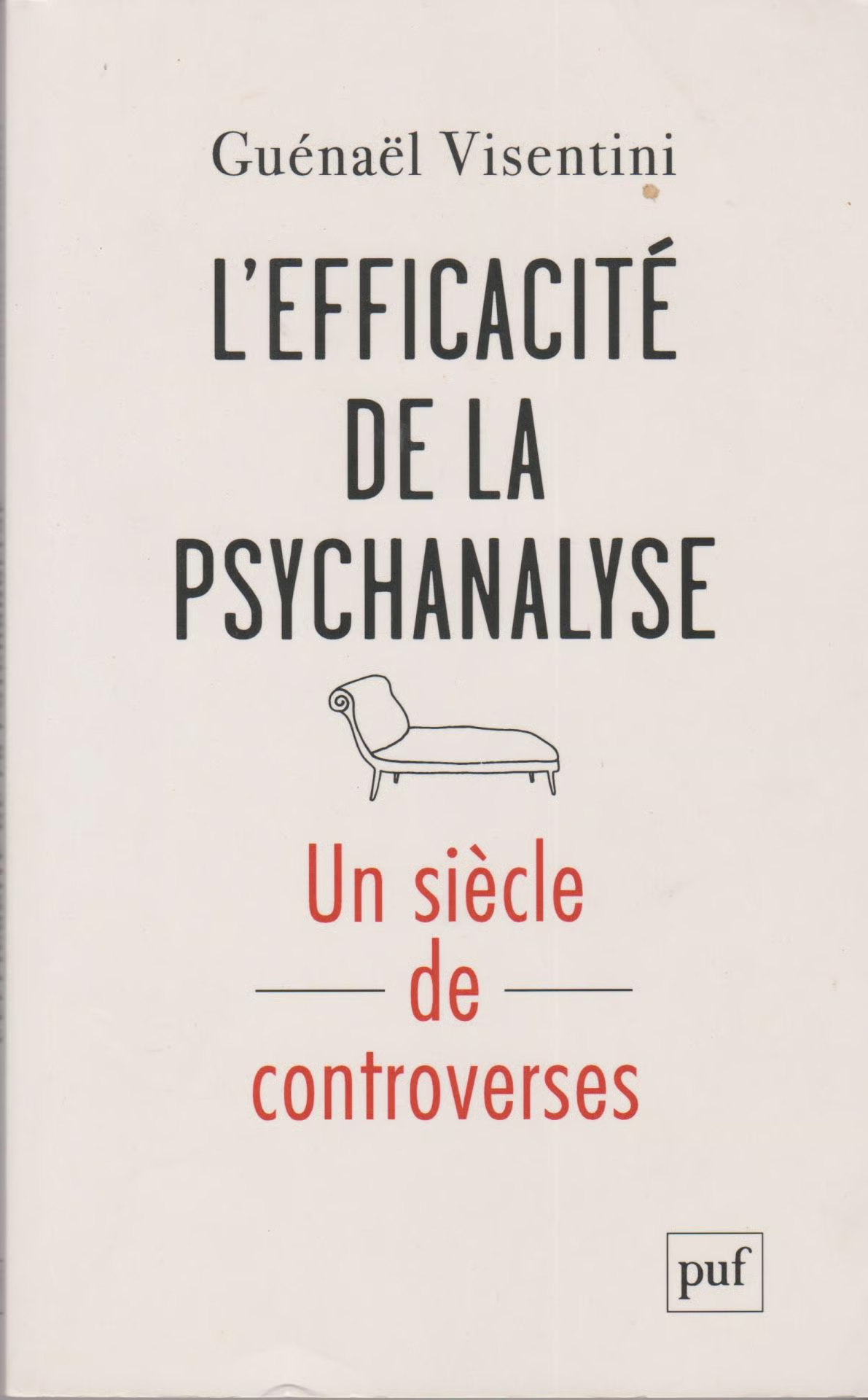
« Repensées pour pouvoir souscrire à ces exigences formelles des ECRs (Essais Contrôlés Randomisés), les démarches psychothérapiques elles-mêmes ont nécessité le respect des différents prérequis : leurs principes d’action ont été protocolisés ; les diagnostics ont été opérationnalisés ; les évaluations cliniques ont été standardisées ; on a mis en place des « groupes test » et des « groupes contrôle » ; et les patients comme les thérapeutes ont été aléatoirement répartis dans les différents groupes. Seule l’exigence du double aveugle (destinée à mesurer l’incidence différentielle de l’effet placebo dans les traitements donnés) est apparue impossible à exécuter. En effet comment « administrer » une psychothérapie et la « recevoir » sans un savoir subjectif sur ce que l’on « administre » (côté thérapeute) et sur ce que l’on reçoit » (côté patient) ? » (p.44)
L’auteur
Psychanalyste, ex-psychologue hospitalier en psychiatrie adulte, au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, psychologue clinicien au Centre d’Accueil médico-psychologique universitaire de Strasbourg (CAMUS), Guénaël Visentini est membre du Laboratoire « Subjectivité, Lien Social et Modernité » (SuLiSom -UR 3071) depuis 2021. Il est également maître de conférences en psychologie et psychopathologie cliniques à la Faculté de psychologie de l’université de Strasbourg. Il est docteur en psychopathologie et psychanalyse de l’Université de Paris (thèse sous la dir. de A. Vanier et L. Laufer, 2020). Il est membre associé du Centre de Recherche Psychanalyse, Médecine et Société (CRPMS-EA 3522) à l’université de Paris. Ses recherches portent sur les défis pratiques et théoriques de la psychanalyse face aux mutations contemporaines du champ du soin.
« Du côté des thérapeutes, des recherches à partir des enregistrements et vidéos du TDCRP (Treatment of Depression Collaborative Research Program) montrent que :
- de nombreuses hybridations de techniques ont lieu, les TCC empruntant aux psychothérapies verbales interpersonnelles, comme l’inverse ;
- une majorité de processus communs de changement ont lieu, mesurables avec des outils comme le Psychotherapy Process Q Set ;
- le « nom de marque » (brand name) de la thérapie n’est pas prédictif de la thérapie réellement administrée ;
- la personne du thérapeute est un des ingrédients essentiels, dans ses capacités d’ajustement à la situation thérapeutique et de discernement, même, lorsqu’il s’agit de l’administration de traitements chimiques. » (pp.56-57).
L’ouvrage
La psychanalyse, depuis sa création, n’a cessé d’être critiquée et remise en cause. Elle ne semble pas s’en porter si mal et se nourrit parfois même des controverses. L’un des reproches contemporains qui lui est adressé est son absence de scientificité. Et pourtant constate Visentini, un grand nombre d’études prouvent scientifiquement l’efficacité des thérapies psychanalytiques et leur efficacité comparative égale à celle d’autres formes de thérapies. En France, ces résultats sont peu mobilisés dans le débat comme si critiques et louanges étaient d’abord et avant tout idéologiques.
Les psychanalystes mesurent statistiquement l’efficacité de leur pratique depuis 1917. Depuis une vingtaine d’années, les études qui confirment l’efficacité de la psychanalyse souscrivent aux plus hauts niveaux de preuve en matière d’évaluation clinique. En s’appuyant sur plus de 60 pages de bibliographie, en visant à informer le public spécialisé ou profane, Visentini propose d’offrir une vue d’ensemble de ces travaux.
Il prend comme référence l’essai contrôlé randomisé (ECR) afin de typologiser la littérature retenue. Il distingue ainsi les recherches pré-ECRs (1917-1980), les études qui reposent sur les ECRs (1980-1990-auj.) et les recherches post-ECRs (2000-auj.) Si les études réalisées avant les ECRs pèchent par leur manque de rigueur scientifique, les ECRs n’ont quant à eux pas su démontrer, relativement à l’évaluation de l’efficacité des psychothérapies, l’excellence méthodologique dont ils peuvent méthodologiquement se prévaloir en médecine. De plus en plus de travaux contemporains en montrent les impasses voire les malhonnêtetés. Trop de biais non-rectifiables ont limité et diminué la portée de leurs résultats, affaiblissant les conclusions des méta-analyses afférentes. Retenons l’idée qu’en matière de recherche évaluative, il n’y a pas d’étalon-or universel mais un panel de procédures évaluatives, chacune ayant ses avantages et ses faiblesses en fonction des types de soin étudiés et des questions qu’on leur pose. Visentini précise que la pluralité des normes de recherche est en partie corrélée aux lieux distincts de production de savoir.
Avant 1980, différents types d’évaluation vont être testés pour mieux comprendre les raisons des succès et des échecs de la psychanalyse. La première étude d’efficacité attestée est celle, en 1917, d’Isador Coriat, neurologue pratiquant la psychanalyse à l’hôpital de Boston. Il évalue 93 cas de patients traités par ses soins, plutôt sévères, ventilés en 13 diagnostics. Il précise que la plupart d’entre eux ont d’abord bénéficié, en vain, de traitements médicamenteux (ceux de l’époque), par l’électricité (celle de l’époque), par le repos ou par d’autres méthodes. Il répartit ses résultats en quatre catégories : rétablis (46 -48,76 %), largement améliorés (27 -28,62 %), améliorés (11 -11,66 %), non améliorés (9 -9,54 %).
Conscient des limites de son travail, il pose les premières questions relatives aux critérisations de l’efficacité psychanalytique : quels types de troubles sont les plus indiqués pour cette approche et comment pondérer les résultats, quels types de changements, par troubles, peuvent être considérés comme des améliorations, voire des rétablissements (autrement dit qu’est-ce qu’aller mieux pour un névrosé, un anxieux, un déprimé, un paranoïaque, un schizophrène ?), Quels dosage et quelle durée de traitement sont appropriés au cas par cas ? Aucun des patients (même identiquement diagnostiqués) ne se ressemblent du point de vue du cours singulier de leur « aller mal », des points d’appui extérieur sur lesquels ils peuvent compter, ou des ressources psychologiques dont ils disposent en propre, autant de caractéristiques déterminantes quant à l’efficacité des cures. Il repère en outre qu’avec les psychoses, le traitement analytique classique fonctionne moins bien.
D’autres évaluation suivent (Eitington en 1920 et 1922, Fenichel en 1930, dix ans d’activité de l’Institut psychanalytique de Berlin, 721 prises en charge, Kessel et Hyman en 1933, Jones en 1936, 738 cas), Franz Alexander en 1937, Robert Knight en 1941, etc.
Face aux critiques, les psychanalystes mettent en place des études de suivi rétrospectives avec évaluation par des pairs extérieurs. Les recherches entreprises aboutissent à repérer via des jugements croisés entre « analystes traitants », « analystes de suivi » et groupes d’évaluateurs indépendants une bonne efficacité de la psychanalyse, ventilée par types de troubles, compétences du praticien, durée et dosage des traitements. Elles font face à un nouvel ensemble de difficultés comme le problème de la fiabilité du jugement des patients ou des analystes traitants. Dans quelle mesure, les déclarations personnelles sont-elles « reconstruites » en fonction des situations présentes ? Quelle méthode se donner alors pour garantir la valeur scientifique des données recueillies ? En termes de critère d’efficacité, que faut-il mettre en avant : la diminution de l’intensité des symptômes, la faculté de travailler, d’aimer, la qualité des relations sexuelles, les compétences relationnelles, la capacité de prendre plaisir à la vie, l’ancrage dans la réalité, l’abaissement des conflits intrapsychiques, l’insertion sociale, etc. Ces différentes options dépendent de l’évaluateur et pourraient ne pas coïncider avec ce que le patient valorise de son propre traitement. Les mêmes questions se posent pour le rétablissement, ensemble de pratiques qui a peu à voir avec la psychanalyse. Qui donc doit évaluer l’efficacité d’une cure analytique (ou en réalité de n’importe quel traitement), et au nom de qui et de quoi ? Apparaît également, le problème de la définition de ce qu’est une « cure analytique » (ses fondements, ses buts spécifiques, la « théorie » de la maladie et des soins qu’elle enveloppe) par rapport à d’autres formes de psychothérapies. Comment saisir la nature de ce qui est évalué ? Comment localiser formellement les principes d’action de la psychanalyse ? Serait-il pertinent de l’évaluer à partir de critères d’action qui ne sont pas ceux pour lesquels elle déclare avoir de l’efficacité ?
La troisième génération d’évaluation débute en 1954 avec le projet fondateur de la Menninger Foundation : le Psychotherapy Research Project qui se poursuit tout au long de la 2ème partie du XXème siècle. Cette recherche longitudinale contrôlée est considérée comme la plus rigoureuse et ambitieuse étude jamais menée concernant l’évaluation quali-quantitative de la psychanalyse et elle n’a pas d’équivalent avec d’autres types de psychothérapies. Quarante-deux patients y sont suivis : 22 en cures analytiques pures et 20 en psychothérapies analytiques, chacun d’eux étant distribué vers ce type de thérapie de façon aléatoire. Les patients sont considérés comme sévèrement atteints et acceptent le protocole après l’échec de toutes les autres tentatives de traitement. On trouve des alcoolismes sévères, des toxicomanies, des personnalités paranoïaques, des patients borderline graves. Trente pour cent d’entre eux connaissent d’ailleurs une hospitalisation durant cette recherche de longue durée. Dix entretiens initiaux, parfois avec les membres de la famille, une batterie complète de tests psychologiques et un examen médical sont proposés au préalable. Une fois les traitements commencés, une série d’évaluations intercurrentes ont lieu à partir d’entretiens menés auprès des patients par des évaluateurs externes (analystes expérimentés). Ceux-ci se fondent sur une grille extrêmement précise de 162 variables pour apprécier les effets des thérapies. Les entretiens sont archivés. Des supervisions -également archivées- permettent aux analystes de suivi de réévaluer leurs résultats. Au départ, la conservation se fait par des notes extensives puis via des enregistrements audios. Deux ans après la fin des traitements, de nouvelles évaluations externes sont opérées par les analystes-chercheurs, à partir de nouveaux entretiens. Des données sont ensuite collectées, pour ces 42 patients, sur une durée de 30 ans. L’objectif est de disposer d’une perspective longitudinale de grande ampleur (35 000 évaluation individuelles distinctes accessibles aux chercheurs). Concernant l’efficacité : 36 % des cures analytiques obtiennent de très bons scores, tous critères confondus ; 23 % des résultats satisfaisants ; 14 % des résultats faiblement significatifs et 26 % sont des échecs thérapeutiques.
A partir des années 1970, d’autres grands projets de recherche structurés sont mis en place sur des comparaisons essentiellement « intra-cas » afin d’éclairer la nature des processus de changement que la psychanalyse induit dans la vie psychique des patients, en les décrivant et en les comprenant plus rigoureusement. Elles sont menées par l’Institut psychanalytique de Boston, le Chicago Institute for Psychoanalysis, le San Francisco Intitute of Psychoanalysis, etc.
Le modèle « evidence based » vise à distinguer systématiquement ce qui relève d’une efficacité intrinsèque stricte (principe actif contrôlé et validé) et d’un efficacité extrinsèque associée à des facteurs contextuels (rémission spontanée, effet placebo, contingences de la vie du malade). Des « groupes contrôle » sont mis en place afin de permettre des évaluations comparatives, les participants aux tests sont aléatoirement répartis dans les groupes, afin d’éviter des biais de sélection ; et l’on administre les traitements en double aveugle, sans que ni les médecins, ni les patients n’aient idée des remèdes dont ils usent, ni ne sachent s’il s’agit de véritables médications ou de simples placebos.
Aux Etats-Unis, dans l’après-guerre, ces différents éléments de méthodes sont formellement intégrés en une méthodologie rigoureuse qui prend le nom d’essai contrôlé randomisé (ECR). Le premier ECR reconnu comme tel date de 1948, avec l’étude d’Austin Bradford Hill sur l’efficacité de la streptomycine contre la tuberculose pulmonaire. En quelques décennies, et au vu de leurs succès, les ECRs deviennent l’étalon-or de la recherche en médecine, au point d’être -depuis 1992- au principe d’un paradigme nouveau dans le domaine de la santé : la médecine « fondée sur des preuves » (Evidence based medecine, EBM). L’EBM enjoint à hiérarchiser tous les soins existants en fonction de leur niveau formel de « preuve », les ECRs et les méta-analyses d’ECRs étant le niveau ultime de la preuve quitte à sous-estimer la valeur des preuves moins formelles (plus observationnelles) d’efficacité et l’importance thérapeutique des « valeurs » en médecine. Dans les années 2000, les critères de l’EBM s’étendent peu à peu à la santé mentale, exigeant des psychothérapies qu’elles soient -comme tout autre traitement médical et paramédical- fondées sur des preuves strictes sur le plan formel et quantifiables (expérimentales). On parle alors de « thérapies empiriquement fondées ». La psychanalyse y a, en partie souscrit au-delà des critiques qu’elle a pu en faire. Les résultats de laboratoire concernant l’efficacité de la psychanalyse complémentent les résultats des recherches en milieu naturel.
Avec la prudence requise par la fragilité méthodologique de tous les ECRs concernant les psychothérapies, on peut pointer que les psychothérapies psychanalytiques sont efficaces et globalement aussi efficaces que d’autres formes de psychothérapie également testées (thérapies cognitivo-comportementales, mais aussi interpersonnelles, systémiques, humanistes, familiales), pour :
- les troubles légers de la personnalité, recoupant en partie les névroses au sens psychanalytiques ;
- les troubles anxieux ;
- les comorbidités anxieuses dans les troubles d’angoisse panique ;
- les troubles d’anxiété sociale ;
- les phobies ;
- les phobies sociales ;
- les troubles de stress post-partum ;
- les attaques de panique ;
- les troubles du stress post-traumatique ;
- les deuils pathologiques ;
- les dépressions sévères, post-partum, de personnes âgées, d’aidants familiaux ;
- les troubles borderline ;
- les problématiques de couple ;
- les comportements de violence conjugale ;
- les troubles de dépendance à l’alcool ;
- les troubles de dépendance aux opiacés ;
- les troubles alimentaires (anorexie, boulimie).
Visentini précise que l’on pourrait discuter point par point la nature précise des psychothérapies psychanalytiques testées dans ces études (plusieurs sous-courants existent), les courants de TCC qui y participent (ils sont divers), ou différencier plus finement les formes de troubles et les types de résultat.
Les opérations méta-analytiques, lesquelles retraitent les données de l’ensemble des ECRs existant indiquent une efficacité globale de « moyenne » à « forte », en un niveau de preuve aujourd’hui considéré comme le plus élevé (niveau 1) selon les critères de l’evidence based medecine.
Les années 2000 sont marquées par un retour au « cas » et reposent sur des études observationnelles contrôlées. Sans renoncer totalement au ECRs, il a été remarqué que les psychothérapies ne s’administrent pas comme des médicaments. Elles sont à concevoir comme des alliances contingentes entre un patient et un thérapeute. Les qualités du thérapeute (son style, son écoute, son tact, ses compétences relationnelles) sont déterminantes pour l’efficacité d’un traitement, quel qu’il soit. L’usage et l’interprétation personnelle du référentiel théorique dont le thérapeute se réclame, les improvisations qu’il y joue sont également déterminants du point de vue de l’efficacité, en positif comme en négatif. Du côté du patient, le degré d’adhésion aux soins (pour partie lié au choix du thérapeute et d’un type de thérapie) détermine en retour le niveau de réceptivité/réactivité du patient au traitement et donc la réussite de celui-ci. Une psychothérapie, imposée au patient, ne peut jamais être efficace, contrairement aux traitements médicamenteux.
Les souffrances psychiques sont plus complexes que les maladies somatiques. Elles sont le lieu de comorbidités bien plus fréquentes. Elles sont évolutives, avec un commencement, des tendances progressives ou régressives, un caractère aigu ou chronique, et ce cours de la maladie est à prendre en compte. Elle sont influencées par une multitude de facteurs de vie externes, plus ou moins indépendants du patient. Elles relèvent d’un fonctionnement global de la vie psychologique et doivent être resituées en contexte. Elles ne peuvent être réduites à un symptôme unique, isolé, stable et comme « indépendant » qui serait diagnosticable au vu des seuls traits syndromiques -excepté de manière artificielle, pour satisfaire aux exigences des ECRs.
Le contexte du soin compte pour prédire l’efficacité. Quel rôle joue, côté thérapeute, joue sa personnalité, la croyance en son référentiel, l’effet d’autorité qui le traverse et tous les à-côtés du traitement ? Quel rôle, côté patient joue le simple fait d’être pris en charge, la croyance que ce thérapeute et ce référentiel vont être efficaces ? Quels sont les ingrédients psychiques, sociaux et historiques mobilisant le couple patient/thérapeute, et participent à la réussite ?
Qui s’intéresse réellement aux travaux scientifiques et aux souffrances des patients, reconnaitra l’efficacité des psychothérapies analytiques qui est démontrée pour un large panel de patients et relativement à une grande série de troubles. « Les décideurs publics devraient en conséquence soutenir, tant la présence de la psychanalyse dans les institutions de soin, que les recherches scientifiques qui s’y réfèrent -et notamment à l’université, dans les départements de psychologie clinique, où sont formés les soignants de demain. » Non seulement ce n’est pas ce qu’ils font mais la Haute Autorité de Santé, censée peu se soucier d’idéologie, ignore ces travaux et prend position contre la psychanalyse dans de nombreuses recommandations.
« On a également pu étudié à l’IRM (au niveau des substrats neurologiques) les effets de l’amélioration cliniques obtenues par des prises en charge psychanalytiques, tels que :
- des modifications dans le système limbique, corrélées à une meilleure régulation émotionnelle pour des patients atteints de troubles paniques ;
- une suractivation de l’hippocampe antérieur gauche/amygdale, du cortex cingulaire antérieur et du cortex préfrontal médian, corrélée à une diminution des affects dépressifs ;
- des changements de réponses hémodynamiques dans le gyrus parahippocampique, corrélés à des modifications de l’empathie des patients ;
- l’impact sur le cortex cingulaire postérieur d’une diminution d certains mécanismes de défense comme « le clivage », dans le cas de problématiques narcissiques. » (p.115)
L’intérêt pour les soins
Il est quasiment impossible pour une infirmière de connaître sinon de maîtriser les différents champs de la psychothérapie (psychanalyse, thérapies cognitivocomportementales, interpersonnelles, systémiques, humanistes, familiales, etc.). Elle doit opérer des choix en fonction de son histoire, de la culture professionnelle dans laquelle elle baigne, de son propre parcours de développement, de sa formation, de ses goûts, de son style, de l’équipe au sein de laquelle elle exerce, des patients qu’elle rencontre. Chacune de ces approches a ses vertus (et ses zones de peu d’efficacité) que les ECRs ne mettent pas forcément en évidence. Il lui appartient cependant d’éviter de dénigrer une approche qu’elle connait peu ou mal. Il serait dommage voire préjudiciable qu’un patient ou ses proches renoncent à un type de soins dont l’efficacité a été démontrée et qui lui serait profitable parce qu’une soignante, une institution, un chercheur, une autorité de santé la lui déconseille voire la critique sans réel argument. Cela constituerait pour ce patient ou ses proches une réelle perte de chance.
Dominique Friard
Date de dernière mise à jour : 08/08/2025
Ajouter un commentaire