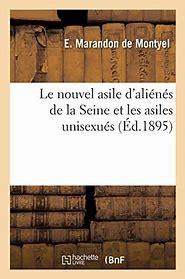Naissance de la psychiatrie (II)
Les modèles de compréhension de la maladie mentale (II)
Naissance de la psychiatrie
Du Grand Renfermement à la théorie de la dégénérescence en passant par le traitement moral, de l'insensé à l'aliéné, comment est apparue la psychiatrie et quels en étaient les présupposés. Un rapide parcours historique qui permet de comprendre comment se sont fabriqués les diagnostics psychiatriques et à quelle logique ils répondaient.
2. Le traitement moral
La fondation de l’Hôpital Général en 1656 constitue une date clé dans l’institutionnalisation d’un contrôle social qui isolera entre autres les fous de la société. C'est au cours du 18ème siècle, par le biais des lettres de cachet et de la création des Maisons de Force que l'enfermement des insensés va commencer à prendre un essor qui connaîtra toute son ampleur au 19ème siècle.
Les lettres de cachet sont demandées par les familles (plus de 90 %). Elles constituent, selon Postel, une garantie contre l’arbitraire des familles et des municipalités qui avaient pris l’habitude de s’entendre de gré à gré avec les directeurs des maisons de force pour y placer leurs déviants, sans autre formalité que l’accord sur un prix de pension. Les détentions pour motifs d'ordre public aboutissent souvent à des placements dans les hôpitaux, quoique la plupart des demandes soient adressées aux forteresses et prisons.[1] Les cas les plus nombreux restent les manquements aux principes religieux et familiaux : les mauvais mariages, les pratiques incompatibles avec un état ecclésiastique, le libertinage ou le scepticisme religieux. Essentiellement des dérèglements moraux que la parenté régule en isolant le fauteur de troubles. L’exemple de Sade qui bien qu’interné, peut recevoir la visite de sa femme, est à cet égard édifiant.
La révolution française va chambouler tout cela. Elle provoque un déplacement. L’individu ne se définit plus par son appartenance à un collectif tel que sa corporation, sa parenté. Il naît libre et égal en droit. Cette promotion de l’individu va mettre l’accent sur l’aliéné, non pas autre à sa famille, à sa collectivité d’appartenance mais autre à lui-même. Le statut du fou change donc. Non plus insensé mais aliéné, malade donc curable. Nous ne reprendrons pas les étapes qui jalonnent la création de l’asile. Elle marque une date importante, dans le sens où elle institutionnalise le traitement de la folie. La création de cette institution globale, totale, au sens de Goffman[2], va évidemment modifier profondément les relations entre les familles (encore au sens de parenté) et les opérateurs thérapeutiques. Nous en assumons encore les conséquences aujourd’hui. Il est nécessaire de s’y arrêter un peu.
Lorsque Philippe Pinel (1745-1826) prend ses fonctions à Bicêtre en 1793, il y découvre un « surveillant », « chef de la police intérieure des loges » qui se distingue à la fois par ses qualités humaines et par sa compétence à gérer la folie en institution. J.B. Pussin (1745-1811) qui travaille à Bicêtre depuis 1780 est un homme d’expérience. Il a 48 ans. C’est un homme fait que rencontre Pinel. Ainsi que l’écrit Marcel Jaeger : « De lui, Philippe Pinel apprendra tout un éventail de possibilités dans le travail relationnel avec les aliénés et y verra surtout la démonstration pratique des bienfaits de la liberté dans la maîtrise des supposés furieux. »[3] Gladys Swain[4] a montré, la première, de façon très précise, que contrairement à une croyance bien établie, c’est le surveillant Jean Baptiste Pussin qui, délivrant de leurs chaînes les fous de Bicêtre, pose le « geste inaugurateur » de la psychiatrie attribué abusivement à Philippe Pinel par « ses deux fils : le vrai, Scipion Pinel, et le fils spirituel : Esquirol. La lecture attentive des textes de Philippe Pinel oblige, en effet, à prendre au sérieux la dette qu’il exprime, clairement et à plusieurs reprises, à l’égard de son surveillant. »[5] Pussin apparaît ainsi comme détenteur d’un savoir-faire et d’un savoir-être à partir desquels va se développer une stratégie médicale originale : le traitement moral. Le Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale ou la manie, écrit par Pinel se lit à la fois comme « point de départ de la psychiatrie comme nouvelle discipline et explication non moins originale des limites du savoir médical. … L’aliénation mentale est une « maladie interne », non une maladie qui se lit à plat et dont les symptômes auraient une telle permanence que l’on pourrait les répertorier à n’importe quel moment, en un laps de temps court (une consultation) ; c’est au contraire, une maladie qui participe de la vie du sujet et se manifeste par des comportements suffisamment variés pour échapper à un regard ponctuel.
En cela, la folie n’a rien à voir avec une tare, ni avec une anomalie qui marque le corps d’un sujet. Elle est le mode d’existence de ce sujet, partie prenante de son histoire, au jour le jour. L’observation clinique qu’elle nécessite se distingue d’un simple repérage d’une forme visible stable et, ce même si à première vue, le fou est identique à lui-même. »[6]
Il est ainsi nécessaire qu’existe un autre regard privilégié que celui d’un médecin qui ne peut guère passer plus de quelques heures auprès du patient. Il est également nécessaire que le médecin soit suffisamment éclairé pour reconnaître la sagacité et la pertinence d’un regard qui trouve sa source dans l’attention aux éléments du quotidien. Quels sont les points saillants de ce savoir-être et de ce savoir-faire non médical ?
A partir de sa lecture du Traité médico-philosophique, M. Jaeger identifie trois propositions : « la surveillance ne se résume pas à une observation passive », « la maîtrise de la parole comme médiation dans la relation et surtout dans le soin », et l’apport « d’innovations bénéfiques sur un plan thérapeutique ».
Pour Pinel, « éclairé » par la pratique de Pussin, le malade mental n'est qu'un aliéné provisoirement privé d'une partie de sa raison, avec qui la communication reste possible. Il suffit de lui parler avec « douceur », de « compatir à ses maux » et de lui donner « l’espoir consolant d’un sort plus heureux » pour le voir généralement quitter son « emportement » et sa dangerosité. Il faut donc à la fois individualiser le traitement et penser un isolement du malade qui ne soit plus de la réclusion. Ce traitement suppose un lieu nouveau, ce sera l'asile. Et l’asile exclut la famille ainsi que l’énonce Pinel. « Il est si doux en général pour un malade d’être au sein de sa famille et d’y recevoir les soins et la consolation d’une amitié tendre et compatissante, que j’énonce avec peine une vérité triste mais constatée par l’expérience la plus répétée, la nécessité absolue de confier les aliénés à des mains étrangères et de les isoler de leurs parents ».[7]
L'ambition de l'isolement est triple. Il faut d'abord protéger la société contre les menaces et les dangers qu'occasionne le fou. Il faut ensuite reconstruire l'individualité psychique du malade. Cette reconstruction s'accomplit en remplaçant progressivement la déraison qui habite les aliénés par la raison totale et parfaite qu'ils doivent trouver dans le gouvernement de l'asile, et qui, peu à peu, du dehors vers le dedans va transformer leur désordre intérieur par un ordre durable. L’aliéné sera soumis à une discipline sévère et paternelle, dans un monde entièrement régi par la loi médicale. Par le jeu dosé des menaces, des récompenses et des réconforts, par la démonstration à la fois d'une grande sollicitude et d'une grande fermeté, il s’assujettira progressivement à la tutelle médicale et à la loi collective de l'institution, au travail mécanique et à la police intérieure qui la règlent. Le but est de subjuguer et dompter l'aliéné en le mettant dans l'étroite dépendance d'un homme qui par ses qualités physiques et morales soit propre à exercer sur lui un empire irrésistible et à changer la chaîne vicieuse de ses idées. Pour obtenir ce résultat, il faut susciter le respect de l'aliéné et sa confiance. S'il est souvent nécessaire d'intimider l'aliéné, par exemple par des démonstrations de force, il ne faut cependant jamais employer la violence ni des méthodes dégradantes : la douceur et la compréhension suffiront souvent (les furieux ne seront plus enchaînés, mais on les laissera « divaguer » dans le parc de l'asile munis simplement de la camisole de force, ou au pire, on les enfermera en cellule). Parfois le sarcasme, la peur, la confiance, un contrat passé avec l'aliéné, la visite inopinée et soigneusement calculée de personnes chères déterminent le choc affectif recherché et tirent ainsi brutalement le sujet de son délire. D'autres fois, la vie régulière de l'asile, l'isolement et le repos, des occupations distrayantes (travail, reprise des passe-temps favoris après une longue interruption) suffisent. Tout cela implique la présence d'un personnel nombreux et bien entraîné, habitué à observer et à comprendre les malades, un surveillant chef qui tienne bien en main ses hommes et qui soit tout « dévoué » au médecin.
L'isolement en produisant des sensations nouvelles va changer et rompre la série d'idées dont l'aliéné ne pouvait sortir. Si une éducation mal faite prédispose à la folie, grâce à l'asile le sujet acquerra une éducation modèle. Il faut enfin créer les conditions d’observation du malade afin d’en délimiter les contours, de repérer les maladies, de les classifier. On va ainsi concevoir des quartiers, unités thérapeutiques closes, renfermant un groupe homogène de malades, disponibles, mobilisables, maîtrisables observables. L’isolement répond ainsi à une nécessité méthodologique. Pinel et les premiers aliénistes vont chercher à classer les troubles de l’esprit en imitant les méthodes des botanistes ou des zoologues, afin de les repérer ensuite dans une grille nosographique et les faire apparaître comme des entités morbides spécifiques, sur le modèle de la pathologie médicale. On considère désormais la folie comme une maladie du cerveau à laquelle on cherche un substratum organique. « Ainsi à partir de Pinel, qui a retiré progressivement de son langage médical le terme de folie, cette dernière perd ses caractéristiques d’expérience « existentielle » anthropologique pour ne plus être qu’une maladie. C’est de cette manière qu’elle peut s’inscrire dans le discours rationnel inauguré par l’aliéniste et dominé par les trois grands impératifs naturalistes : observer, définir (en classant, en diagnostiquant) et traiter. »[8]
La nosographie dont nous avons hérité découle de l’application systématique de ces trois impératifs. P. Bercherie[9] a décrit avec précision les étapes qui permirent de fonder peu à peu la clinique psychiatrique. Il distingue quatre étapes : la description des espèces du genre folie (Pinel, Esquirol (1772-1840), Georget (1795-1828) , Guislain (1797-1860) et Griesinger (1817-1868), les fondements de la nosologie (Bayle (1799-1858), J.P. Falret (1794-1870), Morel (1809-1873) et Kahlbaum (1828-1899), la clinique des maladies mentales (Ecole d’Illenau, Magnan (1835-1916), Kraepelin (1856-1926), Séglas (1856-1939) et le groupe de la Salpêtrière), la psychiatrie moderne avec l’ère psychodynamique (les classiques français, le courant psychodynamique allemand, Kraepelin et Jaspers (1883-1969), la psychiatrie française de l’entre-deux guerres).
Le traitement moral que l’asile était censé promouvoir va vite devenir un échec. Au cours de la seconde moitié du 19ème siècle, on fait le constat que le traitement moral est devenu une sorte de logique interne, pervertie, un instrument, non plus de guérison, mais de fabrication d'incurables qui cantonne davantage le rôle du médecin dans une fonction de gouvernement d'une population d'aliénés que dans celui de son traitement. Tout se passe comme si un univers parallèle s'était recréé, un univers clos, marginal, resserré et concentré sur sa souffrance psychique, mais qui s'acharne à mimer les gestes de la vie normale.
3. La théorie de la dégénérescence
La théorie de la dégénérescence prend acte de cet échec. Morel, un de ses pères, va aller plus loin encore dans la remise en cause de l’environnement des patients. Il suggère qu’on insiste trop sur les causes organiques des maladies mentales, il faut, dit-il, étudier la vie affective des parents des malades. « La dégénérescence est une déviation par rapport au type humain normal, qui est transmissible par l’hérédité, et qui s’aggrave peu à peu jusqu’à l’extinction de la famille. »[10] Une génération serait simplement instable, la suivante très instable, la troisième psychotique, la quatrième manifesterait un état de dégénérescence avancé, et les générations suivantes seraient si aliénées que la famille s’éteindrait. La théorie de la dégénérescence d’abord réservée à la schizophrénie que Morel décrit sous le nom de « démence précoce » sera bientôt adaptée aux névrosés eux-mêmes par l’intermédiaire de Magnan. On bloque ainsi toute tentative pour comprendre et soigner.
C’est à partir d’observations de « dégénérés » dont la maladie avait débuté dans l’adolescence que Morel créa l’entité de démence précoce (première description de ce qui allait devenir la schizophrénie). Si le traitement moral supposait une origine sociale ou « psychologique » des troubles qui impliquait un traitement, une écoute, une gestion de la vie asilaire destinés à permettre à l’aliéné de retrouver sa place dans la société; la théorie de la dégénérescence qui inscrit les troubles dans une dimension organique via des lésions cérébrales n’implique plus d’écouter le patient. Il s’agit de classer les différentes formes de démence et de dégénérescence et au fond d’attendre que celle-ci ait accompli son œuvre. Malgré tout, des soignants ici ou là vont essayer de développer des modes de traitement spécifiques, essentiellement dans le registre occupationnel.
Tous les aliénistes ne se reconnaissent pas dans cette théorie désespérée qui mènerait à l’eugénisme. En 1871, Falret et Lasègue (1816-1883) publient des travaux qui font référence au rôle de l’interaction entre des personnes vivant ensemble dans la genèse des troubles psychiatriques. Lasègue, décrit l’anorexie hystérique, qui servira de base aux travaux sur l’anorexie mentale. Lasègue, qui est un des premiers psychiatres à évoquer dans la cura singularis la qualité de la relation thérapeutique entre le patient et son thérapeute, recommande, dans les cas d’anorexies, de travailler avec la famille. La position la plus intéressante dans ce registre est celle du trop oublié Marandon de Montyel (1851-1908) qui se battit pour déchroniciser l’asile qu’il nommait une « fabrique d’incurables ». Nommé à la division des hommes de Ville-Evrard en 1888, il entreprend, à 37 ans, de changer les conditions carcérales de l’asile. Il commence par remettre en cause le principe d’isolement du malade de son environnement familial et social, préconisé par Esquirol. Il instaure « l’open door », le « no-restreint », la liberté des malades, pratiqué en Angleterre depuis le 19ème siècle. Deux principes de base vont guider son entreprise : le travail et la relation du malade avec sa famille. Il cherche à créer un milieu qui rappelle la vie ordinaire : visites des familles à volonté avec villégiature dans les environs et collations sur l’herbe, congés de plusieurs jours à plusieurs semaines au sein de la famille, liberté absolue d’écrire, visite médicale quotidienne des patients. Il s’agit d’une véritable révolution. « Après le travail en toute liberté, les relations des malades avec leur famille constituent un des éléments principaux de la nouvelle organisation des asiles que nous préconisons. (…) Il importe à un haut degré que l’aliéné n’ait aucun motif de penser qu’on se soit débarrassé de lui, qu’il soit devenu un objet de répulsion et de honte ; il importe également qu’il n’ait pas lieu de se croire un prisonnier, un être mis à l’écart du reste de l’humanité. […] Je reçois tous les jours, tant le matin après la visite que dans le courant de l’après-midi […] Il s’établit par là, au bout de très peu de temps, des relations empreintes d’une grande cordialité, entre les parents et le médecin, auquel on arrive à ne rien cacher. »[11]
Les idées et surtout la pratique de Marandon de Montyel, qualifiées d’optimisme thérapeutique vont créer une scission en 1897 entre « aliénistes classiques », défenseurs du statu quo, et « psychiatres modernes » promoteurs des réformes. Ces derniers seront peu à peu marginalisés et ne parviendront jamais à imposer leur point de vue. Les idées de Marandon de Montyel sombreront peu à peu dans l’oubli, tout comme celles de Maurice Dide (1873-1944), le psychiatre et résistant toulousain, auquel le grand journaliste, Albert Londres (1884-1932), rendra hommage dans son enquête de 1925.[12]
La croyance en une origine somatique des troubles mentaux impliquerait l’absence de toute écoute. Pour écouter le malade mental, il faudrait être convaincu que son mal a une origine non corporelle et que celui-ci est curable. Les deux positions ne sont pas aussi tranchées qu’il y paraît. Il est essentiel de se souvenir que c’est autour des thérapies de choc (malariathérapie, insulinothérapie, électrochoc) que s’est développé le rôle psychothérapique des infirmiers.
(A suivre !)
D. Friard
[1] POSTEL (J), QUETEL (C), Nouvelle histoire de la psychiatrie, op.cit., p.107.
[2] GOFFMANN (E), Asiles, Editions de Minuit, Paris, 1968.
[3] JAEGER (M), Garder, surveiller, soigner. Essais d’histoire de la profession d’infirmier psychiatrique, in Cahiers VST, CEMEA, Janvier 1990, p. 10.
[4] SWAIN (G), Le sujet de la folie, Privat, Rhadamanthe, Toulouse, 1977.
[5] JAEGER (M), Garder, surveiller, soigner. Essais d’histoire de la profession d’infirmier psychiatrique, op. cit., p. 11.
[6] JAEGER (M), Garder, surveiller, soigner. Essais d’histoire de la profession d’infirmier psychiatrique, op. cit., p. 11.
[7] PINEL (P), Traité Médico-Philosophique sur l’aliénation mentale, 2ème édition, entièrement refondue et très augmentée (1809), Ed. Les empêcheurs de penser en rond/Le Seuil, Paris, mai 2005.
[8] POSTEL (J), Folie, in Grand dictionnaire de la Psychologie, Larousse, Paris, 1991, p. 309.
[9] BERCHERIE (P), Les fondements de la clinique. Histoire et structure du Savoir psychiatrique, La Bibliothèque d’Ornicar, Seuil, Paris, 1980.
[10] ALEXANDER (F.G), SELESNICK (S.T), Histoire de la psychiatrie, Armand Collin, Paris 1972.
[11] ROUMIEUX (A), Ville-Evrard, Murs, destins et histoire d’un hôpital psychiatrique, L’Harmattan, Paris, 2008.
[12] LONDRES (A), Chez les fous, Le serpent à plumes, Paris, 1999.
Date de dernière mise à jour : 20/11/2024
Ajouter un commentaire