Formations ponctuelles et sur-mesure
Formations ponctuelles et sur-mesure
Les formations, ici présentées, analysées et évaluées ne portent pas sur l'entretien clinique infirmier. Elles correspondent aux demandes d'institutions qui souhaitent voir développer certains contenus de formation "sur mesure" par Serpsy. Le rythme de ces demandes est par nature irrégulier, plusieurs années peuvent s'écouler sans propositions et celles-ci peuvent brutalement s'accélérer.
En 2022, Serpsy a réalisé une formation de deux jours, centrée sur L'entretien de crise en psychiatrie au Centre Hospitalier Sainte-Marie de Rodez.
En 2023, Serpsy a répondu à deux demandes de formations pour elle atypique : Les soins aux patients atteints de pathologies dites archaïques par le C.H. de Sevrey (Deux sessions dont la dernière en 2024) et L'écriture professionnelle de recherche au Centre Hospitalier de Cadillac.

L'entretien de crise en psychiatrie
Genèse de la formation
Mi-décembre 2021, Mme Mihdidin, Responsable Formation de l'Association Hospitalière Sainte-Marie nous appelle afin de mettre en place une formation sur le thème de l'entretien de crise en psychiatrie destinée aux soignants de l'UADO. Cet échange téléphonique débouche sur l'identification des besoins et une ébauche de projet de formation qui se précise en mars 2022 après réception du cahier des charges.
![]() Identification des besoins entretien de crise rodez (13.8 Ko)
Identification des besoins entretien de crise rodez (13.8 Ko)
![]() Cahier des charges uado l entretien de crise 1 (424.24 Ko)
Cahier des charges uado l entretien de crise 1 (424.24 Ko)
![]() Entretien d accueil et de crise rodez 1 (79.95 Ko)
Entretien d accueil et de crise rodez 1 (79.95 Ko)
" En 1974, un arrêté préfectoral met en place la sectorisation de la psychiatrie adulte en Aveyron. Le département est divisé en quatre secteurs mais la ville de Rodez n’est pas sectorisée. En 1985, un nouvel arrêté modifie le découpage initial : Rodez, Espalion, Villefranche et Decazeville sont rattachés à l’hôpital psychiatrique Sainte-Marie de Rodez. Au fil des années, le Centre Hospitalier ne cesse d’améliorer la prise en charge des patients. Des unités d’hospitalisation et des structures et dispositifs alternatifs à l’hospitalisation sont implantées.
Aujourd’hui, les prises en charge à temps plein sont organisées en filières de soins (courte durée, réhabilitation, gérontopsychiatrie et addictologie) réparties sur 3 sites. La filière courte durée s’appuie sur l’Unité d’Accueil, de Diagnostic et d’Orientation (UADO), des Unités de court séjour, l’Espace Psychiatrique Intersectoriel Crise et Apaisement (EPICEA), les cliniques de Rodez et de Villefranche-de-Rouergue et l’Equipe Mobile d’Intervention et de Crise (EMIC), créée en avril 2021.
Les équipes pluridisciplinaire de l’UADO et de l’EMIC composées de soignants expérimentés et dotés de solides connaissances en psychiatrie souhaitent des rappels théoriques et pratiques sur l’entretien de crise qui constitue en quelque sorte leur cœur de métier."
La formation se déroule les 26 et 27 septembre 2022.
Pré et post-tests
![]() Pre et post test entretien d accueil infirmier (16.28 Ko)
Pre et post test entretien d accueil infirmier (16.28 Ko)
Analyse des réponses
Que pouvez-vous dire à propos du cadre des entretiens d’accueil infirmiers ?
|
Pré-test |
Posttest |
|
SB1 |
|
|
SC1 « Ce sont des entretiens informels » |
« Ce sont des entretiens non-programmés » |
|
NC1 « Entretiens informels la nuit » |
« Formels ou informels, pas d’objets fragiles ou potentiellement dangereux » |
|
ED1 « Souvent informels, en chambre » |
« Choisir un cadre qui mettra en confiance le patient afin qu’il puisse se livrer plus facilement » |
|
AP1 « L’entretien d’accueil a lieu un peu à distance de l’entrée du patient qui a déjà eu un entretien lors de son passage aux urgences » |
« Il faut attacher une attention particulière au cadre c’est-à-dire au lieu, au contexte, au moment, à la façon de prévoir le déroulement » |
|
AC1 « S’adapte au contexte, patient, etc. » |
« Modulable, patient dépendant » |
|
CF1 « Réalisés en présence d’un infirmier, en toute confidentialité. Nous évaluons les idées suicidaires systématiquement et le pourquoi du motif de consultation, hospitalisation du patient » |
« Qu’il est important de le définir, d’en prendre conscience et de savoir le moduler (Entretien formel d’accueil de crise, entretien informel). |
|
MB1 « Bureau, face à face, calme, confidentialité » |
« Temporalité, contexte, lieu, personnes, présentation » |
|
SG1 « Confidentialité, calme » |
« Confidentiel, calme, agréable, laisser choix bureau/petit salon) » |
|
JR1 « Les entretiens d’accueil sont surtout faits à l’UADO. Ceux qui sont faits à l’UIF sont souvent informels et peuvent être reportés en fonction de la situation » |
« Peuvent être formels ou informels. Adaptés à la situation et au contexte. Dans un lieu adapté. Avec confidentialité » |
En prétest, nous repérons bien l’écart entre les réponses des soignants de l’UADO et ceux des autres unités. Les entretiens sont essentiellement « informels », ce qui suffit au fond à décrire leur cadre, comme s’ils n’en avaient pas. Si le cadre est un peu mieux décrit pour les soignants de l’UADO, les deux maitres-mots en sont « calme » et « confidentialité ». On note qu’en termes de contenu, les soignants explorent les idées suicidaires et les motifs de la consultation.
En post-test, les réponses occupent un volume plus important et sont relativement plus précises. L’entretien informel est défini par sa non-programmation. ED1 prête attention au cadre, même lorsque l’entretien est informel, il convient de choisir un cadre qui permette au patient de se sentir en confiance pour se livrer. JR1les décrit comme adaptés à la situation et au contexte. Les soignants de l’UADO décrivent ce cadre avec plus de finesse et en citent quelques éléments.
L’évolution est patente.
Quels objectifs fixez-vous à ces entretiens ?
|
Pré-test |
Posttest |
|
SB2 |
|
|
SC2 « Rassurer, apaiser » » |
« Que le patient se sente mieux, rassuré, apaisé » |
|
NC2 « Désamorcer une crise, apaisement » |
« Recueil de données : évaluation psychologie, émotionnel, ressources, début d’alliance thérapeutique » |
|
ED2 « Apaisement et/ou négociation concernant la prise des thérapeutiques. L’adhésion au soin » |
« Faire bon accueil, de manière bienveillante, mettre à l’aise le patient, identifier les différentes émotions, les difficultés, les ressources du patient. De manière globale faire un recueil de données le plus complet possible » |
|
AP2 « Réassurance, écoute et identifier les besoins du patient » |
« Avoir des informations sur le vécu de la personne, le problème du moment, des signes cliniques, sa demande et lui apporter une aide et une réponse pertinente » |
|
AC2 « Evaluer degré crise, urgence, etc. » |
« Déterminer problématique, créer lien, alliance, identifier contexte » |
|
CF2 « Evaluer la crise, évaluer idées noires, idées suicidaires, donner une réponse adaptée aux patients, parfois favoriser l’adhésion aux soins » |
« Recueillir les difficultés du patient, ce qu’il attend de nous, qu’il trouve le moyen de facilement se livrer et identifier les ressources de ce dernier (le patient). |
|
MB2 |
« La demande » |
|
SG2 « Evaluation psychologique, suicide, agressivité, antécédents, entourage, attitude, volonté du patient » |
« Qui demande quoi à qui, comment et pourquoi maintenant ? A B C D E F G H I J + évaluation psychologique etc. (voir prétest) |
|
JR2 « Evaluer les risques suicidaires, apprendre à connaître le patient et les raisons de sa venue » |
« Repérer les besoins et demandes du patient. Recueillir les informations importantes » |
Entre pré et post-test, l’évolution est d’importance.
Dans les unités d’hospitalisation, en prétest, il s’agit d’apaiser, de rassurer, de désamorcer la crise, de négocier l’adhésion au soin. A l’UADO, c’est moins clair. MB2 ne répond pas à la question. Il s’agit d’abord d’évaluer : la crise, le risque suicidaire, et de favoriser l’adhésion aux soins. Au fond, un partage des tâches s’est organisé : à l’UADO on évalue les troubles, dans les unités d’hospitalisation on apaise, on désamorce la crise. C’est tout à fait cohérent.
Le paysage change en post-test.
Les réponses sont plus longues, plus précises, plus argumentées. En soi, c’est déjà un premier effet positif de la formation.
Dans les unités d’hospitalisation, ce qui était énoncé en termes de réaction à une crise à canaliser s’écrit en effet actif, positif : « que le patient se sente rassuré, apaisé ». Les soignants sont davantage tournés vers le vécu du patient. Ils sont actifs : recueillent des informations, identifient des ressources, sont attentifs à la demande d’un patient qui peut être davantage acteurs de ses soins.
Les soignants de l’UADO sont davantage centrés sur la question de la demande, ce qui leur permet de chercher l’alliance thérapeutique dès l’entrée. SG reprend les apports techniques de la formation et les rajoute à son bagage initial. JR différencie besoin et demande.
Les soignants des deux types d’unités de soin s’approprient la formation et les rajoutent à un déjà là conséquent pour nombre d’entre eux.
A quels éléments êtes-vous attentifs lors de ces entretiens ?
|
Pré-test |
Posttest |
|
SB1 |
|
|
SC3 « Idées noires, idées suicidaires, angoisse comportement » |
« Comportement, émotions, temps de réponse, parcours de vie, idées noires, idées suicidaires » |
|
NC3 « Idées noires, idées suicidaires, agitation psychomotrice » |
« Idées noires, idées suicidaires, attitude, posture, antécédents, ressources » |
|
ED3 « Ses attitudes, ses besoins, le potentiel hétéro ou auto agressif, risque suicidaire » |
« La posture, l’attitude, le comportement, les différents troubles (sommeil, alimentation), dépendances » |
|
AP3 « Aux signes cliniques que l’on peut observer » |
« A la posture, au discours, aux signes cliniques, la présence ou non d’une alliance thérapeutique » |
|
AC3 « Tout. Risque suicidaire, consos, sommeil, apparence, etc. » |
« Langage verbal et non verbal, posture, sensations du patient » |
|
CF3 « La présentation du patient, le déroulé de l’entretien, l’implication du patient lors du déroulé de ce dernier, sa posture » |
« Posture, émotions, contenu, le cadre et son respect » |
|
MB3 « Idées noires, idées suicidaires, troubles du sommeil, risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif, consos » |
« Posture, idées de suicide, angoisses, sommeil, consos, environnement social et professionnel » |
|
SG3 « Langage verbal, non-verbal, paraverbal + réponses à la question précédente |
« A B C D E F G H I J de l’accueil à la conclusion de l’entretien + réponses au prétest » |
|
JR3 « Le risque suicidaire, la posture, les attitudes du patient » |
« Repérer les risques suicidaires et éléments VELCRO, des modifications dans l’attitude ou physique si l’on connait déjà le patient, aux signes d’agressivité ou de mal être » |
Finalement assez peu d’évolution dans les réponses, pour cet item, entre pré et post-test. Les soignants sont attentifs, voire vigilants au risque suicidaire. Quel que soit le lieu de soin où ils exercent. AP le dit bien : les soignants sont vigilants quant aux signes qu’ils peuvent observer. L’arbre suicidaire cache-t-il la forêt de signes ? Tout passe par le regard et peu par l’écoute. SG et CF prennent en compte le déroulé de l’entretien et les différents types de langage.
Peu dévolution donc entre pré et post test. Si les éléments auxquels être attentifs s’enrichissent, ils passent plus par le regard que par l’écoute.
Quels éléments prenez-vous en compte lorsqu’il s’agit d’orienter le patient ?
|
Pré-test |
Posttest |
|
SB1 |
|
|
SC4 « » |
« Idées noires, idées suicidaires, agitation » |
|
NC4 « Prise du sommeil, apaisement » |
« Ressources, idées de suicide, agitation, alliance thérapeutique » |
|
ED4 « Présence d’addiction, risque suicidaire, présence de délire, présence d’une agressivité potentielle » |
« L’agitation, le potentiel agressif, risque suicidaire » |
|
AP4 « Les signes cliniques, la pathologie » |
« La demande du patient, le risque suicidaire, la potentielle agressivité, ses besoins en termes de contenance » |
|
AC4 « Sa volonté, sa maladie, son comportement, etc. » |
« Profil et maladie, sa demande et nos possibilités » |
|
CF4 « Sa pathologie, son âge, s’il s’agit d’un premier contact ou non avec la psychiatrie, s’il s’agit d’un HL ou SSC, son degré de risque de passage à l’acte suicidaire » |
« La gravité de la symptomatologie, la demande, l’attente du patient, son mode d’hospitalisation » |
|
MB4 « Les mêmes qu’à la question précédente » |
« Le profil du patient, ses possibilités et les nôtres » |
|
SG4 « Age, gravité de la situation, agressivité, volonté du patient » |
« Demander au patient de faire une synthèse de l’entretien + réponses pré test » |
|
JR4 « La pathologie, les anciennes hospitalisations » |
« La pathologie, la compliance au soin, ses hospitalisations antérieures, si possible les préférences du patient » |
Cet item n’aurait jamais dû être inclus dans le pré et post-test, la moitié du groupe n’orientant pas les patients vers une autre structure. En première analyse, les soignants privilégient les troubles du comportement auto ou hétéro-agressifs. En post test, apparaissent la sévérité du trouble, le profil du patient (notion qui mériterait d’être interrogée), la demande et les possibilités de l’institution.
Avec quels outils évaluez-vous l’aspect thérapeutique de ces entretiens ?
|
Pré-test |
Posttest |
|
SB1 |
|
|
SC5 « » |
|
|
NC5 « Prise du sommeil, apaisement » |
|
|
ED5 « Pas d’outil, cela se base sur l’observation, la diminution de l’agitation par exemple, une accalmie » |
« Proposer au patient de faire une synthèse de l’entretien. Cela permettra de voir quels éléments il occulte, qu’est-ce qu’il met en avant, le rendre acteur » |
|
AP5 « pas d’outil mais l’observation du patient, s’il est apaisé ou pas » |
« Le but étant de faire une synthèse complète à propos du patient à la fin de l’entretien » |
|
AC5 « » |
« Synthèse, MTVED » |
|
CF5 « La transmission du savoir par mes collègues anciens sur la structure. Parfois le bon sens » |
« MTVED, la grille de l’elfe, le A jusqu’à J » |
|
MB5 « L’ordonnance, le logiciel cariatide, l’appel pharma » |
« MTVED » |
|
SG5 « Plaquette risque suicidaire, expérience, URD, antécédents, ordonnance, traitement » |
« Génosociogramme, questions de l’elfe ; grille de Séglas + prétest » |
|
JR5 « Observation du patient, les changements de comportement à observer » |
« L’observation, les techniques de reformulation » |
Cet item est souvent celui qui recueille le moins de réponses en prétest. Pour les soignants, en début de formation, il ne va pas de soi que l’entretien infirmier puisse avoir des effets thérapeutiques. Il est donc difficile de nommer des outils qui permette de l’évaluer. Cet effet thérapeutique est, par ailleurs, difficile à observer lorsque l’on ne revoit plus le patient hospitalisé dans une autre structure de soin.
Quoi qu’il en soit, en prétest sont cités l’observation, l’apaisement, le savoir transmis par les collègues plus anciens (plutôt opérant dans la structure de soin), les changements de comportement. Encore une fois peu reposent sur l’écoute du patient et, par exemple, la qualité de son insight.
En posttest, ED retient la synthèse de l’entretien effectuée par le patient, quatre soignants citent le MTVED (macrocible) qui peut effectivement servir à ce type d’évaluation si les effets thérapeutiques de l’entretien y sont intégrés, SG rajoute quelques outils d’entretien travaillés lors de l’entretien. A cet item aussi, l’évolution des représentations et des modes de pensée est perceptible.
Une formation qui modifie donc les représentations des stagiaires sur le cadre de l’entretien (elle promeut une vision plus large des entretiens informels et du cadre de soin), elle permet aux stagiaires d’affiner les objectifs qu’ils fixent à l’entretien d’accueil et de crise, d’être davantage vigilants à la parole du patient, à sa demande de soin, à ses ressources. Le patient y apparaît davantage acteur de ses soins.
Satisfaction des stagiaires
Les 10 participants présents ont rempli le questionnaire. Sept avaient demandé la formation, trois non :
« Le cadre du service nous l’a proposée car cela pouvait être bénéfique à l’amélioration de notre pratique professionnelle » ;
« Formation prévue par l’ancien cadre UADO ».
On note l’importance de la fonction « prescriptrice » des cadres.
Parmi ceux qui ont demandé la formation :
« Volontaire, fiche d’inscription présente dans le service » ;
« Cœur de mon activité sur mon service » ;
« Formation proposée par la cadre ».
On mesure que la formation s’inscrit bien dans un mouvement institutionnel avec des cadres qui facilitent voire mobilisent les soignants.
Perception globale de la formation
90 % des stagiaires ont une perception positive de la formation.
La durée
80 % des stagiaires ont trouvé la durée de la formation adaptée
10 % trop longue,
10 % trop brève
« Un jour aurait suffi » ponctue le stagiaire qui trouve la formation trop longue. Dans la suite du questionnaire, il note qu’il aurait préféré moins de théorie.
« Il faudrait un suivi pour débriefer de ce qu’on a pu mettre en application » explique le stagiaire qui la trouve trop courte. La durée est pour lui, le point faible de la formation, il suggère par ailleurs de mettre en place un suivi.
Le découpage en deux jours consécutifs ne permet pas, effectivement, de faire retour au terrain des stagiaires pendant la durée de la formation. Il est toujours intéressant que les stagiaires puissent expérimenter les outils pour en faire une critique.
Il serait intéressant de proposer aux stagiaires de venir avec une situation d’entretien complexe afin de partir de leur expérience.
Enrichissement professionnel
100 % des participants ont tous retiré un enrichissement professionnel de la formation.
« Cela m’a permis d’avoir des clés pour mener à bien les entretiens »
Le nombre de participants et les échanges en groupe
90 % des participants ont trouvé que le nombre de stagiaires était satisfaisant et 10 % l’ont trouvé insuffisant.
100 % des stagiaires ont trouvé les échanges entre participants satisfaisants.
Les réponses ne sont pas éclairées. On peut noter que les participants se sont installés par unité : d’un côté l’UADO, de l’autre le service de nuit et au milieu les soignants de l’UIF. La durée de la formation n’a pas permis de mixer le groupe. On se mélange peu entre soignants des différentes unités.
Les apports de connaissance
100 % des stagiaires ont jugé les apports de connaissance pertinents.
Les méthodes pédagogiques
100 % des stagiaires ont trouvé les méthodes pédagogiques favorisantes.
Les capacités relationnelles du formateur
100 % des stagiaires ont trouvé les capacités relationnelles du formateur favorisantes.
Analyse des points forts de la formation
Les participants ont retenu :
« Groupe. Expérience de chacun. « ;
« Pédagogie du formateur et approche avec nouvelles techniques » ;
« Apports pertinents, bien illustrés. Etudes de cas, mise en situation. » ;
« Expériences & illustrations du formateur, exemples, partage de retour (RETEX). » ;
« Interactivités des échanges adaptées aux différents entretiens. » ;
« Explications données sous forme de situations vécues » ;
« Formateur à l’écoute, sans jugement qui donne ses informations de façon très simple » ;
« L’échange, le contenu de la formation est entièrement réalisable » ;
« Le travail sur les cas concrets » ;
« Travail sur un cas concret ».
Chacun y a trouvé quelque chose qui l’intéressait. Se détachent les aspects très concrets de la formation, l’écoute du formateur, l’interactivité au sein du groupe.
Plan d'amélioration continue de la qualité
Les points faibles
Peu de points faibles rapportés. Notons que les points forts des uns peuvent être les points faibles des autres :
« Trop court » ;
« Mise en place concrète de certains axes peu probables du fait de l’organisation » ;
« Que ce ne soit pas plus homogène dans le groupe, temps de parole +++ des soignants de l’UADO. »
L’écart entre une pratique très pointue et organisée (celle de l’UADO) et celles moins ouvertement centrées sur l’accueil et la crise des soignants (plus informelle) des deux autres unités représentées dans cette formation peut limiter les uns et tirer les autres vers le haut. Il faudrait probablement une formation généraliste pour les uns et une autre ciblée sur l’entretien d’accueil et de crise pour les soignants de l’UADO, des CMP et des structures de soins qui travaillent sur l’accueil et la crise.
Les points à modifier
Peu de points à modifier pour les participants.
« Se cantonner à un seul service pour plus d’échanges » ;
« Faire un suivi » ;
« Moins de théorie, plus d’activité » ;
« Le titre « Entretien d’évaluation de la crise » n’est peut-être pas le plus adapté ».
Les réponses à cet item sont assez complémentaires du précédent.
Pistes de changements
Ces différentes remarques et regrets ont été notés et adressés à l'institution lors du bilan collectif effectué par la responsable de la formation continue et lors de l'évaluation écrite de la formation.
Les participants seront recrutés parmi les soignants qui pratiquent préférentiellement des entretiens d'accueil et de crise. Les futurs stagiaires devront par ailleurs venir en formation avec une situation d'entretien d'accueil complexe.
La session programmée en septembre 2023 a été annulée en raison d'un trop petit nombre de soignants disponibles.
L'évaluation globale de la formation peut être lue sur ce fichier envoyé au service de formation continue de l'établissement.
![]() Bilan entretien accueil et crise rodez (41.45 Ko)
Bilan entretien accueil et crise rodez (41.45 Ko)
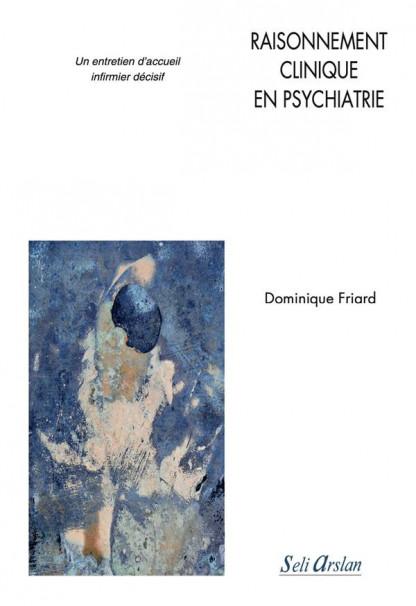
L'écriture professionnelle de recherche
Genèse de la formation
Infirmier, cadre-supérieur de santé et sociologue, Michel Combret a investi la recherche en soins depuis de très nombreuses années. Son chemin a régulièrement croisé celui de Serpsy. Aussi quand il s’est agi de mettre en place une formation à la recherche et à l’écriture professionnelle au Centre Hospitalier de Cadillac, il s’est rapproché de l’association. Nous avons commencé à en parler, échanger, réfléchir en juin 2022. Il nous a envoyé le Cahier des Charges d’une formation aux écrits professionnels de recherche en août 2022. L’association a répondu au dit Cahier des Charges en janvier 2023 (version définitive) pour une formation à effectuer les 27 et 28 février 2023.
![]() Elaboration formation les ecrits professionnels de recherche (14.27 Ko)
Elaboration formation les ecrits professionnels de recherche (14.27 Ko)
![]() Cdc ecrits professionnels v1 (407.47 Ko)
Cdc ecrits professionnels v1 (407.47 Ko)
![]() Les ecrits professionnels de recherche (70.64 Ko)
Les ecrits professionnels de recherche (70.64 Ko)
Contexte particulier
Le centre Hospitalier de Cadillac s’est investi très tôt dans une démarche de recherche infirmière. Les premiers textes publiés remontent à la fin des années 1990. [1] Il s’agissait alors d’une démarche pionnière. D’autres travaux ont vu le jour et été publiés, notamment sur la Mise en chambre d’isolement entre 2009 et 2010[2] sur un site internet consacré à la recherche en soins en psychiatrie et dans une revue de soins[3]. La création d’un bureau dédié à la recherche en soins répond à la nécessité d’organiser la démarche, de la pérenniser et de la promouvoir (N°1 3.1.08 du référentiel HAS Certification des établissements de santé pour la qualité des soins). Cette institutionnalisation de la recherche paramédicale repose sur la création et le développement d’une culture collective de recherche qui passe, entre autres, par la recherche bibliographique, la lecture critique d’articles et d’ouvrages dédiés au champ, l’abonnement à des revues, l’écriture de différents types de documents dont des articles de recherche.
La culture infirmière est d’abord une culture orale. Les infirmières écrivent peu et lisent encore moins. La refonte des études de 2009 n’y a rien changé. Le Travail de Fin d’Etudes (TFE), souvent présenté comme le fruit d’une initiation à la recherche reste pour beaucoup un souvenir traumatisant qu’il faut revisiter. La recherche suppose de passer d’une culture de l’oral à une culture de l’écrit. C’est objectif principal de cette formation.
Pré et post-tests
![]() Pre et post test ecriture scientifique (13.62 Ko)
Pre et post test ecriture scientifique (13.62 Ko)
Analyse des réponses
-
Quel est le dernier livre ou article traitant des soins que vous avez lu ?
|
PC « Le monde, Infirmier en pratique avancée ; Mediapart, les infirmiers que les médecins veulent empêcher d’avancer » |
« Considérations autour d’un repas » |
|
0CS « Christophe André, Anxiété » |
« Question de la thérapie et du changement dans le soin chez les auteurs de violences sexuelles » |
|
LC « Un chapitre d’un livre traitant des « symptômes en réseau » |
« Question de la thérapie et du changement dans le soin chez les auteurs de violences sexuelles » |
|
DM « Article sur l’interruption de formation chez les étudiants infirmiers » |
« Les processus de changement dans le soin » |
|
DA « Semaine dernière (revue sur Isolement), livre « Psychotraumatisme » » |
« Processus de changement dans le soin » |
|
LNL « » |
« De la sonnette aux soins, de l’appel aux bruits » |
|
CN « Articles sur les troubles de la déglutition (Elzevier Masson), rééducation des troubles de la déglutition et de l’oralité (Catherine Senez), HAL archives mémoires sur les pathologies de la salive |
« Comprendre l’éthique du care en cancérologie : de l’angoisse aux interventions non-médicamenteuses » |
|
FP « Dossier Santé Mentale, Estime de soi » |
« Comprendre l’éthique du care en cancérologie : de l’angoisse aux interventions non-médicamenteuses » |
|
DF « Santé Mentale, Le corps âgé », le Training Autogène de Schultz » |
« Article de recherche sur les émotions des infirmiers en unité Covid. » |
|
GN « Article sur le repas thérapeutique issu d’un Santé Mentale et écrit par 1 HDJ En cours de lecture la psychothérapie psychanalytique des psychoses » |
« Un article sur la place du repas en UMD » |
|
BM |
« De la sonnette aux sons, de l’appel aux bruits » Angélique Jacquart, Jean-Charles Lallier » |
|
IM Santé Mentale, un dossier sur le travail en équipe/soigner en équipe |
« L’atelier d’Abrar d’Eve Thorigny, Mohamed Ameziane Abdelhak et Marie-Rose moro. Dans le cadre d’un exercice de formation » |
|
SH Thèse médicale sur la communication entre médecins généralistes et psychiatres » |
« L’atelier d’Abrar ! » |
Mobilisés par la recherche, les participants lisent. Seuls deux d’entre eux n’ont pu donner le titre d’un article ou d’un ouvrage récemment lu. La proportion est beaucoup plus importante chez des soignants non engagés dans un travail de réflexion. Le nombre de livres lus est souvent le reflet d’une sociabilité qui encourage la lecture. Les articles et les livres cités en pré-test sont le reflet de la diversité des centres d’intérêt des membres du groupe.
La question n’incitait pas les répondeurs à donner le nom de l’auteur, le nom de la revue et le genre de l’article ou de l’ouvrage. L’auteur est cité par deux d’entre eux, six donnent le nom de la revue où a été publié l’article.
En post-test, chacun cite l’article sur lequel il a travaillé lors de la formation. Une lecture critique, digérée, remâchée, et présentée au groupe. Chacun a ainsi lu, critiqué, commenté, présenté un texte et entendu les critiques et commentaires de 6 autres textes qu’il n’aurait pas lu sans la formation. Ces textes analysés, même s’ils peuvent être loin des préoccupations du groupe ou de ses membre (finalement pas tant que ça), constituent un patrimoine commun minimal. Ils ont également en commun la capacité à faire une lecture critique d’un texte et à le présenter à un tiers, membre d’un même groupe. La démarche est même valorisée.
Deux participants citent les auteurs, aucun ne cite la revue d’où est extrait l’article. Neuf donnent le titre exact.
Il existe bien un mouvement avant/après induit par la formation. Le fait que chaque stagiaires ait repris l’article travaillé en formation, s’il n’est pas illogique en est tout de même un indice.
-
Lorsque vous lisez un article ou un livre traitant des soins, à quels éléments êtes-vous attentifs ?
|
PC « Je lis surtout les articles par intérêt personnel ou ceux qui pourraient m’apporter de nouvelles connaissances. Je sélectionne peu de livres traitant des soins, souvent trop laborieux à comprendre » |
« Idem » |
|
0CS « Titre, chapitre/thèmes/concepts » |
« Titre/Auteur/Pertinence/Cadre théorique/Qualité » |
|
LC « La possibilité ou non d’utiliser l’information dans ma pratique » |
« Les apports pratiques en situation de soin » |
|
DM « Données, sources bibliographiques, profession de l’auteur, parti pris, intérêt pour ma propre pratique » |
« Méthodologie/Bibliographie/Rigueur de la démarche/Intérêt du sujet/Avancée dans le domaine » |
|
DA « Qui l’a écrit, l’année d’écriture » |
« Clarté/Lisibilité/Structuration de l’analyse/Texte/Biblio » |
|
LNL « La facilité à lire et comprendre, le vocabulaire utilisé, la manière dont l’article/livre est organisé (chapitre, paragraphe) pour le rendre plus simple à comprendre, la syntaxe » |
« Pertinence du sujet, cadre théorique, méthodologie utilisée (cohérence et rigueur) » |
|
CN « Le résumé, le sommaire, les annexes, l’auteur, l’année, le vocabulaire, la bibliographie, le titre » |
« Le résumé, la bibliographie, les auteurs, la clarté, la rédaction, la possibilité de le critiquer » |
|
FP « Aux apports théoriques et aux références |
« La méthodologie utilisée, la clarté avec des intertitres, le thème abordé, la bibliographie, les concepts. S’il enrichit la thématique » |
|
DF « La clarté, le lien avec la clinique » |
« Concepts, méthodo, biblio, fiabilité » |
|
GN « A un appui sur des exemples cliniques et du soin au quotidien » |
« A l’auteur du texte, aux références théoriques, à la structuration du texte » |
|
BM « Date parution, relecture par des pairs, auteurs, comité éthique, ref. biblio, les biais, concepts » |
« Idem » |
|
IM « L’auteur, son parcours, ses écrits, son champ disciplinaire. Je regarde si la revue est à comité de lecture ou pas. » |
« Les auteurs, la bibliographie, l’introduction, la conclusion, la structure du texte » |
|
SH « Journal dans lequel est publié, l’année de publication, abstract, méthodologie, nom des auteurs » |
« Développement des concepts, enchaînement des parties, compréhensible pour tous les professionnels de la spécialité » |
En prétest, quatre stagiaires sont d’abord attentifs à l’intérêt que représente l’article (ou le livre) pour leur propre pratique. La représentation sous-tendue est décrite par PC : « Je sélectionne peu de livres traitant des soins, souvent trop laborieux à comprendre ». Les textes élus doivent avoir des liens avec la pratique et être aisé à lire et à comprendre (LNL). Le mot « clarté » apparaît d’ailleurs dans 7 réponses aux différents items. Ces stagiaires se différencient alors peu de la moyenne des soignants. Les autres stagiaires prennent davantage en compte les aspects techniques de l’écriture ou de la recherche : titre, thèmes, concepts, bibliographie, profession de l’auteur, parti pris, l’année de publication, la structure du texte, sa syntaxe, la clinique, la méthodologie.
Après avoir été confronté à 7 textes, les réponses évoluent-elles ?
Il est intéressant de noter que PC reproduit à l’identique ses réponses entre pré et post-test, comme s’il n’y avait aucune différence entre l’avant et l’après. Une formation pour de rien en quelque sorte.
Les stagiaires passent d’une conception où le texte est un tout qui doit être lisible et enrichir la pratique à l’étude critique de ses différents composants. L’évolution est d’autant plus importante que les stagiaires appartenaient à l’une ou l’autre de ces catégories. Ainsi DA qui était attentif à l’auteur et à l’année de parution, déclare prendre en compte, en post-test : clarté, lisibilité, structuration de l’analyse, le texte et sa bibliographie. Une lecture plus exigeante des différents éléments d’un texte produit nécessairement des effets en termes d’écriture. Les compétences en lecture se transfèrent toujours sur l’écriture et la conception du texte. A minima, les stagiaires sont plus sensibles dans leurs lectures professionnelles aux aspects méthodologiques, à la bibliographie (place du texte dans la constitution d’un corpus théorico-clinique), ils seront plus vigilants quant à ces aspects quand ils devront eux-mêmes écrire.
La formation a atteint cet objectif.
-
Pourquoi faut-il être attentif à l’ours d’une revue ?
|
PC « Il permet de prendre connaissance de ceux ayant participé à l’écriture, la publication, etc. « |
« Idem » |
|
0CS « ? Acronyme ? O ouvrage ; U ? R Résultats, S Synthèse ? |
« Ceux qui ont participé à la rédaction » |
|
LC « ? » |
« Elle détermine la composition de l’équipe de publication/Scientifique » |
|
DM « Parce que si l’Ours est une dame, la rencontre avec mon ours intérieur pourrait être agréable » |
« Composition du Comité de lecture, qui écrit et compose la revue. Métiers de chacun » |
|
DA « Si elle est très velue » |
« Afin de connaître la composition du Comité de lecture et pour apporter des éléments de lecture aux textes publiés » |
|
LNL « ? » |
« Pour la fiabilité de la revue » |
|
CN « Je ne sais pas ce que c’est, je ne connais que l’animal » » |
« Afin de connaître le contexte de la rédaction » |
|
FP « Parce qu’il est sympathique » |
« Pour savoir l’orientation du texte qu’on lit » |
|
DF « Les seuls ours que je connaisse sont dans la nature » |
« ? » |
|
GN « C’est la source du document. Elle est vérifiable » |
Elle permet de connaître les auteurs : rédacteurs du texte et de savoir dans quel cadre se situe la lecture » |
|
BM « ? » |
« Rechercher les personnes citées car il se peut qu’elles soient décédées » |
|
IM « ? » |
« Pour apprécier le but, les champs disciplinaires et les objectifs de la revue » |
|
SH « Ours ? » |
« Connaître le Comité de lecture permet d’orienter ses écrits » |
Cette question relevait davantage de la culture générale que d’un savoir technique ou scientifique. Il s’agissait d’amener les stagiaires à s’interroger sur le support de publication lui-même. La référence animalière, incongrue dans ce contexte, avait également pour but de les surprendre et de stimuler leur intérêt. Il s’agissait également de les amener à mieux connaître les supports auxquels ils soumettraient leurs textes.
Une seule stagiaire sait ce qu’est l’ours (ou colophon) d’une revue (encadré qui présente l’entreprise -imprimeur, éditeur-, son organigramme, l’équipe qui fabrique la revue, le comité de rédaction et le comité scientifique, etc.). En prétest, les réponses sont donc parfois savoureuses (« Une rencontre avec mon ours intérieur pourrait être agréable »). Cette méconnaissance ne vaut plus en post-test. Les stagiaires ont eu l’occasion de parcourir l’ours des revues proposées. Chaque stagiaire mesure alors l’intérêt qu’il y a, en termes de lecture et de publication, à le parcourir voire à l’étudier. C’est une autre façon de contextualiser le texte lu.
-
Comment décririez-vous votre type d’écriture ?
|
PC « Illisible !!! J’écris souvent pour aller à l’essentiel, mais parfois je me perds dans le plaisir de développer une idée. Je relis et réécris alors plusieurs fois, pour raccourcir mes écrits » |
« Idem » |
|
0CS « Synthétique » |
« » |
|
LC « Sans stress, dans l’urgence, après procrastination » |
« Après procrastination » |
|
DM « De plus en plus facile (à lire et à produire) » |
« Identique » |
|
DA « Lourde, pesante » |
« Plus légère que par le passé, plus structurée » |
|
LNL « Longue et prolixe » |
« Longue et prolixe » |
|
CN « Eparpillée et laborieuse » |
« Plus ordonnée je l’espère ! » |
|
FP « Brut » |
« Plutôt rude, difficulté à développer » |
|
DF « Plutôt romanesque ? » |
« ? » |
|
GN « Vivante ; en appui avec des exemples, assez descriptive, pas assez référencée d’un point de vue théorique » |
« Assez narrative, descriptive, littéraire à type de vignette » |
|
BM « Très littéraire, descriptive » |
« Idem » |
|
IM « J’ai une écriture lourde avec de longues phrases. Je suis novice. » |
« Je suis novice ++, je dois apprendre à structurer ma façon d’écrire » |
|
SH « Peu littéraire, plutôt synthétique et scientifique » |
« » |
Le pré et le post test étant rédigé avant le début de la formation, cette question invitait les stagiaires à explorer leur propre écriture et à la décrire. Faute de thématique de recherche élue par le collectif, cet aspect n’a pas été directement travaillé au cours de ces deux jours. La lecture d’articles ne pouvait suffire à modifier les représentations de chaque stagiaire quant à son écriture.
En prétest, les stagiaires ont une représentation plutôt péjorative de leur écriture : Illisible, lourde, pesante, longue, prolixe, éparpillée, laborieuse, brute, romanesque, pas assez référencée d’un point de vue théorique, peu littéraire. Peu de stagiaires ont une vision positive de leur écriture. C’est un point sur lequel, il faudra permettre au groupe de travailler.
Nous notons peu d’évolutions entre pré et post-test. A cela rien d’étonnant, l’écriture n’a pas été directement travaillé au cours de la formation. Ces représentations sont le fruit d’un parcours scolaire, plus ou moins long, plus ou moins modelant, propre dans tous les cas à susciter un jugement négatif intégré par le stagiaire (auto-stigmatisation).
-
Qu’est-ce qu’un concept pour vous ? Citez en deux utiles pour votre travail de recherche …
|
PC « Dans le cadre de la recherche, je ne suis pas sûre de savoir ce qu’est un concept. Je partirais sur la bienveillance et le questionnement » |
« Idem » |
|
0CS « Terme qui permet de comprendre le sens principe d’une idée » |
« Objet abstrait conçu par l’esprit et permettant d’affiner les perceptions et les connaissances » |
|
LC « Alliance thérapeutique et approche motivationnelle » |
« Un ensemble de théories dans un champ donné » |
|
DM « Ensemble de notions travaillées dans le but d’éclairer une idée, situations, idéalement reproductible Compétence/Professionnalisation » |
« Idem pré-test. Définition du concept d’apaisement » |
|
DA « Soins en psychiatrie, cela me permet de clarifier ma pensée et où (discipline) je souhaite la travailler. » |
« Apaisement, soins infirmiers en psychiatrie, ensemble théorique permettant une présentation commune d’une idée » |
|
LNL « Une notion, une idée qu’on essaye de « conceptualiser » pour pouvoir y réfléchir dessus et théoriser de manière juste et pragmatique » |
« Idem qu’au prétest. Apaisement » |
|
CN « Une idée qui a été théorisée et qui fait office de base » |
« » |
|
FP « C’est un élément théorique, concept de contenance psychique, le concept d’estime de soi » |
« Une idée à l’intérieur d’un thème » |
|
DF « Un concept représente une idée qui peut être théorisée ou un ensemble d’idées. La concept de vieillesse, de folie » |
« » |
|
GN « C’est un fil conducteur dans ma pratique. Accueil, contenance » |
« Les idées principales du soin qui définit 1 article ou 1 travail de recherche. Ces idées doivent être définies. Contenance, accueil » |
|
BM « Autonomie, liberté » |
« Idem » |
|
IM « Une idée définie par différents auteurs, ex : le risque » |
« Contenance, perception du risque, risque » |
|
SH Concept : définition avec laquelle tout le monde comprend la même chose : représentation sociales, négligence » |
« Une « définition » à « triturer » pour confronter les différentes définitions » |
Comme PC, au prétest, les stagiaires sont peu sûrs de savoir ce qu’est un concept. Si aucun ne définit précisément ce qu’est un concept, chacun en a une idée, plus ou moins précise. Ils savent tous que ce type d’objet abstrait est important dans le cadre de la recherche. Certains ne se risquent pas à définir la notion mais citent deux concepts utiles pour leur travail de recherche. Les concepts proposés en vrac : bienveillance, questionnement, alliance thérapeutique, approche motivationnelle, compétence, professionnalisation, soins en psychiatrie, contenance psychique, estime de soi, vieillesse, folie, accueil, contenance, autonomie, liberté, risque, représentations sociales, négligence, soit 18 thématiques. Ce « vrac » est intéressant parce qu’il balaie les idées, les thèmes de recherche potentiels qui circulent au sein du groupe. C’est à partir de cette énumération que le thème de recherche commun pourra être choisi par le groupe.
Entre le pré et le post-test la groupe a choisi de travailler autour de l’objet concret « chambre d’apaisement » et du concept d’apaisement (à construire). C’est un premier résultat important de la formation : avoir permis l’émergence d’un thème de recherche commun qui pourra être creusé à partir de différents regards et sous-thèmes à définir.
En post-test, la définition du mot « concept » s’est stabilisée chez la plupart des stagiaires. OCS en fournit une tout à fait acceptable. Le concept d’apaisement est repris par trois stagiaires. Deux stagiaires retiennent des thématiques proches, d’abord celle de contenance, puis accueil et risque. Les 18 thématiques ne sont plus que 4. Le passage par l’entonnoir s’est effectué. Au groupe de peaufiner, lire, critiquer, définir.
-
Lorsque l’on vous parle d’écriture professionnelle de recherche, quels sont les quatre mots qui vous viennent ?
|
PC « Curiosité, motivation, patience, évolution » |
« Idem » |
|
0CS « Rigueur, ouverture d’esprit, cheminement, écrits » |
« Cadres théoriques, concepts, Soins, méthodologie » |
|
LC « Bibliographie, théories/concepts, résultats » |
« Bibliographie, méthode, concepts, théories » |
|
DM « Emergence des savoirs, formalisation, valorisation, rigueur » |
« Pertinence, rigueur, clarté » |
|
DA « Rigueur, méthode, clarté, application dans les soins » |
« Méthodologie, accessibilité, rigueur, biblio » |
|
LNL « Fiabilité, utilité, questionnements, exploration » |
« Cadre théorique, pertinence, méthodologie, analyse » |
|
CN « Scientifique, méthodologique, génétique, livres » |
« Transmettre, pertinence, rigueur, clarté » |
|
FP « Recherche, réflexion, analyse, critique » |
« Lecture, tri, mise en forme, plaisir du travail » |
|
DF « Concision, référence, précision, lexique professionnel » |
« » |
|
GN « Prise de recul sur le travail, curiosité, transmission, valorisation » |
« Valorisation du travail et de l’existant, curiosité, prise de recul sur le travail » |
|
BM « Expérience, réplicable, probant, éthique » |
« Expérience, réplicable, probant, éthique » |
|
IM « Bibliographie, enquête, méthode, biais » |
« Bibliographie, biais, enquête, cœur de métier » |
|
SH « Question, hypothèse, synthèse, validation » |
« Concepts, critique, clarification, échanges » |
Ce dernier item explore les représentations des stagiaires sur l’écriture professionnelle de recherche.
Les mots qui représentent l’écriture professionnelle de recherche sont très nombreux. Il y a finalement peu de redondances. Nous sommes donc loin d’avoir épuisé le potentiel de réponses.
En prétest, les mots qui reviennent le plus souvent sont : rigueur (3), bibliographie (2), curiosité (2), motivation (2), valorisation (2), méthode (2).
En post-test, les mots les plus fréquents sont : rigueur (3), bibliographie (3), concept (3), méthodologie (3), pertinence (3), travail (3), clarté (2).
Peu d’évolution des représentations donc, entre pré et post-test. Le nombre de mots proposés en post-test et légèrement moins important. La formation ne durant que deux jours, ce n’est guère étonnant. Il faut du temps pour modifier les représentations.
Même si les mots curiosité (3 occurrences) et plaisir (1) apparaissent, l’écriture renvoie d’abord à la rigueur et à la méthodologie, la bibliographie qui permet de définir les concepts en étant la manifestation. La formation a conforté cette représentation du travail de recherche.
Satisfaction des stagiaires
Questionnaire de satisfaction
Tous les stagiaires ont fait la formation à leur demande. La démarche s’inscrit dans le cadre de la démarche institutionnelle de recherche « paramédicale ».
- « Obtenir des réactualisations sur l’écriture d’articles » ;
- « Participer à la dynamique de recherche paramédicale » ;
- « Globalement oui, n’ayant aucune expérience dans le milieu, débutant ma réflexion sur les modalités de la recherche, mes objectifs étaient très simples : découvrir et appréhender le vocabulaire de base, la méthodo, etc. »
- « Dans le but d’écrire des articles et de faire de la recherche (encore !) » ;
- « Membre du groupe recherche au CHS » ;
- « Ces 2 jours s’inscrivent dans un module de 7 jours en tout autour de la « Recherche en soins ». Formation que j’ai demandée pour comprendre la méthodologie de la recherche, la publication d’articles … »
- « Pour mieux appréhender la méthodologie de recherche » ;
- « Fait partie des jours de formation du groupe du C.H. ».
Les participants participent à la formation dans le cadre de leur engagement au sein du groupe de chercheurs. Méthodologie et écriture et publication d’articles sont au centre de leur demande.
Perception globale de la formation
100 % des stagiaires ont une perception globale positive de la formation.
- « Etayage, illustrations, apports théoriques (auteurs), échanges professionnels très appréciables » ;
- « Positive même si pas exactement celle attendue » ;
- « Elle était riche et accessible, les échanges éclairants et pertinents au regard de mes attentes » ;
- « Riche en enseignement. Toutes les questions ont une réponse ».
La durée de la formation
50 % des stagiaires ont trouvé la durée de la formation adaptée.
50 % l’ont trouvée trop courte :
- « Une journée de plus pour l’écriture » ;
- « Il est toutefois important de quitter ces 2 jours avec l’impression d’un manque qui permettra d’aller explorer … ».
Plus que la durée, c’est le moment où la question de l’écriture est abordée qui s’est avérée problématique. Faute de sujet de recherche, les stagiaires naviguent dans le flou. La journée consacrée à l’écriture gagnerait à être programmée en jour 6.
Un enrichissement professionnel ?
100 % des stagiaires ont retiré un enrichissement professionnel de la formation :
- « Tout à fait !!! » ;
- « Echanges très intéressants, occasion de développer une nouvelle compétence soignante » ;
- « En termes de concepts à « tirailler » pour en arriver à en révéler l’essentiel pour publication » ;
- « Les échanges, l’écoute, l’apport théorique, les supports (livres, revues), l’apport d’expérience renforcent l’acquisition du contenu ».
Le nombre de participants
Il est apparu satisfaisant à 100 % des stagiaires.
Les échanges avec les autres participants ont été décrits comme enrichissants par 100 % des stagiaires.
« Je n’avais aucune expérience (si ce n’est le TFE) dans la rédaction. Je débute dans la recherche et la lecture. Je suis moins homogène que le groupe. J’ai pu bénéficier des échanges et du partage d’expériences. »
Les apports de connaissances
Ils ont paru pertinents à 100 % des stagiaires.
- « Je trouve dommageable qu’un thème de recherche n’ai pas été défini par le groupe avant la venue de D. Friard » ;
- « Ce n’était pas exactement conforme à ce qui était annoncé mais cela est plus de l’ordre organisationnel et institutionnel ».
Il eut été préférable, bien sûr, que le groupe ait davantage avancé en termes de pistes de recherche mais ce type d’erreur fait partie de l’apprentissage du groupe. Finalement, ça enrichit le groupe.
Les méthodes pédagogiques
Elles sont décrites comme favorisantes par 100 % stagiaires.
- « Dynamiques, interactives ».
Les capacités relationnelles du formateur
Favorisantes pour 100 % des stagiaires :
« Très accessibles, échanges facilités ».
Analyse des points forts
- « Apport théorique et richesse des échanges » ;
- « Echanges » ;
- « La richesse des échanges entre les participants » ;
- « Equilibre entre théorie et pratique » ;
- « Nombreux échanges, expériences concrètes du formateur » ;
- « Richesse et pédagogie du formateur » ;
- « La bienveillance et la disponibilité du formateur, les apports professionnels très riches et variés, et les supports également » ;
- « Nombreuses discussions autour des soins infirmiers en psychiatrie dans une approche concrète et un climat propice à la réflexion » ;
- « La dynamique du groupe, la dynamique du formateur, l’étayage par des exemples. » ;
- « Les échanges professionnels permanents entre le groupe et le formateur. Les supports utilisés. Nous avons travaillé très concrètement sur des articles. » ;
- « Formateur ressource ++ » ;
- « Réelle expertise, écoute + ancrage fort dans le métier infirmier + spécificités de la psychiatrie » ;
- « Nous permettre de passer à l’écriture d’un article » ;
« Echanges sur l’expérience dans le comité de rédaction de Santé Mentale ».
La qualité des échanges entre membres du groupe et avec le formateur constitue le principal point fort de la formation. Nous pouvons y lire la richesse d’un groupe en devenir qui s’apprivoise et fonctionne collectivement.
Plan d’amélioration continue de la qualité
Les points faibles
Peu de point faibles dans la formation. Essentiellement un. Sa brièveté, ou plutôt le moment de l’histoire du groupe où elle est proposée.
- « Nécessité du formateur de réadapter le contenu car pensait que nous avions déjà une question de recherche, ce qui est finalement positif »
- « Peu de support » ;
- « Un peu trop courte » ;
- « Trop court » ;
- « Pas assez longue » ;
- « L’absence d’un choix de thème de recherche qui aurait pu orienter le travail » ;
- « Trop court. Aurait été encore mieux à un moment avec rédaction en amont » ;
- « Nous n’avons pas abordé, du fait de la « jeunesse » de notre groupe, les écrits dans leurs détails. »
Suggestions d'amélioration
Les suggestions vont toutes dans le même sens :
- « Choisir un thème de recherche support à la formation » ;
- « Plus longue » ;
- « Se retrouver quand nous aurons plus avancé !! » ;
- « Un peu trop court, du temps entre les deux jours de formation »
Pistes de changements
Revenir quand le groupe aura suffisamment avancé sur la piste de recherche finalement choisie : L’apaisement.
Proposer un groupe de réflexion et de rencontre avec des pairs, hors formation : ADRPSY.
Accompagner le groupe dans ses développements.
L'évaluation globale de la formation peut être lue sur ce fichier envoyé au service de Formation Continue de l'établissement.
![]() Bilan ecriture professionnelle de recherche (47.91 Ko)
Bilan ecriture professionnelle de recherche (47.91 Ko)

Les soins aux patients atteints de pathologies dites archaïques (2 sessions)
Genèse
Présent au Centre Hospitalier de Sevrey via la formation à l’entretien clinique infirmier, Dominique Friard échange volontiers avec des personnels ouverts (infirmières, cadres et cadres supérieurs de santé, psychologues) dont il connait l’histoire et les difficultés. Confrontée à de nombreux départs (et donc à l’arrivée de soignant(e)s non formé(e)s) l’équipe de l’unité Bécarre qui accueille des patients déficitaires s’est demandé comment former ces nouveaux professionnels. Les aspects spécifiques des problématiques de ces patients, marqués par des troubles que l’on peut décrire comme archaïques exigent une formation spécifique différente de la classique Consolidation des savoirs. Il a commencé à y réfléchir, en avril 2022, avec Pierre Dumortier, le psychologue qui intervient dans cette unité. Ces patients étant souvent stigmatisés, il est apparu nécessaire de concevoir un contenu qui ouvre sur d’autres spécialités concernées par l’archaïque (pédopsychiatrie, gérontopsychiatrie). En mai 2022, une proposition était faite à l’établissement. Elle fut acceptée telle quelle et se déroula les 02/12/2022, 12 et 13/01/2023 et 9/10/02/2023.
![]() Elaboration formation soins aux personnes souffrant de troubles dits archaiques (13.95 Ko)
Elaboration formation soins aux personnes souffrant de troubles dits archaiques (13.95 Ko)
![]() Formation soins aux patients atteints de pathologies archaique 2 (81.05 Ko)
Formation soins aux patients atteints de pathologies archaique 2 (81.05 Ko)
Contexte
Le départ de professionnels expérimentés constitue toujours un moment délicat pour la continuité du soin en psychiatrie. Ces soignants chevronnés cumulent des savoir-faire et des savoir être que leurs remplaçants pourront acquérir au fil du temps à la condition qu’ils leur soient transmis. Ce passage nécessaire est particulièrement périlleux avec les patients hospitalisés au long cours qui souffrent de pathologies dites archaïques, que ce soit en pédopsychiatrie, en psychiatrie d’adultes ou en gérontopsychiatrie. Ces patients qui ne maîtrisent pas ou peu la parole, sont confrontés à des angoisses massives que les mots des soignants voire leur présence ne suffisent pas à contenir. Les soignants les plus expérimentés ont appris, au fil du temps et des expérimentations, les gestes, les attitudes qui les contiennent et les apaisent. Leurs successeurs doivent découvrir ou redécouvrir les moyens singuliers et souvent infimes, adaptés à chaque patient, qui permettent à ces patients de vivre dans un monde où ils ne se sentiraient pas constamment en péril d’engloutissement.
Confronté aux départs de nombreux soignants et à leur remplacement par des infirmiers novices, non formés à la psychiatrie, le CHS de Sevrey a besoin de leur proposer une formation qui leur permette de comprendre ce qui est en jeu pour ces patients, de leur proposer des soins qui prennent la mesure de leurs déficiences et de leurs angoisses, et de réguler collectivement l’impact de ces comportements sur leur psyché afin d’éviter de multiplier les contre-attitudes.
Une formation qui serait uniquement proposée aux soignants de l’unité Bécarre qui accueille principalement ces patients ne remplirait pas son office et contribuerait à entretenir une certaine stigmatisation de ces patients qui se propagent souvent à ceux qui les soignent. Nous avons fait le choix d’un contenu qui creuse la question de l’archaïque qui puisse être partagé entre soignants travaillant dans divers types de service : pédopsychiatrie, gérontopsychiatrie, MAS, etc. En explorant les toutes premières étapes du développement, les manifestations du transfert adhésif ou projectif, les enveloppes psychiques et les fonctions phoriques nous interrogeons également des modalités de soin peu enseignées et pourtant nécessaires dès qu’il s’agit de soigner et d’accompagner des patients en proie à des angoisses cataclysmiques qui projettent souvent leur terreur sur les soignants.
Première session
Pré et post-test
Analyse des réponses
Cinq questions ouvertes ont été posées aux stagiaires qui y ont répondu par écrit.
Comment caractériseriez-vous les patients atteints de pathologies dites archaïques ?
|
Pré-test |
Posttest |
|
MLR1 « Déficience intellectuelle plus ou moins marquée. Pulsionnel. Difficulté pour connaître nos codes sociaux » |
« Troubles de l’attachement et du développement lors de leur enfance. Déficience intellectuelle » |
|
NS1 « Patients qui ont des réactions primaires avec un Q.I. faible. Autisme, trisomie » |
« Patients avec des manquements affectifs, parents défaillants, vie tiraillée, etc. » » |
|
FK1 « Patients en souffrance suite à leur pathologie » |
« Patients étant restés dans un certain état primaire suite à leur pathologie/développement » |
|
EM1 « Les pathologies dites archaïques correspondent selon moi aux patients dont les réflexes, réactions font penser à un comportement qu’on retrouve chez les enfants et dont les pulsions nous feraient penser à un être humain « primitif » avec des demandes et des besoins « primitifs » » |
« Les patients atteints de pathologies dites archaïques sont des patients qui présentent un développement neuropsy primitif avec des réflexes et réactions qui répondent à des besoins primitifs » |
|
MM1 « Les patients atteints de pathologies dites archaïques se manifestent par des comportements primaires en termes de besoin (manger, dormir, être propre) mais aussi au niveau comportemental avec des besoins de toucher, de sentir » |
« Manifestations par des comportements primaires (pyramide de Maslow) et des stades de développement partiellement ou peu acquis (anal, oral, génital) » |
|
LF1 « Retard mental ou physique. Incapacité à comprendre les attentes demandées. Impulsivité » |
« Patient présentant un retard plus ou moins important s’étant arrêté au stade oral, anal ou phallique. Ce sont également des patients en recherche d’attention et pouvant se montrer agressif verbalement ou physiquement en cas de frustration » |
|
OF1 « Ce sont des patients qui présentent des besoins spécifiques. Le niveau intellectuel et les cognitions sont limitées ce qui les limite à avoir recours à des réactions primaires, mêmes proches du primitif, à l’image de jeu d’enfant voire du bébé (stades de développement » |
« Je reprendrai ma réponse du pré-test mais en pouvant préciser ces manifestations primaires plus poussées (différents types d’angoisse, idée plus claire du développement psycho-affectif de ces patients » |
|
MG1 « Retard neuropsychomoteur associés à des troubles du comportement » |
« Retard neuropsychomoteur associé à des troubles comportementaux » |
|
LB1 « Intolérance à la frustration. Impulsivité » |
« Lié aux premières étapes du développement (oral, anal, génital) » |
|
AH1 « Impulsivité. Fonctionnement psychique « répétitif ». Comportements archaïques » |
« Pathologies liées aux premières étapes du développement du bébé. Pathologies liées aux besoins primaires » |
|
CE1 « Intolérant à la frustration. Mode de vie et langage routinier » |
« L’ensemble de ces patients qui n’ont pu développer tous leurs réflexes primitifs qui peuvent se caractériser par des troubles du comportement » |
|
LL1 « » |
LL1 « Ce sont des patients dits avec des troubles « primitifs » (agrippement, mordre, griffure) Avec plusieurs étapes : orale, anale, génitale. Par exemple : tout mettre dans la bouche (PICA) » |
Un traitement statistique des réponses au pré et post-test n’aurait guère de légitimité, la variable liée à la profession ne pouvant être écartée et conditionnant les réponses. Entre ce qu’écrit une aide-soignante et la psychologue, il y a nécessairement des écarts. De la même façon, l’ancienneté dans le poste et la connaissance des patients qu’elle implique conduit les soignants à répondre aux questions plus finement que leur statut ou leur rôle ne leur permettent. Nous nous bornerons à mesurer les écarts entre les réponses individuelles.
En prétest, les patients atteints de pathologie dites archaïques sont donc caractérisés de différentes façons qui toutes renvoient à des représentations très particulières. Les patients sont atteints de déficience intellectuelle (retard neuropsychomoteur), ils sont minorisés (comportement que l’on retrouve chez les enfants). Ils ont des réactions « primaires », proches du primitif. Impulsifs, ils sont agis par des pulsions primitives. Les soignants ne peuvent être qu’impuissants face à ces troubles inscrits dans leur corps, subir ces impulsions primitives.
En post test ces représentations ont évolué. Si les patients sont toujours dans le registre du « primitif », s’ils sont toujours repérés dans le registre du pulsionnel, celui-ci est appréhendé d’une manière différente : trouble de l’attachement, du développement, parents défaillants, vie tiraillée, en recherche d’attention, agrippement, morsures. Les pathologies sont liées aux premières étapes du développement psychoaffectif qui sont parfois citées par les participants. Les soignants devraient se sentir moins impuissants face à ces troubles qu’ils peuvent différencier et décrire plus finement.
L’évolution est patente.
Quels obstacles rencontrez-vous lors des soins à ces patients ?
|
Pré-test |
Posttest |
|
MLR2 « Difficultés de les comprendre quelquefois, le positionnement soignant ? Faire baisser la tension » |
« Comprendre leurs troubles du comportement, gérer leur violence » |
|
NS2 « L’approche, la compréhension de leurs actes ou de leurs réactions » |
« Fragilité affective, manque de cadre et sentiments décuplés. Trop peu de personnel car demande constante » |
|
FK2 « Manque de communication, incompréhension, gestes violents » |
« Manque de communication verbale, incompréhension, violences » |
|
EM2 « Communication, Compréhension, Comment ajuster mon comportement face à eux ? » |
« Communication, compréhension, comment faire mieux ? » |
|
MM2 « En tant que soignant, il faut garder une bonne distance tout en accueillant les pathologies de chacun. Je peux être confronté à des refus, à des troubles de l’attention ou du comportement » |
« Incompréhension au niveau du langage ou de la posture du patient. Il peut être également être inaccessible d’un point de vue psychique et être obstrué par des pensées négatives » |
|
LF2 « La communication, l’intolérance à la frustration/violence (physique/verbale), le manque d’information/de connaissances sur ces pathologies » |
« L’incompréhension, la violence. Ne pas pouvoir leur apporter ce qu’ils attendent » |
|
OF2 « Etant donné que je débute, mon cadre interne demande encore des ajustements, notamment au niveau de la contenance, mais aussi plus généralement mon positionnement face à ces patients (quelle proximité, quelles limites) ? » |
« Depuis la première session de cette formation, je remarque que ma relation avec les patients a évolué. La question des limites est cependant toujours présente et je sais que je dois y rester vigilante » |
|
MG2 « Les moments d’agressivité et violences non expliquées ainsi que l’apparition de certains troubles comportementaux » |
« Les moments problématiques identifiés comme auparavant mais la prise en charge évolue depuis la formation » |
|
LB2 « Comprendre leurs modes de communication et ’'adapter à leur prise en soin, comprendre leurs comportements et en réaction à quelle situation, ces comportements sont-ils récurrents face aux mêmes situations ? » |
« Adapter ma communication à la leur. Violences » |
|
AH2 « Difficultés à entrer en relation et à instaurer des stratégies alternatives à certains troubles du comportement. Difficultés à les accompagner pour développer leur autonomie » |
« Transformer les éléments α que j’accueille » |
|
CE2 « Incompréhension, communication difficile voire impossible, trouble du comportement, violence, intolérance à la frustration » |
« Incompréhension, intolérance à la frustration, violence, hétéro-agressivité » |
|
LL 2 « Les obstacles = pulsions agressives » |
|
La principale difficulté rencontrée par les soignants qui gèrent le quotidien est celle de la compréhension. Comment comprendre les actes de ces patients ? Comment communiquer avec eux et comment s’ajuster à leur comportement ? La question se pose un peu différemment pour les transversaux.
En post-test, les réponses se précisent, les soignants décrivent mieux ce qu’ils ne comprennent pas, ce ne sont plus les patients mais leurs actes. Il semble que la formation ait apporté quelques modifications (OF, MG), la prise en charge évolue tout comme la relation avec ces patients. Pour AH, ces troubles du comportement deviennent des éléments α qu’il faut accueillir et transformer. NS note que davantage de personnel permettrait de mieux se caler sur une demande constante.
Il est toujours difficile de communiquer avec ces patients, de les comprendre mais il existe des moyens de progresser.
Comment pouvez-vous y faire face ?
|
Pré-test |
Posttest |
|
MLR3 « Bonne connaissance des patients, une meilleure connaissance de leur pathologie » |
« Meilleure connaissance de leur parcours de vie et en quoi cela influence leur comportement. Mieux comprendre les raisons de leur passage à l’acte auto et hétéro-agressif » |
|
NS3 « Cohésion + relation avec le patient, observation, médiation, travail d’équipe, histoire du patient, de la pathologie » |
« Lien avec le patient, connaissance de son histoire de vie, observation, se servir des parties « saines » afin de pouvoir travailler sur leur manque. » |
|
FK3 « Intervention des collègues, renseignements dans le dossier » |
« Techniques vues en formation, collègues, dossier patient » |
|
EM3 « J’utilise l’humour, le maternage (soins cocooning, pose d’un cadre) » |
« Ecoute/Patience, humour, maternage » |
|
MM3 « Pour faire face, j’utilise des techniques éducatives contenantes et valorisantes pour créer un lien avec les patients en gardant un cadre ferme mais souple » |
« Réassurance, contenance, écoute de l’autre, permettre de pouvoir extérioriser ses émotions » |
|
LF3 « Prendre le temps de les connaître, de créer un lien de confiance pour comprendre leurs attentes et leurs éventuels passages à l’acte, formations pour approfondir mes connaissances, apprendre des connaissances et pratiques des collègues avec plus d’expérience » |
« Même réponse que le premier jour » |
|
OF3 « Je me base d’abord sur l’individualité des patients, leur façon d’être en lien (ou de ne pas le faire). Je m’adapte ensuite à cela en choisissant d’utiliser l’entretien ou plutôt une médiation » |
« Je me base toujours d’abord sur l’individualité des patients me servant de ce qu’il m’apporte en entretien pour explorer (donc sur les ressources). Je peux aussi un peu plus m’appuyer sur l’équipe, leur vécu parfois différent du mien qui me donne d’autres indices. » |
|
MG3 « Certains sont réactifs à l’humour, ou détournement par des gestes ou d’autres sujets de conversation avec des sujets qu’ils aiment plus particulièrement » |
« Un meilleur accès au bon questionnement pour pouvoir trouver les meilleures solutions en fonction du problème. Quels sont les éléments déclencheurs ? » |
|
LB3 « Avec l’aide des collègues plus expérimentés et qui connaissent mieux les patients, à l’aide de formations adaptées. Essayer de désamorcer les situations difficiles » |
« A l’aide de la formation, par exemple les rythmes, ne pas les brusquer et comprendre leur méthode de communication. Désamorcer une situation tendue en comprenant l’attente du patient » |
|
AH3 « La relation de confiance est aidante, l’humour également » |
« Par le biais de la relation thérapeutique de confiance, par l’instauration de rythmes et de repères » |
|
CE3 « Discussion en équipe, intervention des renforts, passer le relais à un collègue, essayer de désamorcer en partant de quelque chose que le patient apprécie, laisser le patient se calmer tout seul. L’isoler. » |
« Proposition d’échanges (entretien), le laisser se calmer tout seul, passer le relai à un autre collègue » |
|
LL3 « » |
« En approchant le patient de manière différente, en détournant le sujet, s’adapter à la situation » |
A l’exception de LL, les soignants ne sont pas sans outils.
Ils s’appuient d’abord sur l’équipe, sur les collègues plus expérimentés. Il est nécessaire de bien connaître les patients, leur parcours, afin d’établir avec eux une relation de confiance. L’humour, le décentrage font également partie des techniques éducatives utilisées par les soignants. Des patients difficiles à comprendre, impulsifs souvent, aux besoins primitifs mais que l’équipe se donne les moyens de soigner.
En post-test, les soignants ne renoncent pas aux réponses faites au pré-test (LF, OF) mais les complètent, les enrichissent à partir du contenu de la formation. Les passages à l’acte ne sont plus simplement impulsifs, ils peuvent avoir des raisons que l’on peut comprendre (LB), des éléments déclencheurs (MLR, MG). Leur parcours de vie influence leur comportement. Le patient a des parties « saines » sur lesquelles on peut s’appuyer. (NS) Il s’agit aussi de permettre au patient d’extérioriser ses émotions. (MM)
L’évolution est nette. Les soignants intègrent les techniques découvertes en formation et se dotent d’un nouveau regard sur ces situations.
Comment décririez-vous la relation avec ces patients ?
|
Pré-test |
Posttest |
|
MLR4 « Une proximité, un attachement » |
« Rôle étayant, rassurant » |
|
NS4 « Relation maternante ou cadrante/avec un cadre élastique » |
« Maternante, rassurante» |
|
FK4 « Compliquée pour une bonne prise en charge (communication) » |
« Intrigante, enrichissante, compliquée » |
|
EM4 « Il faut créer une relation de confiance pour espérer atteindre des objectifs » |
« Complexe car basée sur la création d’un lien de confiance ce qui est primordial dans la gestion de crise » |
|
MM4 « La relation est avant tout basée sur le lien et la confiance entre soignant et patient pour pouvoir travailler ensemble » |
« La priorité est de créer un lien et de l’entretenir pour faciliter le travail en collaboration » |
|
LF4 « Relation de confiance, adaptation à chaque situation et patients pour que l’on se comprenne au mieux » |
« Relation de confiance +++, relation maternante avec certains patients car c’est ce qu’il recherche » |
|
OF4 « Elle peut être compliquée au début, il faut du temps pour créer des liens. Certains sont plus accessibles » |
« Même réponse que pré-test. Je rajouterais qu’elle est parfois pleine de surprises ! (Bonnes ou moins bonnes) » |
|
MG4 « Maternante » |
« Adaptée mais parfois maternante » |
|
LB4 « Relation de confiance ++, en adaptation et évolution en fonction des tensions psychiques. Très tactile. Attente de relation maternante » |
« Relation de confiance ++, adaptative, et « maternante » » |
|
AH4 « Relation « maternante » » |
« Relation contenante, « maternante » » |
|
CE4 « Relation de « corps à corps », tactile, relation de confiance, rapport un peu « mère-enfant » |
« apport « mère-enfant », rôle éducatif, relation de confiance » |
|
LL4 « Relation maternante » |
|
Lors du prétest, la relation est décrite comme maternante et de confiance, une relation de proximité, tactile. En posttest, nous retrouvons les mêmes types de réponse mais mieux étayées encore.
Sur un plan clinique, à quels éléments devez-vous être attentifs ?
|
Pré-test |
Posttest |
|
MLR5 « Leur posture, plus généralement le non-verbal » |
« Les signes avant-coureurs, ce que je renvoie en tant que soignant » |
|
SR5 « Violence/agressivité, comportement » » |
« Changement de comportement, isolement » |
|
FK5 « Langage du corps, violence, agressivité, comportement » |
« Langage corporel, comportement » |
|
EM5 « Les comportements à risque comme les comportements trop calmes. A adapter à chaque patient » |
« Comportement non habituels, signes de passages à l’acte » |
|
MM5 « Il faut être attentif à des éléments discrets comme des signes du comportement ou des mots qui peuvent faire penser au mal être des patients » |
« Surveiller le comportement, repérer les signes de mal être, écouter les mot prononcés qui peuvent laisser penser à un passage à l’acte » |
|
LF5 « Comportement/langage inhabituel » |
« Attitude, comportement (geste, regard ou parole inhabituels) » |
|
OF5 « Je pense que tout détail est bon à être observé. Bien sûr, il y a le verbal, mais tous n’y ont pas accès. Ainsi la communication se fait par d’autres méthodes (sons, regards, mouvements ». Tout peut être un indicateur de l’état du patient » |
« Même réponse que pré-test, en ajoutant une attention particulière aux différents vécus des patients dans l’équipe qui permettent parfois de révéler des pistes que le patient ne partage pas forcément avec moi du fait de ma position différente » |
|
GM5 « Leur facies, vocabulaire, agissement » |
« Leur comportement, faciès, vocabulaire, apparition de douleurs, … » |
|
LB5 « Comportements inhabituels, tension psychique ou physique. Être observateur » |
« Eléments non verbaux, répétitions de certains mouvements » |
|
AH5 « Au discours pour ceux qui ont accès au langage, au comportement non verbal, aux changements de comportement (apparition soudaine de nouveaux symptômes par ex). » |
« Au comportement non verbal, aux changements de comportement, au discours » |
|
CE5 « Être attentif aux mots et aux gestes. Repérer les éléments déclencheurs et essayer d’éviter le « clash » » |
« Sentiment d’abandon, mise en danger, les mises en échec, aux capacités des patients » |
|
LL5 |
|
Lors du prétest, les soignants observent d’abord : la posture, le non-verbal, les regards, les manifestations de tension, le langage du corps, à ce qui sort d’une certaine routine comportementale. Il s’agit d’anticiper les manifestation d’agressivité et de violence.
En posttest, les soignants sont attentifs aux signes avant-coureurs, aux changements de comportement, à tout ce qui est inhabituel, au sentiment d’abandon, aux mises en danger, à ce qu’ils renvoient, eux-mêmes, en tant que soignants.
La formation a contribué à modifier l’image que les soignants se font de ces patients. Ils ne sont plus tout à fait des déficients, aux besoins primitifs, des enfants qu’il faut encadrer. Leur développement psychoaffectif, pour différentes raisons, a été perturbé au niveau des conduites orales, anales et génitales. Leur manifestation d’agressivité voire de violence cessent d’être incompréhensibles. Il devient possible de repérer des éléments déclenchants, de comprendre cette violence et donc de la prévenir avec une relation à la fois maternante et cadrée.
Satisfaction des stagiaires
Les 12 participants présents ont rempli le questionnaire. Huit avaient demandé la formation, quatre non. La cadre de la MAS, absente aux jours 2,3,4 et 5 n’a pas rempli le questionnaire d’évaluation mais nous savons qu’elle n’avait rien demandé et s’était sentie obligée d’y participer.
Pour les non :
« Inscription à mon arrivée sur l’unité »
« Affection prévue sur Bécarre (AS pool Bécarre), j’ai pu bénéficier de la formation » ;
« Je n’avais pas connaissance de la formation sinon j’en aurais fait la demande ».
Les stagiaires qui n’avaient pas fait une demande explicite de formation sont finalement ravis d’y avoir été inscrit.
Certains ont désiré préciser leur demande :
« J’ai été inscrite d’office mais j’étais volontaire » ;
« En demande de réponses sur certains questionnements et d’aide concernant diverses problématiques » ;
« Demande pour mieux comprendre nos patients ».
On mesure que la formation s’inscrit bien dans un mouvement institutionnel avec au moins un cadre (et un cadre-supérieur de santé) qui facilitent voire mobilisent les soignants.
Perception globale de la formation
100 % des répondants ont une vision globale positive de la formation :
« Les réponses à mes objectifs ont été données » ;
« Prendre le temps pour réfléchir à nos prises en charge + Apports théoriques ».
La durée
100 % des stagiaires ont trouvé la durée de la formation adaptée mais deux stagiaires expriment, dans un autre item, qu’un jour de plus pourrait leur être profitable.
« Pourquoi pas un jour de plus pour pouvoir parler de tous les autres patients non évoqués lors de la formation ? » ;
« Intéressant que cela soit en plusieurs sessions ».
La durée semble adaptée au formateur. La formation ne peut se substituer à la gestion clinique de l’unité.
Enrichissement professionnel
100 % des participants ont retiré un enrichissement professionnel de la formation.
« Acquisition de savoir qui pourra servir comme levier afin de travailler avec les patients » ;
« Remise en question sur des prises en charge et sur ma capacité relationnelle, comprendre pourquoi je rencontrais diverses problématiques » ;
« Une réflexion plus adaptée et réfléchie pour prendre en charge nos patients » ;
« Merci de votre intervention et du partage de vos connaissances, compétences et expériences ».
Le nombre de participants et les échanges en groupe
100 % des stagiaires ont estimé que le nombre de stagiaires était satisfaisant.
100 % des stagiaires ont trouvé les échanges avec les autres participants enrichissants.
Les apports de connaissance
100 % des stagiaires ont jugé les apports de connaissance pertinents.
Les méthodes pédagogiques
100 % des stagiaires ont apprécié les méthodes pédagogiques.
« Temps d’échange, d’écoute mais aussi de visualisation, tout était adapté »
Les capacités relationnelles du formateur
100 % des stagiaires ont trouvé les capacités relationnelles du formateur très favorisantes.
« Vous êtes un puits de connaissance ! Tout était très intéressant »
Analyse des points forts de la formation
Les participants ont retenu :
« Les connaissances théoriques, la multiplicité des supports et la dynamique de groupe » ;
« Enrichissement de connaissances, tremplin pour améliorer la prise en charge des patients » ;
« Les échanges, les questionnements, la synthèse écrite de la formation et les remises en question » ;
« Alternance de théorie/pratique avec partage d’expériences et discussion autour des différentes problématiques » ;
« Formation sur plusieurs jours (permet de revoir certaines choses évoquées les jours précédents) » ;
« Supports mettant en œuvre les explications du formateur » ;
« Connaissances du formateur » ;
« Formateur motivé, passionné, intéressant. Cela m’a permis de « (re)connecter » ma pratique débutante et la théorie » ;
« Apports théoriques, prendre du recul sur notre quotidien » ;
« La dynamique du groupe, les supports de formation, les apports théoriques » ;
« L’échange, le point de vue de chaque personne suivant son expérience et son vécu » ;
« Les points de vue de chaque professionnel, la thématique ».
Chacun y a trouvé quelque chose qui l’intéressait. Se détachent les supports, la théorie, le recul et la remise en question, les échanges et la dynamique du groupe et le formateur.
Plan d’amélioration continue de la qualité
Il n’y a quasiment pas de points faibles identifiés :
« Pré-test et post-test » Avec icône en forme de clin d’œil ;
« Le 1er film intéressant mais un peu long ».
Il est certain qu’entre le pré et post-test, la remise du questionnaire de satisfaction et l’évaluation orale collective, le temps consacré à l’évaluation est long et peu propice à l’obtention de réponses suffisamment soutenues. Le mieux pourrait être l’ennemi du bien.
Les points à modifier
Aucune suggestion de points à modifier.
Le bilan complet de la formation peut être lu dans ce fichier.
![]() Bilanarchaiquesevrey (54.3 Ko)
Bilanarchaiquesevrey (54.3 Ko)
Deuxième session
Nous nous demandions en mai 2023, en analysant la première mouture de la formation Soins au long cours chez les patients souffrant de pathologies dites archaïques s’il serait possible de renouveler la formation en 2024. La présente synthèse montre que oui, cela fut possible. La seconde moitié de l’équipe Bécarre qui n’avait pu en bénéficier en 2023, a pu cheminer à son tour autour du parcours parfois chaotique des patients de l’unité.
Une filmographie sélective a été proposée pour la première fois aux stagiaires : ![]() Filmographie selective (20.26 Ko)
Filmographie selective (20.26 Ko)
Nous notions en mai 2023 : « La vision du groupe est très positive. Les participants ont acquis de nouvelles connaissances, notamment en termes d’éléments cliniques. Parmi les choses marquantes, ils ont retenu la nécessité de prendre le temps d’échanger collectivement autour des patients, de posséder un outil pour comprendre ce qui est en jeu pour chacun (génosociogramme par exemple). Ils ont beaucoup apprécié de travailler chacun autour d’un patient « fil rouge » et la mise en commun que leur narration a impliqué. Ils ont pris conscience de l’importance de travailler sur l’histoire de vie, sur les synthèses qu’ils rédigent à propos des patients. La formation ne s’arrête pas là, ils se sentent reboostés, remotivés. Ils repartent avec quelques petites clés à expérimenter. Ils ont apprécié cette formation avec ses deux intersessions qui leur ont permis de mettre en application ce qu’ils avaient découvert. » Un an après, à froid donc, où en était l’équipe ? Que restait-il de la formation ? Son contenu avait il infusé chez ceux qui n’avait pu y participer ?
Nous avons dû déchanter. L’équipe était en crise, au bord du burn-out généralisé. Des soignants importants, tant en termes d’ambiance dans l’équipe que par leur rôle auprès des patients étaient partis (l’ergothérapeute notamment). L’établissement ayant décidé de raréfier le recours aux isolements et contentions, l’équipe ne pouvait plus proposer d’espace contenant à des patients qui supportent mal la vie en collectivité. Les soignants décrivaient une multiplication des passages à l’acte auto et hétéro-agressifs qui ont entraîné des accidents de travail. Le groupe passait de l’abattement à la colère.
Le premier effet de la formation fut d’offrir à un réceptacle à ce qui s’exprimait là. Sans jugement, avec un réel effort pour comprendre ce que les soignants vivaient. La première session permit de le faire, tant pour le formateur que pour les participants qui avaient en mémoire les retours de leurs collègues. Quand le groupe se retrouva, un mois plus tard, la colère était encore grande souffrance mais l’abattement était moins perceptible. Deux mois plus tard, en mars, l’équipe organisait à nouveau des sorties, pouvait se projeter et avait trouvé de nouvelles façons de contenir les patients. Cette formation a autant été un partage de connaissances (savoir-faire, savoir-penser les troubles, savoir y faire avec la folie) qu’un traitement collectif d’un moment de crise dans une équipe rudement secouée. La qualité du travail accompli lors des intersessions illustre cette évolution.
Pré et post-test, quelle évolution en cinq jours de formation ?
En début de formation, certification Qualiopi oblige, un pré-test fut remis aux stagiaires. Deux mois plus tard, le même questionnaire fut proposé aux stagiaires.
Cinq questions ouvertes ont été posées aux stagiaires qui y ont répondu par écrit.
Comment caractériseriez-vous les patients atteints de pathologies dites archaïques ?
|
Pré-test |
Post-test |
|
Valse « Des personnes au développement psychique semblable à un enfant mais dans un corps d’adulte, et ceux-ci ont des pulsions « primaires » » |
« Identique à ma première réponse, mais ce ne sont plus, pour moi des « pulsions » mais des constructions issues des expériences de l’histoire de vie » |
|
Yola « Patient au développement cognitif limité, souvent basé sur des fonctions primaires. Adhésif et ritualisé. Comportement et gestion des émotions qui font souvent écho avec de la violence et de l’agressivité » |
« Idem » |
|
Dase « Patients qui n’ont pas évolué qui sont restés au stade de l’enfance » |
« Patients restés au stade de l’enfance, très tactiles + souvent intolérants » |
|
Fidji « Ces patients sont caractérisés par des comportements primaires. Bloqués à des stades de la très petite enfance (inférieur à deux ans) ex ; stade oral, anal avec utilisation de violences verbales, comportementales comme moyen d’expression » |
« Je rajouterai que sur le comportement archaïque nos patients sont caractérisés par une relation fusionnelle avec le soignant. Le soignant fait quasiment partie d’eux-mêmes ce qui explique leur comportement envahissant » |
|
Hobo « Personnes atteintes de troubles psychiques présentant des difficultés relationnelles, d’adaptation, de relation à l’autre » |
« Patients avec des troubles de l’identité, de prise de conscience de son corps et de ses limites par rapport à « l’autre » » |
|
Veso « Pas ou peu d’accès à la parole. Pas forcément dans la réalité, pas ou peu de repères dans le temps. Intolérant à la frustration. » |
« Très tactiles, intolérants à la frustration, automutilation » |
|
Cola « Patients adhésifs, impulsifs, peu évolution » |
« Ce sont des patients adhésifs, tactiles » |
|
More « Patients angoissés, intolérants à la frustration, souvent inadaptés et très harcelants, déficients » |
« Tactiles, harcelants, intolérant à la frustration, très demandeurs » |
|
Paco « Tout cela est à découvrir pour moi … » |
« J’ai encore du chemin à faire … » |
|
Jose « Patients qui n’ont pas les définitions des relations sociales ou les compétences qui manifestent leurs émotions, leurs angoisses de manière primaire (agitation, agressivité, violence, angoisse, troubles des comportements …) et qui ont un rapport à l’autre compliqué du fait du stade de leur développement psychoaffectif l’intérieur l’extérieur, le moi l’autre … » |
« Idem » |
|
Cler « Patients impulsifs avec peu ou pas de gestion des émotions. Pour généraliser et grossir le trait : un enfant dans un corps d’adulte » |
« Idem » |
Un traitement statistique des réponses au pré et post-test n’aurait guère de légitimité, la variable liée à la profession ne pouvant être écartée et conditionnant les réponses. Entre ce qu’écrit une aide-soignante et la psychologue, il y a nécessairement des écarts. De la même façon, l’ancienneté dans le poste et la connaissance des patients qu’elle implique conduit les soignants à répondre aux questions plus finement que leur statut ou leur rôle ne leur permettent. Nous nous bornerons à mesurer les écarts entre les réponses individuelles.
En prétest, les patients atteints de pathologie dites archaïques sont donc caractérisés de différentes façons qui toutes renvoient à des représentations très particulières. Les patients sont atteints de déficience intellectuelle (retard neuropsychomoteur), ils sont minorisés (comportement que l’on retrouve chez les enfants). Ils ont des réactions « primaires », proches du primitif. Impulsifs, ils sont agis par des pulsions primitives. Les soignants ne peuvent être qu’impuissants face à ces troubles inscrits dans leur corps, subir ces impulsions primitives, cette violence. Ce groupe se différencie du précédent en ce qu’il se réfère moins aux aspects neurobiologiques de la genèse des troubles et un peu plus à une explication d’origine psychodynamique (stades de développement psychoaffectif). Est-ce un effet induit par la première formation ?
En post test, trois soignants maintiennent leurs réponses du pré-test. D’autres comme Valse ou Fidji reprennent leurs réponses au pré-test et les précisent : « Identique à ma première réponse, mais ce ne sont plus, pour moi des « pulsions » mais des constructions issues des expériences de l’histoire de vie ». La nuance est de taille et témoigne de l’évolution de la soignante. Plus des pulsions donc qui au fond échappe à un sujet totalement envahi, mais une construction issue de ses expériences de vie. Le sujet n’est plus considéré comme un être passif qui subit mais comme un acteur de sa vie. On repère dans cette réponse l’impact des histoires de vie revisitées collectivement pour chaque patient. Si les patients sont toujours dans le registre du « primitif », s’ils sont toujours repérés dans le registre du pulsionnel, celui-ci est appréhendé d’une manière différente. Ils sont tactiles. Ils touchent et son intolérants à la frustration. Les pathologies sont liées aux premières étapes du développement psychoaffectif qui sont parfois citées par les participants. Les soignants devraient se sentir moins impuissants face à ces troubles qu’ils peuvent différencier et décrire plus finement.
L’évolution est patente.
Quels obstacles rencontrez-vous lors des soins à ces patients ?
|
Pré-test |
Post-test |
|
Valse « Une violence sans ouverture ou techniques d’approche possibles générant des passages à l’acte incontrôlables » |
« Le manque de moyens permettant de maintenir/contenir et d’identifier certains éléments essentiels du développement personnel de chaque patient et leur construction » |
|
Yola « Limitation des capacités physiques et motrices, difficultés dans la compréhension des consignes, difficultés de communication » |
« Limitation compréhension consignes, perception du corps et des limites corporelles, gestion du moi peau vis-à-vis de l’activité » |
|
Dase « Problème de communication et de compréhension, problème de violence et agressivité, sentiment d’échec » |
« Etat d’agitation » |
|
Fidji « Parfois des refus par incompréhension de notre demande pouvant entraîner des replis sur eux-mêmes ou des gestes de défense. Nous différons le soin si besoin ou essayons d’expliquer autrement ou même passons la main à un autre collègue si besoin » |
« Idem Divers refus ou débordements » |
|
Hobo « Défaut de communication et de compréhension (difficultés d’élocution et de verbalisation). Apaiser les angoisses. » |
« Idem » |
|
Veso « Très caractériels : opposition, intolérance à la frustration, agressivité, violence » |
« Opposition, frustration » |
|
Cola « Plus de sens à mes soins (prise en charge), difficultés à comprendre le mal-être psychique, difficultés à trouver une solution pour diminuer l’agressivité » |
« L’opposition et la frustration » |
|
More « La patience, très demandeur et répondre tout de suite à leur demande pour ne pas créer le conflit » |
« Très demandeurs et répondre de suite à leur demande » |
|
Paco « La méconnaissance de leurs comportements face à leurs antécédents et leur caractère » |
« Pas vraiment des obstacles maintenant qu’on a vu leurs histoires de vie » |
|
Jose « Cohésion d’équipe/connaissances théorique l’agitation, l’angoisse, le manque de compréhension, de verbalisation » |
« Idem » |
|
Cler « Être face à des émotions « brutes », la soudaineté de la violence et de l’agressivité » |
« Idem + impossible de permettre aux patients un temps de repos et d’apaisement sans hypervigilance + une unité en deux ailes ce qui sépare la personne » |
La principale difficulté rencontrée par les soignants qui gèrent le quotidien est celle de la compréhension, de la communication avec ces patients intolérants à la frustration. Comment comprendre les actes de ces patients ? La soudaineté de la violence et de l’agressivité ? Comment communiquer avec eux et comment s’ajuster à leur comportement ? La question se pose un peu différemment pour les transversaux.
En post-test, les réponses se font moins riches. Apparaissent des difficultés liées au fonctionnement institutionnel, aux moyens humains et matériels mis à disposition de l’équipe. « Opposition et frustration » résume les réponses des soignants à l’item. Paco mentionne l’importance des histoires de vie pour comprendre ce qui est en jeu pour les patients. Yola introduit le Moi peau présenté en formation. Nous verrons que ces deux éléments vont revenir régulièrement aux items suivants.
Il est toujours difficile de communiquer avec ces patients, de les comprendre mais il existe des moyens de progresser.
Comment pouvez-vous y faire face ?
|
Pré-test |
Post-test |
|
Valse « Dans l’idéal en proposant un temps d’apaisement ou un soin à médiation mais dans la réalité institutionnelle c’est un appel aux renforts pour une mise en CSI » |
« Un fonctionnement institutionnel plus adapté (moyens, personnels) » |
|
Yola « Nommer ce qui peut poser soucis via questionnement direct, évaluer par étape en passant par le processus complet de prise en charge/consigne +démonstration + aide, consigne + démonstration + consigne » |
« Questionnement auprès du patient sur ses ressentis, décortication des consignes pour les patients, proposition de multiples situations au cours d’un sport pour montrer toutes les facettes et perceptions corporelles et psychiques possibles pour lui » |
|
Dase « Mettre du sens dans les soins » |
« Mettre du sens dans le soin, tenir compte de leur histoire de vie » |
|
Fidji « Différer le soin, le présenter d’une autre manière, utiliser un objet pour détourner l’attention, utiliser un renforçateur, faire preuve de patience et d’écoute » |
« Essayer de contenir le patient de diverses manières : musique, bain … » |
|
Hobo « Utiliser d’autres moyens de communication et d’échanges, établir une relation de confiance, différer les soins, réassurance » |
« Connaître l’histoire de vie du patient (ses traumatismes) ainsi que ses habitudes de vie + idem » |
|
Veso « Essayer de les comprendre par les gestes, le regard, les cadrer en respectant les contrats de soins, essayer de désamorcer une crise avant par un entretien, une activité ponctuelle » |
« En chantant, humour » |
|
Cola « Soins de médiation, thérapeutiques » |
« Mieux connaître les histoires de vie, observer plus attentivement les patients, leurs attitudes, les gestes, les besoins, le moi peau, la contenance. Soins de médiation » |
|
More « La désescalade, proposer des temps individuels (bain par exemple) » |
« Relation de confiance, connaître mieux les histoires de vie du patient, désescalade » |
|
Paco « En apprenant à les connaître » |
« J’ai peut-être un point de vue plus éclairé » |
|
Jose « L’observation, la bienveillance, la connaissance, être humble, accepter test/échec, travail d’équipe, la collaboration, détecter les prodromes » |
« Idem » |
|
Cler « L’observation par exemple d’anticiper le mieux possible et désamorcer une situation qui pourrait être problématique, la connaissance du patient et une relation de confiance » |
« Observation, désamorçage, connaître le patient, relation de confiance, la patience, se détacher de l’apparence physique adulte et voir le « bébé » (Moi peau) » |
Les soignants ne sont pas sans outils, ni expérience. Ils possèdent collectivement les connaissances pratiques pour faire face à cette agressivité/violence, à cette non-compréhension des patients. Il apparaît ainsi que la crise n’est pas liée à un manque de connaissance voire à une perte de sens comme certains l’écrivent mais en la reconnaissance de la capacité collective à contenir les patients. Valse le résume assez bien : « Dans l’idéal en proposant un temps d’apaisement ou un soin à médiation mais dans la réalité institutionnelle c’est un appel aux renforts pour une mise en CSI ». L’institution apparaît moins contenante aux soignants. Les stratégies qu’ils avaient mises en place (isoler les patients pour diminuer les stimulations) ne peuvent plus être utilisées. Il leur faut en découvrir d’autres qu’ils possèdent et qu’ils connaissent.
Ils s’appuient d’abord sur l’équipe, sur les collègues plus expérimentés. Il est nécessaire de bien connaître les patients, leur parcours, afin d’établir avec eux une relation de confiance. L’humour, le décentrage font partie des techniques éducatives utilisées par les soignants. L’observation des attitudes et des comportements, le désamorçage des situations, les médiations font partie des outils des soignants.
En post-test, les soignants mettent en avant la connaissance des histoires de vie des patients qui permet de repérer du sens dans ce qui semblait ne pas en avoir. Cola l’écrit très bien : « Mieux connaître les histoires de vie, observer plus attentivement les patients, leurs attitudes, les gestes, les besoins, le moi peau, la contenance. Soins de médiation »
L’évolution est nette. Les soignants intègrent les techniques et les concepts découverts en formation.
Comment décririez-vous la relation avec ces patients ?
|
Pré-test |
Post-test |
|
Valse « Une relation soignant-soigné proposant un cadre réassurant/sécurisant et une attitude d’écoute/conseils positifs » |
« Idem » |
|
Yola « Relation de confiance/respect des statuts tout en restant dans le lien « amicale » |
« Bienveillante, basée sur la confiance mutuelle » |
|
Dase « Besoin d’aide, de les rendre autonomes le plus possible et indépendants. Besoin de rentrer en confiance » |
« Instaurer un certaine confiance, faire preuve de patience » |
|
Fidji « La relation est parfois compliquée puisqu’on identifie pas forcément ce qui « bloque » le patient. Les « blocages » sont souvent réduits lorsque le soignant a un bon relationnel avec le patient. Un lien de confiance est fondamental » |
« « fusionnelle » lorsque le patient nous considère comme partie intégrante de lui-même, compliqué parfois à garder la distance physique et affective » |
|
Hobo « Relation affective qui doit être une relation de confiance instaurée avec le temps et la connaissance des habitudes de l’autre » |
« Ecoute et empathie. Collaboration avec les familles. Prendre en compte le « Moi peau » + idem » |
|
Veso « Attachant dans l’empathie. Ils ont besoin de repères pour éviter l’angoisse. Envahissant et adhésif » |
« Attachant, adhésif, relation de confiance » |
|
Cola « Relation de confiance » |
« Relation de confiance » |
|
More « Une relation de confiance » |
« Relation de confiance » |
|
Paco « Pour l’instant, je me fie aux compétences et recommandations de mes collègues » |
« Différente quand même » |
|
Jose « Simplicité, écoute, empathie, être contenant, réassurant, trouver un lien qui valorise le patient et qu’il nous repère comme » |
« Idem » |
|
Cler « Une relation très intense car des patients très demandeurs, un mélange entre de la fermeté et du maternage » |
« Entière, intense, brute » |
Lors du prétest, la relation est décrite sous la forme d’une relation de confiance. Cler et Vase en parlent très bien : « Une relation très intense car des patients très demandeurs, un mélange entre de la fermeté et du maternage », « Une relation soignant-soigné proposant un cadre réassurant/sécurisant et une attitude d’écoute/conseils positifs ». En post test, nous retrouvons les mêmes types de réponse mais mieux étayées encore. Yola précise qu’il s’agit d’une confiance mutuelle, elle n’est pas à sens unique. Cler insiste sur l’intensité de cette relation « Entière, intense, brute ». Une relation de confiance mutuelle certes mais intense surtout lorsque le patient considère le soignant comme faisant partie de lui. (Fidji) En post-test, les soignants découvrent davantage la complexité de cette relation, au-delà de la posture voire du slogan.
Sur un plan clinique, à quels éléments devez-vous être attentifs ?
|
Pré-test |
Post-test |
|
Valse « Aux traumatismes liés à la violence, les plaies liées à l’agressivité, les effets secondaires liés aux neuroleptiques » |
« Des éléments d’observation différents grâce aux points abordés en formation » |
|
Yola « Aux éléments dits somatiques soit liés au psychisme soit réellement somatiques » |
« Capacité physique motrice et émotionnel à un instant T, échanges informels + informations transmises par le patient » |
|
Dase « L’humeur et +/- état psychologique et d’agitation » |
« Le Moi peau » |
|
Fidji « L’attention doit être constante mais particulièrement en période d’agitation » |
« Nous devons être attentifs aux améliorations ou régressions du comportement du patient, trouver les causes, éventuellement les éléments déclencheurs et la fréquence » |
|
Hobo « Repérer les signaux d’une frustration par l’observation et anticiper les passages à l’acte auto ou hétéro agressif ainsi que les sensations de mal être ou d’isolement » |
« Histoire de vie. Attitudes. Relations aux autres + Idem avant. Prendre en compte le « moi peau » » |
|
Veso « Changement de comportement lors des soins d’hygiène, lors des repas » |
« Automutilation, peau à peau » |
|
Cola « Manque de sommeil, constipation, fatigue » |
« Dois être attentifs à leurs attitudes, leurs gestes, les besoins, le toucher » |
|
More « Temps individuel » |
« Changements de comportement, les temps individuels » |
|
Paco « Aux changements de leurs attitudes » |
« A leurs mimiques racontées par mes collègues, comportement, réactions » |
|
Jose « Trouble du comportement, mal-être, angoisse, trouble de l’humeur » |
« Idem » |
|
Cler « Un état d’agitation ou le silence » |
« Changements de comportement » |
Lors du prétest, les soignants observent d’abord : la posture, le non-verbal, les regards, les manifestations de tension, le langage du corps, à ce qui sort d’une certaine routine comportementale. Il s’agit d’anticiper les manifestation d’agressivité et de violence.
En post test, les soignants sont attentifs aux signes avant-coureurs, aux changements de comportement, à tout ce qui est inhabituel, même de l’ordre de l’infime, au sentiment d’abandon, aux mises en danger, à ce qu’ils renvoient, eux-mêmes, en tant que soignants.
La formation a contribué à modifier l’image que les soignants se font de ces patients. Ils ne sont plus tout à fait des déficients, aux besoins primitifs, des enfants qu’il faut encadrer. Leur développement psychoaffectif, pour différentes raisons, a été perturbé au niveau des conduites orales, anales et génitales. Leur manifestation d’agressivité voire de violence cessent d’être incompréhensibles. Il devient possible en connaissant leurs histoires de vie, leur façon de vivre le quotidien, de repérer des éléments déclenchants, de comprendre cette violence et donc de la prévenir avec une relation à la fois maternante et cadrée en étant attentif aux variations de leur vécu corporel (Moi peau).
La perception de la formation par le groupe
Les 11 participants présents ont rempli le questionnaire de satisfaction.
Trois stagiaires avaient demandé la formation, les autres non (il s’agit d’une formation de pôle).
Pour ceux qui l’ont demandé :
« Les collègues l’avaient déjà eue. Je trouve intéressant de la faire »,
« Les collègues l’avaient déjà faite et de bons retours »
Pour ceux qui ne l’ont pas demandé :
« Décision de l’établissement face à un mal être de l’équipe »,
« Inscription par la cadre du service »,
« Décision de la cadre de santé »,
« Inscrite par la cadre »,
« Décision par la cadre ».
Comme souvent au CHS de Sevrey, les cadres sont prescripteurs de formation. A fortiori pour celle-ci, la cadre de l’unité ayant participé à sa première version.
Perception globale de la formation
Huit participants ont une vision globale positive de la formation et trois une vision neutre.
Les neutres précisent :
« J’ai encore un manque de connaissances »,
« Pistes non-concrètes apportées, besoin de temps de réflexion pour cheminer ce que la formation m’a apportée ».
Les positives :
« Très constructives et formation bien structurée »,
« Groupe dynamique, nous a laissé nous exprimer sans jugement »,
« Très interactive, j’apprécie que ce ne soit pas un cours magistral »,
« Raisonnement personnel approfondi suite aux pistes d’ouverture proposées par le formateur ».
La durée
Dix stagiaires ont trouvé la durée de la formation adaptée et un l’a trouvé trop longue.
« Cela nous laisse le temps d’approfondir certains cas »,
« Découpée en plusieurs étapes de travaux différents ».
Enrichissement professionnel
Dix participants ont retiré un enrichissement professionnel de la formation et un, non.
« L’écoute de mes collègues m’a beaucoup apporté »,
« Connaissances approfondies sur l’histoire de vie des patients et pistes de réajustement sur ma pratique professionnelle »,
« Groupe de parole fait du bien »,
« Mettre des mots, des noms de concepts sur des éléments identifiés. Prendre de la hauteur vis-à-vis de ma pratique »
Exprimer ses difficultés dans un collectif retrouvé, revisiter l’histoire de chaque patient, identifier les concepts relatifs aux troubles, réajuster sa pratique professionnelle, prendre de la hauteur tels sont les apports de la formation.
Le nombre de participants et les échanges en groupe
Tous ont trouvé que le nombre de stagiaires était satisfaisant (100 %).
90 % des stagiaires ont trouvé que les échanges avec les autres participants nombre de participants avaient été enrichissants.
« Oui, plusieurs apports de témoignages enrichissants »,
« Le fait de faire cette formation en équipe est un + »,
« Beaucoup d’échanges et le savoir de certains peut éclairer sur certains cas. »
Les conditions d’une transmission des plus anciens vers les novices ont été rassemblées.
Les apports de connaissance
90 % stagiaires ont jugé les apports de connaissance pertinents.
« Connaissances en partie déjà acquise au cours de mes études »
Les méthodes pédagogiques
100 % des stagiaires les ont jugées favorisantes.
Les capacités relationnelles du formateur
100 % des stagiaires ont trouvé les capacités relationnelles du formateur favorisantes.
Les points forts de la formation
Les participants ont retenu :
« Echange enrichissant. Connaissance du sujet par le formateur et capacité de transmission de ses connaissances »,
« Les échanges ont rendu cette formation très enrichissantes ainsi que l’analyse en groupe des synthèses. »,
« Les échanges »,
« Discussion sur cas concrets »,
« Interactions du groupe »,
« La libre circulation de la parole. Support vidéo appréciable »
« Le fait de pouvoir s’exprimer librement et parler du vécu et de la situation réelle sur nos patients »,
« L’interactivité entre formateur/participants. Rebondir sur des éléments amenés par les participants. »,
« Basée sur la mise en coordination des différents vécus de chacun »,
« Le libre-échange ».
Les points faibles
Il y a peu de points faibles identifiés :
« Les films un peu trop anciens » (C’est assez juste, D. Anzieu a été filmé à un moment où son parkinson était assez prononcé, ce qui rend sa vision parfois un peu pénible).
« Trop long, mériterait d’être plus concis »,
« Peut-être un peu plus de « solutions » aux problèmes évoqués »,
« Trop axé sur les synthèses sans pour autant avoir d’élément de réponse ». Ces deux derniers points sont assumés par le formateur qui a fait en sorte que les « solutions » émergent du groupe. L’absence de professionnels transversaux (psychologue, neuropsychologue, ergothérapeute, moniteur/éducateur) s’est ici avérée pénalisante pour ce groupe. Le regard de la psychologue ou de l’ergothérapeute complétant celui du formateur tout en émanant de l’équipe mettait en évidence les solutions qui existaient déjà, à l’insu des soignants.
Les points à modifier
« Apporter des éléments aux synthèses sans pour avoir autant d’éléments de réponse »,
« Durée, échanges plus coordonnés et cadrés ».
Les éléments à mettre en pratique
« Les éléments que j’ai découverts »,
« Le Moi peau »,
« Le moi peau »,
« Tentative de chant avec un patient, creuser le dossier d’autres patients sur quelques détails de vie »,
« Se poser et discuter des patients permet de croiser les expériences, les points de vue et donne des axes de travail »,
« Plus d’observations »,
« Observation, réflexion en rapport aux attitudes des patients ».
Les mouvements observés pendant cette formation et le traitement collectif d'un moment de crise dans une équipe nous incitent à l'inclure dans notre proposition de formation comme une forme d'Analyse des Pratiques Professionnelles et à le proposer lorsque cela nous semblera pertinent.
[1] Bergez J-L, Dorian J., Combret M., « Le « tu » et le « vous » dans la relation thérapeutique », in Soins Psychiatrie, n°205, nov 1999, Masson.
[2] Aurélia Chaplet, Stéphanie Coycaut, Laurence Fourcade, Katia Lahonta, Valérie Laudren, Béatrice Lebreton, Mélanie Léveillé, Dominique Mouhica, Cécile Garcia-Rossignol, Jérôme Burniotto, Jean-Louis Clément, Bertrand Ferré, Nicolas Trostiansky, Michel Combret (coord.), Réflexions sur la Mise en Chambre d’Isolement au C.H Cadillac Sur Garonne, Réflexions sur la MCI, Cadillac Sur Garonne (serpsy1.com)
[3] Combret M. « Isolement et contention : l’enjeu de la formation », in Santé Mentale, n° 222, jan. 2017.
Date de dernière mise à jour : 18/09/2024
Ajouter un commentaire